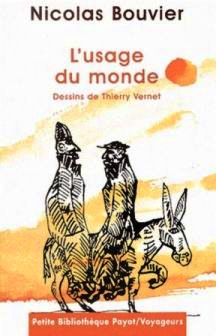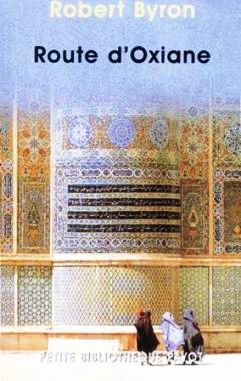|
Robert Byron, Nicolas Bouvier. Le premier était anglais. Parti en 1932 à la découverte de l’architecture islamique en Asie Centrale et en Afghanistan, il traversa l’Iran d’est en ouest, puis d’ouest en est avant d’explorer le sud et de repartir vers le sous-continent indien. De se voyage, il tira Route d’Oxiane [1].
Le second est suisse. Nicolas Bouvier quitta Genève en 1953 à bord d’une Fiat Topolino en compagnie du peintre Thierry Vernet, son « jumeau psychologique » et « compagnon intemporel » [2]. Après avoir traversé la Yougoslavie de Tito (Bosnie, Serbie, Macédoine), ils parcoururent la Grèce et plongèrent dans l’Anatolie jusqu’à la frontière iranienne. Arrivés au début de l’hiver, ils s’installèrent à Tabriz jusqu’au printemps et repartirent vers Téhéran, puis Ispahan, Shiraz, Kerman et franchirent la frontière du Pakistan, près de Zahedan. Leur voyage est raconté dans L’usage du monde [3].
Ces deux ouvrages font référence. Selon Bruce Chatwin : « Quiconque a tant soit peu lu les récits de voyages des années 30 est amené à considérer Route d’Oxiane de Robert Byron comme le sommet du genre » [4]. Quant à Bouvier, la notoriété de sa définition sensible et pertinente du voyage suffit à rappeler combien l’auteur, malgré toutes les difficultés rencontrées pour faire publier son livre, a marqué un tournant dans la littérature de voyage : « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait ».
|
|||
A Byron, « gentleman doublé d’un érudit et d’un esthète » [5], voyageur anglais à l’humour parfois acerbe et au cynisme cinglant, s’oppose Nicolas Bouvier, à la quête de lui-même autant que de l’autre qui, reprenant Emerson, explique « [qu’] une fois ces frontières franchies, nous ne redeviendrons jamais plus tout à fait les misérables pédants que nous étions » [6]. Ces deux récits, aux qualités reconnues et aux différences marquées, se répondent : leur itinéraire est proche, 20 ans seulement les séparent l’un de l’autre (deux décennies qui ont tout de même une importance capitale dans l’histoire du XXe siècle y compris pour la région).
Des auteurs témoins de leur temps

- Nicolas Bouvier et Thierry Vernet
Au début des années 30 ou au milieu des années 50, les deux voyageurs explorèrent l’Iran sous la dynastie Pahlavi : Rezâ Shâh pour le premier et Mohammad-Rezâ Shâh pour le second. Dès son premier jour en Perse, Byron apprit au détour d’une conversation quelles étaient les usages pour parler du Shâh. Alors qu’il questionnait son ami Christopher sur des détails vestimentaires, celui-ci lui répondit :
« (…) Chut. Motus. On ne parle pas du schah comme ça en public. On dit "Mr. Smith" ». [7] Suit une discussion des plus surréalistes sur le pseudonyme qu’il pourra utiliser : Mr. Smith étant le surnom de Mussolini, Mr. Brown celui de Staline et Mr. Jones celui d’Hitler. Ils adoptèrent finalement Marjoribanks, que Byron reprit consciencieusement dans ses notes tout au long de son séjour en Perse. Au-delà de l’anecdote, dont le récit révèle l’impertinence (ou la pertinence…) de l’auteur, elle participe à inscrire Byron dans un contexte politique général et, plus spécifiquement, la place qu’il occupe en son sein : il n’est pas un voyageur anonyme (en témoignent les nombreux officiels qu’il rencontre sur sa route et les salons qu’il fréquente avec assiduité mais pas sans son sens critique) et se doit de surveiller ceux qui le surveillent probablement. Il ne se désintéresse pas pour autant de la situation politique du pays.
Après son premier séjour en Afghanistan, il rentra à Téhéran. Le 15 janvier, il apprit « [qu’] en novembre, Marjoribanks s’est cru menacé d’un coup d’Etat » [8]. Il explique ensuite les raisons de cette crainte et conclut : « Personne ne peut dire s’il y a réellement eu complot. Mais chacun pense qu’il y en aura un (…). Je ne crois personnellement à aucun de ces bruits : le propre des dictatures est d’alimenter la rumeur ».

- Robert Byron
En janvier 1954, Bouvier était toujours à Tabriz quand commença le procès de Mossadegh : « Le procès de Mossadegh qui venait de s’ouvrir à Téhéran laissait craindre ici quelques échauffourées » [9]. Il poursuit par une description tendrement sévère : « La ville, qui s’y connaissait en despotisme, lui reconnaissait du talent ». Puis Bouvier revient sur Mossadegh lui-même avec, semble-t-il, une certaine distance : « En fait, Mossadegh était bien plus populaire que la presse occidentale ne l’avait laissé croire. (…) Pour l’homme de la rue, Mossadegh restait le renard iranien plus rusé que le renard anglais, qui avait arraché le pétrole à l’Occident et habilement défendu son pays à La Haye. Son talent de Protée, son courage, son patriotisme, sa duplicité géniale avaient fait de lui un héros national (…). »
S’il a été le « témoin privilégié », selon l’expression consacrée, d’un tournant de l’histoire contemporaine de l’Iran, Bouvier ne change pas son ton, pas plus grandiloquent que pour décrire d’autres aspects de la vie quotidienne. Comme l’écrit David Le Breton, « ce que Nicolas Bouvier aime dans les repas, ce n’est pas le goût des plats mais le fait de savourer la présence des autres. Le repas, même le partage de quelques tartines, implique la commensalité, une célébration du lien, une culmination festive et paisible du lien social. » [10]. Plus qu’un écrivain des faits, Bouvier raconte la sensation.
Ecrivain des faits et auteur de la sensation
Pour bien saisir les différences des récits de Byron et Bouvier, et au-delà les conceptions du voyage et de la manière de le raconter, il est intéressant d’observer leurs expériences similaires, notamment leur visite de Persépolis.
« Dormir dans ces ruines nous payait bien des tracas, Les nuits surtout elles étaient belles : lune safran, ciel troublé de poussière, nuages de velours gris. Les chouettes perchaient sur les colonnes tronquées, sur la mitre des sphinx qui gardent le portique ; les grillons chantaient dans le noir des murailles. Du Poussin funèbre. ». Plus que le lieu, c’est l’ambiance du lieu que retient Bouvier. Il retient la sensation éprouvée, à cet instant, dans cet endroit, l’effet que tous ces stimuli provoquent sur ses sens, même s’il privilégie la vue à l’odorat et au goût, par choix autant que par nécessité (« Une indifférence quasi-totale à la gastronomie a fait de moi un voyageur très endurant » [11]).
|
|||
Byron resta plusieurs jours à Persépolis. Il en délivra une description précise et extrêmement détaillée [12]. « Nakch-é-Rostem » est finement analysé, sculpture par sculpture. Il appliqua cette rigueur de l’esthète amoureux de l’architecture à toutes les constructions qu’il croisa, avec plus ou moins de zèle, sans que cela ne dépende forcément de l’importance intrinsèque du monument. Lors de son passage à Hamadan, il découvre le « Gondbad-é-Alavian » (…) dont les panneaux de stuc non coloré, faisant des bosses et des trous au milieu d’un déferlement de végétation exubérante, sont toutefois aussi riches et ordonnés que Versailles – peut-être même plus riches, si l’on tient compte de l’économie de moyen qui a présidé à leur élaboration. Car lorsqu’on atteint à la splendeur grâce à un ciseau et un bout de plâtre au lieu de mobiliser tous les trésors de la terre, cette splendeur est due au seul dessin. S’agissant de l’art islamique, on oublie devant cela le mauvais goût qu’il a pu vous laisser dans la bouche à l’Alhambra ou au Taj Mahal. Je suis venu en Perse pour me débarrasser définitivement de ce goût-là » [13].
Comme l’explique Bruce Chatwin : « (…) bien souvent, [Byron] transcende la banale science par sa mystérieuse faculté de juger l’état d’avancement d’une civilisation à son architecture, et de traiter les édifices anciens et les hommes d’aujourd’hui comme deux aspects d’une même continuité historique » [14].
Moins factuelle, sans doute plus poétique – effet renforcé par les adjectifs choisis par Bouvier, sa « grande épicerie » [15]- la description du bleu renvoie directement à l’émotion que sa vue lui procure : « Il faut venir jusqu’ici pour découvrir le bleu. Dans les Balkans déjà l’œil s’y prépare ; en Grêce, il domine mais il fait l’important : un bleu agressif, remuant comme la mer, qui laisse encore percer l’affirmation, les projets, une sorte d’intransigeance. Tandis qu’ici ! "Les portes des boutiques, les licous des chevaux, les bijoux de quatre sous : partout cet inimitable bleu persan qui allège le cœur, qui tient l’Iran à bout de bras, qui s’est éclairé et patiné avec le temps comme s’éclaire la palette d’un grand peintre ». Ou encore le récit de son passage à Shiraz où l’auteur voit dans les espadrilles d’un paysan « une forme de maître, précise, racée qui suggère aussitôt que le pays à cinq mille ans ».
Ce qui distingue fondamentalement ces deux voyageurs, et par conséquent ces deux écrivains, c’est sans doute leur approche du voyage. Là où Byron explorait, sans sombrer dans le pittoresque ni l’exotisme, Bouvier se laissait bercer par ses rencontres et errait, sans que ce mot ne recouvre ici un sens péjoratif. Le voyage est un prétexte. Il écrit avant tout, pas seulement pour fixer les événements dans le temps, alors que Byron tient consciencieusement son carnet à jour. Coincés par la neige, Thierry Vernet et lui restèrent tout l’hiver à Tabriz. Un matin de décembre, leur logeuse pour qui l’idée « qu’on vienne - d’aussi loin et de plein – s’installer ici paraissait saugrenu » vint leur rendre visite.
« Mais que faites-vous donc ici ?
- J’ai des élèves.
- Mais le matin ?
- Vous voyez bien, je prends des notes, j’écris.
- Mais moi aussi j’écris… l’arménien, le persan, l’anglais - fit-elle en comptant sur ses doigts – ce n’est pas un métier. » [16]
Le dialogue en dit long sur l’incompréhension face à ces nouveaux voyageurs dont Le Breton donne une excellente définition : « La route est université, car elle est universalité qui ne se contente pas de diffuser un savoir, mais aussi une philosophie d’existence propre à polir l’esprit et à le ramener toujours à l’humilité et à la souveraineté de son chemin. Elle est le lieu où se défaire des schémas conventionnels d’appropriation du monde pour être à l’affût de l’inattendu, déconstruire ses certitudes plutôt que s’ancrer en elles. Le voyage est un état d’alerte permanent pour les sens et l’intelligence. »
Notes
[1] Byron, Robert, Route d’Oxiane, Payot, 2006.
[2] Bouvier, Nicolas, L’usage du monde, Payot, 1992, p. 69.
[3] Bouvier, Nicolas, L’usage du monde, Payot, 1992.
[4] Byron, Robert, Route d’Oxiane, Payot, 2006, p. 9 (préface).
[5] Ibid.
[6] Le Breton, David, Nicolas Bouvier. Un écrivain du voyage. Etudes 2009/5, Tome 410, p. 653.
[7] Byron, Robert, Route d’Oxiane, Payot, 2006, p. 68.
[8] Ibid. p. 182.
[9] Bouvier, Nicolas, L’usage du Monde, Payot, 2001, p. 155.
[10] Le Breton, David, Nicolas Bouvier. Un écrivain du voyage, Etudes 2009/5, Tome 410, p. 660.
[11] Ibid, p. 659.
[12] Voir Byron, Robert, Route d’Oxiane, p. 232.
[13] Ibid, p. 70.
[14] Byron, Robert, Route d’Oxiane, préface, p. 13.
[15] Le Breton, David, Nicolas Bouvier. Un écrivain du voyage, Etudes 2009/5, Tome 410, p. 655.
[16] Bouvier, Nicolas, L’usage du Monde, Payot, 2001, p. 157.