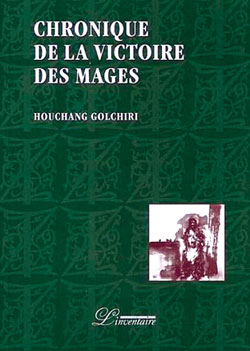|
Introduction
1. Validité de la définition
Cette distinction, qui fait référence à une thématique, plutôt qu’aux structures et aux formes, se retrouve dans la plupart des histoires de la littérature (Browne, Rypka, Aryanpour, Kamshad…). Sans être totalement pertinente, elle permet néanmoins de décrire une évolution. En effet, les premiers romans persans paraissent en librairie au début du XXe siècle, au terme d’un processus assez complexe qui intègre les traductions, les imitations, la transformation du système pédagogique et culturel dans son ensemble. Les premiers romans mettent l’accent sur l’histoire car l’attente est forte en ce domaine ; les suivants se plongent dans les réalités sociales et les problèmes de société. À ce stade, la société iranienne est en pleine redéfinition et la crise des modernes et des anciens fait éclater le système des valeurs. Le roman nouveau s’attachera, après la chute de la dynastie qâdjâre et l’avènement des Pahlavi, à décrire les injustices sociales et les misères de la condition humaine.
2. Roman et histoire, roman dans l’histoire
(Mythes, histoires, fictions, imaginaire, aventures)
À l’imitation des romans historiques du romantisme français, les premiers romans persans choisissent comme toile de fond l’histoire de l’Iran et en particulier les points de crise et les moments de renouveau dans cette histoire que sont : les premières conquêtes des Achéménides, la chute de l’empire Sassanide, l’arrivée de l’islam, les invasions turco-mongoles, l’avènement des Safavides ou encore le soulèvement du Khouzestân contre les Anglais. Ces romans, par cet ancrage historique, volontairement pédagogique voire scientifique, veulent se démarquer nettement de la tradition romanesque depuis le Moyen-âge jusqu’au dernier avatar au XIXe siècle.
Toutefois, la puissance de la tradition entraîne malgré lui le romancier dans le monde plus ou moins magique du conte populaire. On en trouve de nombreux exemples dans le premier roman en date (la trilogie de Shams-o-Toghrâ de Mohammad Bâgher Khosravi) ; ou bien dans la vie de Cyrus (Eshq va Saltanat) par Sheykh Moussâ Nasri Hamadâni. Ce genre du roman historique, formellement hésitant, sera caricaturé par Sâdegh Hedâyat dans Vagh Vagh Sâhâb. Hedâyat se voudra délibérément en opposition à ce type de roman, dont la modernité reste encore à démontrer. On citera encore, quoique un peu différent des deux premiers, et probablement plus proche de ses modèles européens, le roman de San’atizâdeh Kermâni, Dâmgostarân. (Kâmshâd donne une liste assez exhaustive de ces romanciers historiques p. 52-53). Pourtant, la veine, loin de tarir après Hedâyat, est exploitée pendant de longues années. Keleydar de Mahmoud Dowlatâbâdi, bien qu’éloigné de ces premiers romans, en reprend certains traits qu’il hérite de la tradition narrative persane. Même de plus jeunes auteurs, après la révolution de 1979, sont encore tentés par le genre historique. On peut citer Amir-Hasan Tcheheltan (né en 1955) ou Rezâ Jowlâï (né en 1960). Même un Houshang Golchiri n’hésite pas, dans une partie de son œuvre, à jouer avec l’histoire (Chronique de la victoire des Mages, C.Balaÿ tr. Paris l’Inventaire 1997). En un sens, le roman persan suit une trajectoire assez semblable à celle du roman européen, qui revient régulièrement à l’histoire à laquelle il est lié dès son origine. S. Hedâyat, lui aussi, quoique dans un autre genre, celui de la nouvelle, évoquera l’histoire de l’Iran (L’ombre du Mongol, Le dernier sourire, C. Balaÿ tr., Paris, Phébus,1998).
3. Roman et société
(Le roman de mœurs, la critique sociale, l’éducation)
Très tôt dans le siècle, les romanciers, peut-être encore sous l’influence des romans français - on peut citer l’immense succès des Misérables de Hugo, traduit dès 1909 dans la revue Bahâr - les romanciers persans observent et décrivent les problèmes que pose à la société de leur temps la question de la modernité. C’est l’époque où la ville commence à prendre son ampleur, où les techniques modernes font leur entrée dans le champ social : l’automobile, le télégraphe, la photographie, le cinéma. L’imprimerie se développe considérablement et la typographie s’installe définitivement. Le système éducatif continue sa lente transformation. Les voyages à l’étranger sont fréquents. La plupart des auteurs des années trente quarante ont vécu en Europe pendant quelque temps (Dehkhodâ, Jamâlzâdeh, Hedâyat, Alavi, Beh-Azin, …).
La modernisation de la vie courante, l’urbanisation, le progrès des communications, l’impact du modèle étranger, contribuent à une transformation profonde des mœurs et des valeurs sociales. On peut lire les conséquences de cette crise dans de nombreux romans des années 20-40. (Mortezâ Moshfegh Kâzemi, Rabi’ Ansâri, Hedjâzi, ’Abbâs Khalili, Jahângar Jalili, Mohammad Mas’oud (Dehâti) ou encore ’Ali Dashti. Parmi eux, Mohammad Hedjâzi tient un rang peut-être plus éminent. En effet, tout en décrivant les problèmes moraux et sociaux de son temps (condition des femmes, pauvreté, ambition politique, hypocrisie sociale) et de façon plus générale l’émancipation de la classe moyenne séduite par la modernité, l’auteur sait construire des romans solides et camper des personnages vivants. On est loin avec lui du récit traditionnel et l’on peut mesurer le chemin parcouru par la prose littéraire persane moderne. Chez Hedjâzi, tous les thèmes se croisent dans de riches intrigues qui mêlent le social, le politique et le philosophique. Kâmshâd conclut cependant par un jugement plutôt sévère sur l’œuvre du romancier dont il fait le symbole de l’échec d’un certain « romantisme persan » qui ne parvient pas à assimiler une influence occidentale ni à conserver dans sa pureté l’héritage de sa tradition. Ce jugement, si sévère soit-il, ne manque pourtant pas de justesse et pose dès les premières décennies du XXe siècle en Iran, le problème de l’hypothétique synthèse en littérature persane de la modernité et de la tradition.
Conclusions : limites du champ littéraire, du conflit de la tradition et de la modernité
Le roman persan du début du XXe siècle, se situe donc au carrefour de plusieurs influences ; il naît de plusieurs courants qui traversent le XIXe siècle, celui des Qâdjârs, dont l’esthétique se définit à la fois comme une réinterprétation de la tradition persane immédiatement précédente (l’héritage des Safavides) et une adoption enthousiaste de la culture européenne dans certains de ses aspects : architecture, modes vestimentaires, courants de pensée, langues et langages, formes littéraires… Le roman est emprunté tel quel, via les traductions et réinterprété dans une tradition narrative fort ancienne mais plutôt abâtardie : entre Amir Arsalân, Romouz-e Hamzeh, Samak-e Ayyâr et par exemple le Dârâb-Nâmeh, on mesure le degré de transformation dans les structures archétypales du récit persan. Le roman vient à point pour redonner souffle et « mettre en conformité » une société qui bascule dans le monde moderne et ses moyens d’expression. L’étude du roman persan, depuis le début jusqu’à la fin du XXème siècle de l’ère chrétienne, montrera ce travail progressif et inéluctable de la forme romanesque qui cherche, à chaque étape de l’histoire de l’Iran moderne, à s’adapter, à proposer sans cesse de nouvelles formules qui répondent aux interrogations de la société, au fur et à mesure de ses évolutions.
4. Un pionnier : Mohammad Bâgher Mirzâ, Khosravi
Mohammad Bâgher Mirzâ, dit Khosravi (1849-1920), est une des toutes premières figures de la littérature persane moderne, le premier romancier du XXe siècle. Sa vie et son œuvre sont intimement mêlées à l’histoire culturelle, politique et sociale de la période constitutionnelle. Son nom est surtout lié à sa trilogie romanesque Shams o Toghrâ qui paraît à partir de 1909. Comme l’écrit Rashid Yâsemi dans l’introduction de la deuxième édition (Mohammad Ramezâni, Khâvar éd., Tehrân, 1329/1950), Khosravi est une des grandes figures morales et intellectuelles qui ont construit l’Iran moderne, dans des conditions difficiles, et souvent au mépris de leur bonheur et de leur liberté. Il laisse le souvenir d’un homme d’une grande érudition, à la fibre pédagogique et d’une étonnante modestie. Certains éléments de sa vie peuvent être reconstitués à partir de l’autobiographie qui clôt son Tazkereh-ye Eqbâl-Nâmeh (18 moharram 1319 h.q./1901). La préface de la deuxième édition (pp. 3-16) reprend les éléments essentiels de cette autobiographie en les complétant pour la dernière partie de la vie de l’auteur.
Biographie succincte
Mohammad Bâgher Mirzâ, Khosravi de son nom de plume, est né le 24 Rabi’al-sâni 1266 h.q./1849 à Kermânshâh dans une famille aristocratique. Son père est le Prince Mohammad-Rahim Mirzâ, fils de Mohammad-’Ali Mirzâ Dowlatshâh, fils du Khâghân de Fath-‘Ali Shâh Qâdjâr. Khosravi naît quelques années avant que n’éclate la révolution constitutionnelle, et c’est dans cette période particulièrement troublée de l’histoire de l’Iran, mais aussi d’une grande effervescence culturelle et idéologique, qu’il a vécu. Comme il l’écrit lui-même, il passe les trente premières années de sa vie dans son milieu familial. Reconnu comme poète, il doit son surnom à l’homme de lettres et poète de Kermânshâh, Hossein-Gholi Khân Soltâni Kalhor. ہ la mort de son père, il vit un an à Téhéran puis regagne Kermânshâh où il gère pendant cinq ans l’administration des Postes et Télégraphes. Puis il s’en retire et vit, comme il dit, une vie de reclus, loin du monde et du bruit, qu’il consacre aux études savantes et à la littérature.
Ses qualités morales et sa haute culture sont appréciées par le gouverneur de la province du Kermânshâhân ‘Alâ-od-Dowleh qui l’attache à son service. Envoyé en mission dans la province du Fârs, le Prince l’emmène dans sa suite. C’est, pour Khosravi, l’occasion d’augmenter son bagage culturel et d’approfondir ses connaissances sur le berceau de la culture persane ; cela formera plus tard la matière essentielle de son futur roman Shams o Toghrâ.
Des questions familiales l’ayant rappelé à Kermânshâh, c’est dans cette ville qu’il vit les premiers jours de la révolution constitutionnelle. Khosravi se lance avec enthousiasme et conviction dans ce mouvement de libération démocratique et très tôt, il s’engage dans l’action politique en devenant membre d’un anjoman : le club Velâyati de Kermânshâh. L’opposition conservatrice de la ville le contraint à s’exiler plusieurs fois et à mener une vie errante. Ses attaches terriennes lui prodiguent la protection nécessaire, en particulier dans les villages de Mâhidasht. C’est dans cet exil que Khosravi commence la rédaction de ce qui deviendra la trilogie de Shams o Toghrâ, et qu’il fit la connaissance du Prince Sâlâr-od-Dowleh, qui eut sur lui une grande influence.
Pendant la guerre de 1914, les provinces de l’Ouest de l’Iran sont le théâtre des rivalités anglo-russes, et le patriotisme de Khosravi le range aussitôt parmi les partisans de la résistance. Après une période de lutte clandestine, il est arrêté par les Russes et envoyé à Téhéran. La protection d’Amir Afkham lui évite l’exil auquel il était promis au Sistân ; il est simplement assigné à résidence à Téhéran. Le poète romancier y finira sa vie dans la discrétion, se consacrant à l’étude et à l’érudition jusqu’à sa mort, en 1920.
Œuvres de Khosravi :
-Dibâ-ye Khosravi, un recueil biographique des lettrés arabes et poètes pré et post-islamiques.
-Shams o Toghrâ, roman historique en trois volumes (le deuxième intitulé Mâri-e Venisi et le troisième Toghrol o Homây). L’ouvrage a été rédigé pendant l’année 1325 h.q./1906-7 et édité avec le soutien de Mo’tazed-od-Dowleh Kermânshâhâni, 1909-1910, 3 vol. 198+127+240p. 2° édition en, Ent. Khâvar, Tehrân, 1329/1950, 3 vol. 300+156+247p. ; 3° édition, Ent. Koushesh, Tehrân, 1374/1995, 1 vol. 548p. ; 4° édition, Ent. Kowsar, Tehrân, 1380/ 2001, 1 vol., 600p.
-Hossein-Gholi Khân Jahânsouz Shâh Qâdjâr, biographie romancée d’un des premiers princes qâdjârs.
-Resâleh-ye tashrih al-E’lal, traité de poétique et de métrique.
-Eghbâl Nâmeh, Biographie d’Eghbâl-od-Dowleh Kâshâni, de la famille Ghaffâri et des poètes de Kermânshâh pendant le gouvernorat du Prince, accompagné d’une anthologie de leurs panégyriques.
-Al-Hey’at al-Eslâm, traduction du traité d’histoire musulmane de Mohammad-’Ali Shahrestâni.
-Divân, l’œuvre poétique de Khosravi, éditée à Téhéran en 1304/1925. 2° édition, Rashid Yâsami, Tehrân, Ent. Mâ, 1363/1984.
5. Quelques romans historiques / Analyses
Mohammad Bâgher Khosravi : Shams-o Toghrâ (1909-10)
Shams-o Toghrâ se présente comme une trilogie (trait caractéristique des premiers romans persans, influencés par le modèle du feuilleton français, en particulier A. Dumas) : Shams-o Toghrâ, Mâri-e Venisi, Toghrol o Homây. De fait, la partie la plus réussie est la première et, jusqu’à un certain point, la deuxième. Mais la troisième semble une redite. L’argument est simple : Shams, héritier d’une dynastie iranienne du Fârs, les Deylamites, tombe amoureux d’une princesse mongole lors de l’incendie du bazar de Shirâz. L’histoire se déroule donc dans le Fârs du XIIIe siècle, sous les Ilkhânides. Shams et Toghrâ se trouvent confrontés à un amour impossible au point de vue politique. Le roman est la quête inépuisable de cette impossibilité, avec son cortège d’obstacles et de bonnes fortunes, de complices et d’ennemis. La grande figure politique du roman, tantôt hostile, tantôt amicale, est Abesh Khâtoun, l’Atâbeg de Fârs. Elle tombe amoureuse de Shams et l’épousera secrètement. Les aventures de Shams l’entraînent dans tout l’Iran, du sud au nord, et le conduisent jusqu’en Egypte, dans la pure tradition du roman grec antique. Khosravi a beaucoup puisé chez Dumas, en particulier dans Le Comte de Monte Cristo et Les Trois mousquetaires. Mais il faut lire aussi dans cette première trilogie romanesque en persan moderne, la trace du roman populaire persan traditionnel. En ce sens, Shams est autant l’héritier d’Amir Arsalân que d’Edmond Dantès. Cela dit, le traitement de la psychologie des personnages - celle des personnages féminins en particulier -, l’analyse sociopolitique contextuelle et l’émergence de l’individu sont des signes très clairs de la modernité du discours narratif.
Le roman s’organise principalement autour des deux personnages du titre. Il pourrait fort bien se clore avec la mort de Toghrâ, peu avant la fin du premier tome. Il n’en est rien cependant. Car, au cours du deuxième tome, les éléments d’une suite possible sont fournis avec l’apparition de Marie la Vénitienne (qui apparaît nominalement au dernier chapitre du premier tome). La vie conjugale de Toghrâ est marquée par la présence de deux rivales : Marie et Abesh Khâtoun. Pour des raisons qui tiennent en partie au caractère de Toghrâ (sa chasteté), celle-ci n’aura pas d’enfant de Shams. Sa disparition est donc compensée par l’apparition de Marie qui donne l’héritier attendu : Toghrol, selon le vœu de la princesse défunte. Suivant un procédé classique d’enchaînement, le IIe tome s’achève sur l’entrée de Homây dans le champ du récit, annonçant le thème du IIIe tome. Celui-ci est en grande partie consacré aux amours de Toghrül et Homây, ainsi qu’à la clôture des séquences ouvertes au cours des deux premiers tomes. Le récit pourrait bien finir avec les noces de Toghrol et Homây, mais ici encore, le narrateur poursuit jusqu’au bout toutes les séquences ouvertes. Le procédé n’est pas sans rappeler la technique des Mille et Une Nuits. Ce n’est que lorsque l’ensemble des personnages ont trouvé soit satisfaction dans leur quête amoureuse, soit la mort, que le roman peut enfin se clore. Il reste néanmoins ouvert : qu’adviendra-t-il de Shams, toujours vivant ? De Marie et du jeune couple ? Il y aurait là matière à d’autres suites. Mais, habilement, le romancier trouve sa conclusion dans la mort du Sheykh Sa’di, le grand poète soufi de Shirâz, qui a accompagné les héros du IIIe tome. C’est donc sur le temps de l’Histoire et non celui de l’histoire que se fonde la logique du récit. Ce décalage, sans qu’il y paraisse, désigne la nouveauté dans la conception du roman : une mutation opérée en profondeur malgré le poids de la tradition.
Sheykh Mousâ Nasri : ‘Eshgh o saltanat (1919)
On ne sait pas grand-chose sur l’auteur de la trilogie intitulée L’amour et l’empire qui relate la vie de Cyrus le grand. On sait seulement qu’il était natif d’Hamedân où il fut directeur du Lycée Nosrat. Un pédagogue, donc, ce qui ressort clairement des trois tomes d’Eshgh o Saltanat. Sur ce roman, la critique est partagée. Manuel d’histoire en forme de roman, écrit Machalski [1]. Kâmshâd [2] le trouve trop soucieux de précision historique, trop attentif aux questions terminologiques (trop de noms européens) mais sans grand souci des niveaux de langue des personnages. Browne [3] lui reproche son didactisme outrancier. Aryanpour [4] reprend un peu toutes ces critiques. Pourtant, l’entreprise n’est pas dénuée d’intérêt. L’auteur a le sens de la structure romanesque. Il étend son récit de la naissance de Cyrus à la chute de Babylone et a l’habileté de finir chacun des trois tomes de sa trilogie en croisant l’histoire et le récit, le temps humain universel et celui des destins individuels. Une lecture globale du roman montre un dessein ambitieux, certes, mais clair et solide. On aurait tort de juger ce type de roman du seul point de vue de l’authenticité historique ou de celui des orientalistes philologues. Il faut au contraire y lire un grand effort pour adopter (et adapter) en persan un genre littéraire étranger encore insuffisamment maîtrisé, mais dont on voit qu’il porte les traits du changement social en Iran. Le roman de Sheykh Mousâ a été conçu comme un tout. Les différentes séquences narratives sont parfaitement imbriquées pour répondre à la définition du titre : amour et empire. C’est, en effet, la conjonction de ces deux éléments qui constitue la trame du récit : L’avènement de Cyrus roi de Perse et de Médie, vainqueur du royaume de Lydie, en Asie Mineure, puis de Babylone constitue la toile de fond historique indispensable, mais n’assure pas à elle seule la cohésion interne du roman. Les amours de Cyrus et d’Asanpouy, celles de Cyaxare et de Jupiter, celles d’Hormoz et d’Eurydice, celles, enfin, de Farrokh et de l’Egyptienne, complètent de façon essentielle la structure du roman. Toutes ces séquences, le fait est remarquable, s’amorcent dès la fin de la première partie. Mais, fait non moins remarquable, leur degré de présence dans la première partie, est décroissant. Chacune des trois parties se clôt dans cet ordre sur une ou deux de ces séquences. Ainsi est assurée la progression du récit qui suit deux lignes parallèles : l’histoire de la conquête du pouvoir par Cyrus et l’histoire amoureuse de quelques grandes figures historiques. L’histoire des amours de Cyrus progresse parallèlement à son accession au trône de Perse et de Médie ; celle de Cyaxare à la conquête de Lydie (chute de Crésus roi de Sarde) ; celle d’Hormoz à la conquête de l’Asie mineure et de Babylone ; celle de Farrokh, à la chute de Babylone. Le romancier a bien compris la tâche du roman : particulariser l’Histoire. Il a fort bien saisi que sans intrigue, l’Histoire ne devient pas roman et que l’opération de littérarisation passe par celle de la configuration. ہ ce stade, le roman de Sheykh Moussâ présente une structure harmonieusement conçue et dynamique. C’est un tout cohérent.
‘Abd-ol-Hossein San’atizâdeh Kermâni : Dâmgostarân, yâ enteghâm-khâhân-e Mazdak (1920)
Le roman de San’atizâdeh, « Les trappeurs, ou les vengeurs de Mazdak », pose un problème d’histoire littéraire. En effet, on a mis en doute la paternité des premiers romans publiés sous le nom de cet auteur : Dâmgostarân et Mâni-e naqqâsh (Mâni le peintre). C’est la thèse que soutient Fereydoun Âdamiyat [5]. Ses arguments semblent confirmés sur ce que nous savons de la vie de San’atizâdeh. Fils d’une famille bourgeoise de Kermân, ruinée à cause des idées démocrates du père, le jeune Kermâni est élevé dans une quasi misère, son père étant exilé pendant plusieurs années à Istanbul où il sert de secrétaire à Mirzâ Aghâ Khân Kermâni et Sheykh Rouhi, ses concitoyens, deux brillants intellectuels de la diaspora iranienne d’Istanbul, connus pour leur intimité avec le mouvement religieux babiste. Ces deux opposants au régime qâdjâr sont extradés puis exécutés à Tabriz, après l’assassinat de Nâssereddin Shâh. C’est justement à cette période que le père de San’atizâdeh rentre à Kermân, avec une partie des papiers des deux intellectuels. [6] Or on sait, d’après Mirzâ Aghâ Khân lui-même, qu’il aurait rédigé plusieurs récits historiques (on ignore sous quelle forme), qui restent inédits, et peut-être perdus, comme une bonne partie de ses œuvres. D’autre part, une analyse des thèmes de Dâmgostarân comme de Mâni-e naqqâsh, révèle une paternité intellectuelle peu discutable du grand intellectuel sur ces œuvres (mazdakisme [7], anti-islamisme, laïcité…). Mais surtout, ce qu’on sait de San’atizâdeh par son autobiographie est en totale contradiction avec ces éléments : il aurait rédigé ces ouvrages à l’âge de quinze ans, chose peu crédible de la part d’un jeune adolescent éduqué dans la rue et qui ne peut avoir atteint une telle maturité littéraire, un tel degré de connaissance historique. Le plus ironique est le fait que l’auteur, au chapitre 27 de la IIe partie (p. 77) cite clairement ses sources en nommant Mirzâ آghâ Khân Kermâni. Enfin, les œuvres postérieures de San’atizâdeh montrent un grand affaiblissement du traitement de l’histoire et un changement radical dans la thématique (par exemple : Comment devenir riche, ou Rostam au vingtième siècle). Il faut donc revoir les analyses qui ont été faites de Dâmgostarân dans l’hypothèse où San’atizâdeh aurait repris en l’adaptant, tout ou partie d’un texte rédigé par Mirzâ آghâ Khân. Si on retenait cette hypothèse, Dâmgostarân, publié en 1920, mais rédigé une première fois à la fin du XIXe siècle, serait le premier roman historique en date de la littérature persane moderne.
Ce roman relate la fin de la dynastie sassanide avec la mort de Yazdegerd III et l’invasion de l’Iran par les Arabes musulmans. L’idée centrale est que cette chute de l’empire sassanide serait une vengeance du parti mazdakite (d’où le sous-titre) qui aurait facilité la pénétration des Arabes en Iran. Le récit, avec les ingrédients habituels du genre du roman d’aventures (pièces secrètes, trésors, intrigues…) présente une structure narrative complexe avec des analepses et des inclusions qui révèlent non seulement une bonne technique romanesque mais aussi une connaissance approfondie du roman européen (ce que Mirzâ آghâ Khân Kermâni possède, du fait de sa grande expérience de la traduction littéraire). [8] La portée idéologique du roman est assez évidente et le parallélisme entre la chute historique des Sassanides et celle, espérée, des Qâdjârs, est très clair ; le tout, sur fond de querelles religieuses aisément transposables au contexte de la mashroutiyat (mouvement constitutionnel).
On peut s’étonner du choix d’un sujet historique qui ne flatte guère l’orgueil national iranien et, partant, se trouve plutôt anachronique dans le contexte idéologique de l’Iran des années 20, marquée par la montée du nationalisme. C’est peut-être un signe supplémentaire que ce roman ait été écrit bien avant cette période, et pour des motifs tout autres que le nationalisme. L’analyse de la structure du récit permet de déceler certains de ces motifs. Cette structure repose sur deux lignes centrales qui se rejoignent finalement après s’être croisées plusieurs fois : la conquête arabe et les soubresauts de la monarchie iranienne devant cet ennemi imprévu ; le complot mazdakite, qui fait contre la monarchie une alliance objective avec la cause musulmane dans son projet de révolution. Certes le roman mêle événements historiques parfaitement vérifiables et éléments fictifs, au service d’une idéologie. Par exemple, faire de Hormozân (qui fut historiquement le gouverneur du Khouzistan) le fils de Yazdegerd et un adepte du mazdakisme est un tour habile de la part de l’auteur qui peut ainsi joindre les deux lignes de son drame en présentant la chute des Sassanides comme une revanche et une vengeance du parti mazdakite, florissant dans la première partie du règne de Ghobâd Shâh (488-98), anéanti sous Khosrow Anoushirvân. C’est, bien sûr, récrire l’histoire pour soutenir une thèse : la décadence des Sassanides est due à l’emprise croissante du clergé zoroastrien sur la monarchie et sur l’Iran. D’après l’auteur, seul le mazdakisme pouvait lutter contre ce cléricalisme corrupteur. L’islam, avec l’alliance mazdakite, sort le pays de l’ornière et libère le peuple de son joug. ‘Omar, certes, est décrit comme un homme simple et juste. Son fanatisme, cependant, lui fait brûler la bibliothèque de Ctésiphon en détruisant à la fois les racines du mal (le zoroastrisme) et l’ancienne culture iranienne. La mort que lui inflige Hormozân sera son châtiment.
De son côté, Hormozân, voyant l’Iran en danger et constatant la trahison des mazdakites, ses amis, qui livrent le pays à l’ennemi arabe, se montre vrai patriote et abjure sa foi mazdakite, malgré tout l’amour qu’il porte à la belle آftâb. L’intrigue amoureuse, élément obligé de tout roman de ce genre, est peu développée. C’est tout juste si elle occupe deux ou trois chapitres (essentiellement les chapitres 5 et 24). Dâmgostarân est donc plus marqué par l’anticléricalisme que par le nationalisme. Il faudrait plutôt parler ici de patriotisme. Un patriotisme nourri par une pensée critique violente et guidé par un regard « de l’extérieur ». Il n’y aurait rien d’étonnant à ce que l’auteur de ce roman eût été précisément Mirzâ آghâ Khân Kermâni, écrivain en exil à Istanbul, penseur de la révolution constitutionnelle et passionnément démocrate. Par conséquent, un défenseur probablement plus adéquat des idées mazdakites qu’un jeune San’atizâdeh, dans les années 1920.
6. Le roman historique après le coup d’Etat de 1921
Après le coup d’Etat de Rezâ Khân et de Seyyed Ziâ, l’atmosphère sociale, politique et culturelle en Iran se transforme rapidement. Le nationalisme de la mashroutiat, lié aux idées démocratiques et révolutionnaires, s’exacerbe dans un contexte international oppressant. L’Iran est pris en tenaille entre le bloc soviétique au nord, et l’Angleterre au sud. Le nouveau pouvoir doit montrer un sens aigu de la diplomatie à l’extérieur, et faire usage de la force à l’intérieur pour assurer la cohésion de la nation et son intégrité. Le roman historique de cette nouvelle époque reflète ces efforts, ces luttes, cette reconstruction nationale, comme les contradictions, les peurs et les failles d’une société en pleine redéfinition. Il offre une fois de plus le refuge de l’histoire où la nation vient puiser dans les mythes antiques, mais parfois dans une histoire plus récente, les éléments de cette reconstruction. Certes, on a parfois du mal à distinguer entre roman historique et essai historique romancé. Néanmoins, chacun à sa manière, la plupart du temps sous la forme de feuilleton dans la pléiade de périodiques qui fleurissent à cette époque, tente d’ajouter sa pierre à l’édifice du genre littéraire et au débat d’idées.
’Abbâs Ayanpour Kâshâni (1906-1984) dans ‘Arous-e Medi (La fiancée mède, 1929), Hassan Pirniâ dans Târikh-e Irân-e bâstân (Histoire de l’Iran ancien, 1932), écrivent l’histoire des débuts de l’Iran, qu’ils revêtent des habits du roman. ‘Ali Asghar Rahimzâdeh Safavi (1894-1958) dans Shahrbânou (1926), reprend le thème de la chute des Sassanides, comme l’avait fait Dâmgostarân. On peut lire en filigrane dans ce récit les événements qui marquent la période postérieure au coup d’Etat, la prise du pouvoir par Rezâ Khân et l’exil d’Ahmad Shâh Qâdjâr en Europe.
D’une qualité comparable à celle de Rahimzâdeh Safavi, les romans de Heydar ’Ali Kamâli méritent une égale attention. Après la parution en feuilleton de Mazâlem-e Torkân Khâtoun (1927) dans la revue آyandeh, qui traite de l’invasion mongole, Kamâli publie un deuxième roman, Lâzikâ (1930), qui prend pour thème les guerres entre les Romains et les Sassanides au Caucase. L’auteur s’attache à montrer à son tour comment les luttes épuisantes entre les deux empires conduisirent à la chute des Sassanides, préparant ainsi l’invasion arabe musulmane.
Avec cette nouvelle génération de romans historiques, on a laissé derrière soi la mashroutiyat et la dynastie qâdjâre pour aborder l’ère pahlavi. L’Iran, sous la botte du nouveau monarque, se reconstitue politiquement, économiquement, socialement, et aussi culturellement. Le roman de Kamâli, sur fond de conflit entre Romains et Sassanides, traite en fait des grandes questions qui courent dans cette période moderne d’entre deux guerres : en particulier celle de l’indépendance territoriale de l’Iran et celle de la laïcité. Au plan des formes littéraires et des structures narratives, ce roman - par ailleurs très court - n’offre pas de réelle avancée par rapport aux romans de la première génération.
Lâzikâ, capitale du Lâzestân (l’ancienne Colchide où, dit-on, naquit Médée, et qui fut le but de l’expédition des Argonautes, région caucasienne située sur les bords de la Mer noire), est le titre du roman de Heydar Kamâli (1871-1936), et l’on ne voit guère pourquoi. En effet, ce lieu n’est guère mentionné que dans deux chapitres de ce roman (ch. 1 et 12) au tout début, pour indiquer l’éloignement de Bahrâm et Bijan, les deux héros en guerre contre les Romains, et un peu avant la fin du roman, pour constater le désastre de l’armée perse défaite par les armées romaines.
L’intérêt est manifestement ailleurs. Le roman se déroule principalement dans deux villes d’Azerbaïdjan : Ganzak et Ardebil, et pour un ou deux chapitres à Constantinople (Rum) où Bahrâm est retenu prisonnier et Ctésiphon, où réside la cour de Khosrow Anoushirvân. Les événements historiques, c’est-à-dire la guerre des Perses contre les Romains, servent de toile de fond au roman, et cela pour une petite moitié des chapitres (1, 8, 11, 12, 13, 14). Ils jouent un rôle purement fonctionnel : justifier l’éloignement ou le rapprochement de certains personnages, en particulier le retour de Bijan de Lâzikâ à Ganzak, sur lequel est fondée l’intrigue essentielle, le complot de Farshid contre la famille d’Esfandyâr.
La deuxième séquence du récit –les amours de Bahrâm et de Paridokht, élément obligé du roman d’aventures, est traitée de façon encore plus succincte. Paridokht y joue un rôle tout à fait passif. Jamais les fiancés ne se rencontrent, si ne n’est à la fin, lorsque Bahrâm, accompagné de Bijan, rentre à Ganzak. Leurs relations se bornent à un épisodique contact épistolaire. Manifestement, le rôle de Paridokht se déploie ailleurs, c’est-à-dire dans la séquence centrale : le conflit qui oppose Farshid et Bijan. Là, le personnage de Parikokht prend toute son ampleur, non comme fiancée de Bahrâm, mais comme sœur de Bijan, pour la libération duquel elle lutte de toutes ses forces jusqu’à la fin. Tout le roman de Lâzikâ repose sur ce conflit qui oppose la classe des prêtres à celle des soldats-chevaliers. Il se termine par la défaite du clergé et la victoire de l’aristocratie. La portée idéologique de ce récit est à peine masquée par le décalage historique. Le combat de Farshid, prêtre zoroastrien, est celui du clergé soucieux de préserver voire d’accroître son influence dans l’organisation sociale et politique ; celui de Bijan, Parikokht, Mehrân, Fariborz etc., la réaction farouche d’une aristocratie jalouse de ses prérogatives. Au deuxième plan, bien entendu, se profile l’horizon politique de Rezâ Shâh, marqué par l’émergence d’un nouveau système de société, laïque, fondé sur la séparation des pouvoirs, héritage direct de l’idéologie de la mashroutiyat.
Avec Dalirân-e Tangestâni (Les preux du Tangestan, 1931), on atteint la limite du genre. Mohammad-Hossein Roknzâdeh آdamiyat fait un récit qui hésite entre la chronique historique et le roman, avec un penchant très net pour la première. Utilisant une documentation privée, familiale, il a bien du mal à faire passer les textes de leur état brut documentaire à celui de figures littéraires. Le récit relate les événements qui suivirent la guerre de 14-18 dans le Golfe persique : l’invasion anglaise et la révolte des sheikhs. L’œuvre est dédiée à la gloire de Rezâ Shâh, libérateur qui reconquiert l’unité de l’Iran, aux dépens du système tribal et clanique du pays, et cela au profit de la centralisation de l’Etat. Ici, la trame romanesque est d’une certaine fragilité. On est loin des premiers romans historiques tels qu’ils se perpétuent encore quelques années, mais sur le mode divertissant, dans les longs romans-fleuves publiés en feuilleton.
La toile de fond historique est tendue dès le premier chapitre du roman : les Anglais envahissent l’Iran. Profitant de la faiblesse du gouvernement iranien, ils investissent le port de Boushehr, mais ils rencontrent une résistance farouche chez les seigneurs locaux. Historiquement, le roman décrit les ultimes soubresauts de la féodalité, son baroud d’honneur, et la prise du pouvoir par Rezâ Khân, esquissée dans le dernier chapitre. La trame romanesque se tisse sur quelques destins particuliers. Celui de Ra’is-‘Ali se détache avec plus de netteté que les autres. Il est le seigneur qui lutte et meurt au combat contre l’Anglais. Il lance le mouvement de la révolte, provoque les forces anglaises, leur inflige leurs premières pertes sensibles, se rallie généreusement aux autres sheikhs entrés à leur tour dans la lutte. Il meurt d’une balle iranienne, non anglaise ; signe des conflits internes et des rivalités féodales. De la même manière, Sheikh Hossein meurt sous les coups des Iraniens, les troupes de Daryâbeygi, gouverneur de Boushehr, forcé d’exécuter les ordres des Anglais. Sheikh Zâher meurt assassiné, toujours à l’instigation des Anglais, des mains d’un autre sheikh rival, traître à son pays. L’histoire de Seyyed Mehdi offre un autre trait caractéristique : la présence historique des libéraux démocrates (les constitutionnalistes), nationalistes et anti-Anglais. Cet aspect de l’histoire est typifié par le conflit qui oppose Seyyed Mehdi le patriote et Hâjj Mohammad-Hossein le « collabo ». Celui qui tire les ficelles dans cette histoire est le vice-consul britannique Mr. Chick.
Une dernière remarque s’impose quant à l’aspect documentaire du roman. Le narrateur s’applique consciencieusement à donner de nombreuses preuves de l’authenticité de son récit, non seulement en introduction mais aussi dans le texte même, intervenant pour indiquer qu’il était présent à telle scène et à telle époque et qu’il garantit l’exactitude des renseignements fournis, ou bien parfois ajoutant en note qu’il possède les documents utilisés ou livrés à l’état brut dans le roman (par exemple le discours de Sheikh Hossein avant la bataille contre Daryâbeygi). Ceci pose la question du genre littéraire. S’agit-il d’un document d’histoire ? De l’Histoire ? La figuration de l’Histoire dans l’histoire, c’est-à-dire le récit ? Cela pose aussi la question du temps du récit et de l’Histoire (l’épaisseur du quotidien, la vitesse et le rythme narratif…) L’aspect le plus frappant reste la quasi absence d’intrigue. Les événements historiques sont disposés en grappes, de façon plutôt disparate ou artificielle. Cependant, l’articulation des histoires sur l’Histoire et l’effort évident de caractérisation ouvre le récit sur le monde du réel. La tension qui demeure entre tant d’éléments dispersés, cette ligne qui se définit malgré tout au sein d’un univers éclaté, désignent un trait du roman moderne : l’illusion romanesque d’une intégration du multiple dans l’unique, de l’universel dans l’individuel. Pendant les deux décennies qui suivent (30-50) le roman historique fait florès dans les revues et journaux, en feuilleton ou en édition. Il se teinte progressivement d’un néo-romantisme qui fera une cible idéale pour l’ironie d’un Sâdeq Hedâyat (Vagh Vagh sâhâb, « Ghazieh-ye român-e târikhi », 1934) après que l’écrivain se sera essayé lui-même, non sans succès, dans le genre historique, mais dans le genre de la nouvelle, en compagnie de Bozorg ’Alavi et Shin Partow (‘Ali Shirâzpour Partow, 1907-1997) dans un recueil intitulé Anirân (Les barbares, 1931). [9]
7. Le roman de mœurs (ou social)
Le phénomène naît officiellement (c’est-à-dire pour la critique) en 1922, avec la parution de Tehrân-e makhouf, l’ouvrage de Mortezâ Moshfegh Kâzemi (1902-1977). Le roman est publié tout d’abord en feuilleton dans le journal Setâreh-ye Irân, puis l’ouvrage est édité en 1924. Il a été traduit en russe (1964) et en turc [10]. On peut toutefois s’interroger sur cette opinion. N’y a-t-il pas du roman social dans Le journal de voyage d’Ebrâhim Beyg de Zeyn-ol-’آbedin Marâgheh’i ? Dans le Livre d’Ahmad de Tâlebof Tabrizi ? Sans doute, les conditions de production de ces romans changent radicalement à partir de 1921. La situation politique et sociale invite les jeunes romanciers à se préoccuper de leur vie quotidienne, à répondre aux questions que se posent leurs contemporains. Ils bénéficient en outre d’une réflexion déjà bien développée dans les revues littéraires et les journaux des deux décennies précédentes. L’interrogation de l’histoire ancienne ne suffit peut-être plus tout à fait à cette jeune génération de journalistes et d’intellectuels. Le phénomène est loin d’être marginal. En vingt ans, le nombre des romanciers atteint le chiffre de cinquante pour une production romanesque dans ce genre de 160 titres. [11]
Téhéran, la capitale, et sa bourgeoisie, font leur entrée en littérature. Le cadre de Tehrân-e makhouf est celui de la décadence et de la fin de la société qâdjâre, puis de la chute de Téhéran devant les Cosaques (1922-1925).
Moshfegh Kâzemi est un jeune journaliste formé en Allemagne qui, après avoir collaboré aux revues Shahr et Farangestân à Berlin, collabora à la revue Irân-e Javân à Téhéran. Son roman, malgré quelques faiblesses de structure, est une réelle avancée du roman persan vers le réalisme. Non seulement on y trouve des descriptions de Téhéran (Les quartiers du centre-ville, les bars du sud, les fumeries d’opium, le quartier réservé, la citadelle, le village d’Evin au nord de la ville…) mais sont aussi décrits les modes de vie urbaine avec les hôtels, la circulation, les milieux aristocratiques et bourgeois etc. Aucun roman n’avait jusqu’alors poussé la description à ce point, dans le but de construire un « effet de réel », selon l’expression de Roland Barthes. En ce sens, Tehrân-e makhouf est le premier roman persan moderne vraiment réaliste. Il fera école. On peut considérer la plupart des romans dits sociaux des années 20-40 « comme de naïves imitations du premier et du plus célèbre des romans sociaux, Tehrân-e makhouf. » [12] On remarquera tout particulièrement les récits enclavés (nouvelles du type de celles qui s’insèrent dans le Don Quichotte de Cervantès), qui manifestent une indéniable compétence technique dans l’art du récit.
La structure de Tehrân-e makhouf repose sur l’histoire de Farrokh et Mahin, cousins germains, amoureux l’un de l’autre, mais séparés par les différences de fortune familiale. Le roman se compose de deux parties. La première raconte l’histoire des amours malheureuses de Farrokh et Mahin, jusqu’à l’exil de Farrokh et la mort de Mahin qui lui laisse un fils. Le père de Mahin, enrichi par la politique, va se servir de sa famille pour asseoir son influence. La jeune fille est donnée en mariage au Prince Siyâvash Mirzâ, viveur notoire. Dans une de ses promenades nocturnes, Farrokh sauve une jeune fille, ‘Effat, bourgeoise abandonnée par un mari ambitieux qui l’a vendue à des politiciens influents. Javâd recueille chez lui la jeune fille. Puis il retrouve Mahin, qui se meurt d’ennui et de tristesse. Les deux jeunes gens ont des rencontres secrètes auxquelles le prince met fin en faisant exiler Farrokh.
La seconde partie poursuit ces aventures avec le retour de Farrokh et sa vengeance. Celle-ci échoue. Mais Farrokh, qui a retrouvé ‘Effat, celle qu’il avait autrefois délivrée, reprend avec elle une nouvelle vie.
Malgré des faiblesses de structure liées à la jeunesse de l’écrivain qui sacrifie un peu trop sans doute au goût de son époque et à la mode des romans d’aventures à l’imitation des romans de Dumas (dont le Comte de Monte Cristo est manifestement ici le modèle), le récit de Moshfegh Kâzemi surprend par sa richesse thématique : la montée d’une bourgeoisie, concomitante à la chute de la dynastie qâdjâre et au développement des grandes villes, Téhéran en particulier. Le romancier est sensible à la misère des petites gens des villes, à la corruption des fonctionnaires, à l’exploitation des masses et à la fragilité de la condition féminine ; de même par le traitement des caractères, et l’analyse sociopolitique sur laquelle il construit son récit ; enfin par les intrigues secondaires, comme celle de Javâd, le pauvre jeune homme qui vient en aide à Farrokh, et les personnages féminins très bien analysés (Mahin, Malek Tâj, ’Effat, Jalâlat). Tous ces éléments font de Tehrân makhouf un premier exemple de réussite dans la construction du nouveau roman persan.
Dans cet entre-deux incertain du passage des Qâdjârs aux Pahlavis, l’effondrement du système socioculturel et la recomposition sociale, le roman de Moshfegh Kâzemi offre un panorama social, politique et culturel des plus saisissant, et même captivant. Le grand succès qu’il remporta auprès des lecteurs de l’époque, comme les nombreuses imitations qu’il suscita, confirment le rôle clé que joue ce roman dans l’évolution du roman persan du début du XXe siècle.
La condition des femmes
Parmi tous les romanciers iraniens qui se lancent dans l’écriture et marquent le règne de Rezâ Shâh, une figure se détache, celle de Mir Mohammad Hedjâzi [13] (1900/ 1973). Contrairement à bien de ses contemporains, il est le modèle de l’écrivain « carriériste ». Héritier d’une vieille famille de l’administration qâdjâre, portant le titre de Moti’-od-Dowleh, il jouit d’une bonne éducation bourgeoise, avec un précepteur, puis au Collège Saint Louis. Il fait à Paris des études supérieures en sciences politiques et dans les télécommunications. ہ son retour, il fait carrière dans l’administration et le gouvernement. Il sera ministre des Postes et Télégraphe. En 1937, au bureau Parvaresh-e Afkâr [14], il dirige la section presse et le journal Irân-e Emrouz (L’Iran d’aujourd’hui). Après l’abdication de Rezâ Shâh en 1941, il poursuit sa carrière à la Radio et au Département de la propagande. Il est élu sénateur. Hedjâzi romancier puisera dans cette vie professionnelle au service de l’Etat l’essentiel de son inspiration et la matière de son œuvre littéraire.
Homâ est l’histoire d’une vertueuse jeune fille de la moyenne bourgeoisie dont le tuteur, Hassan-‘Ali Khân, tombe éperdument amoureux. De son côté, Homâ est amoureuse du jeune Manoutchehr. Hassan-‘Ali, vu la différence d’âge, n’ose pas se déclarer dans un premier temps, mais l’apparition d’un rival l’oblige à se découvrir. Devant cet amour, Homâ décide de s’incliner. Mais Manoutchehr, avec la complicité d’un religieux peu scrupuleux sur la question morale, s’acharne contre Hassan-‘Ali. Ce dernier finit prisonnier des Russes, quand des événements extraordinaires le sauvent in extremis. Le roman trouve ainsi une fin heureuse.
L’intrigue de Homâ est construite sur le conflit de générations. Hassan-‘Ali, le plus âgé, l’emporte sur son rival Manoutchehr par la noblesse de ses sentiments. Dans ce récit, le romancier privilégie l’analyse psychologique, fait relativement nouveau dans le roman persan, mais cela au détriment de l’action. Cette analyse s’opère par l’insertion, dans le corps du récit, de lettres échangées entre les divers personnages ; procédé qui contribue à la structuration de l’espace du roman. Le dénouement de l’intrigue, néanmoins, manque de vraisemblance. L’auteur, pour conclure, ne semble pas pouvoir éviter le coup de théâtre, ce qui affaiblit considérablement l’effet de réel.
Le motif du journal intime joue ici un rôle essentiel ; non plus diégétique (dans la transmission du récit) mais intradiégétique : le journal d’Hassan-‘Ali Khân découvert par Homâ et lu à plusieurs reprises, permet à celle-ci - et partant au lecteur - de plonger son regard dans la conscience de l’homme qui aime. Cet élément modifie épisodiquement la focalisation omnisciente du récit en focalisation interne. Parallèlement à certaines faiblesses de structure, le récit donne les marques d’une forte modernité dans l’affirmation d’un nouveau statut du personnage et la redéfinition du rôle du narrateur.
Hedjâzi publie son deuxième roman, Paritchehr, en 1929 qui est aussi consacré à l’étude du cœur féminin et s’adresse encore une fois à la bourgeoisie moyenne et supérieure de son époque. Le parcours narratif en est simple : un homme tombe amoureux, ou plutôt se laisse entraîner sur la pente de l’amour-passion par une coquette. Ils filent le parfait bonheur quand un ami d’enfance surgit. La jalousie fait le reste. Cette histoire pourrait se terminer par un drame. Mais au contraire, elle se poursuit en se diluant dans une série d’événements extraordinaires, poncifs de romans d’aventure, un « remake » d’Amir Arsalân mâtiné de Hâdji Bâbâ. Le récit, après s’être engagé d’abord sur la voie du réalisme, dévie soudain et sans explication vers le merveilleux.
Le trait distinctif du récit, quoique sans originalité particulière, est encore le motif du journal intime, ou la confession, transmis par un voyageur de rencontre au narrateur de l’histoire. C’est un récit conduit à la première personne. Mais le procédé n’est qu’un travestissement dont l’auteur ne tire pas grand parti. C’est néanmoins un trait caractéristique de ces premiers romans des années 30, à l’imitation des Aventures de Hâdji Bâbâ et du Journal de voyage d’Ebrâhim Beyg, eux-mêmes héritiers du roman-journal du romantisme européen.
Hedjâzi atteint la plénitude de son art de romancier dans Zibâ qu’il publie en deux volumes (1930 et 1933) réunis plus tard en un seul (1948) [15]. Ce roman social, un des meilleurs de l’époque, met en scène la corruption d’une société mi-bourgeoise moderne, mi traditionnelle, en décrivant la carrière d’un garçon de la campagne, de toute petite bourgeoisie. Promis à une carrière de mollâ, Sheikh Hossein arrive dans la capitale pour y poursuivre ses études. Il y tombe aussitôt amoureux d’une courtisane et cette passion, partagée mais orageuse, détruira la vie du jeune homme après l’avoir artificiellement favorisée en le propulsant par l’intrigue et le crime vers les plus hautes sphères du pouvoir politique. Au terme de ses aventures, Sheikh Hossein se retrouve en prison. Selon un procédé romanesque bien connu, il remet à son avocat le récit de sa vie. Une vie tumultueuse minutieusement décrite, par laquelle le romancier brosse le portrait réaliste d’une société pourrie où les voleurs côtoient les ministres, où une courtisane décide de la politique. Une société sans morale, fondée sur le machiavélisme et l’opportunisme, et dans laquelle les valeurs et les cadres traditionnels ont volé en éclats. Comme dans Manon Lescot, le roman de l’Abbé Prévôt [16], dont Hedjâzi s’inspire manifestement pour écrire le sien, l’intrigue de Zibâ illustre le thème de l’amour fatal, de la déchéance morale du vertueux jeune homme, de son déclassement social. Cette intrigue, dans les deux cas aussi, est construite sur un journal intime, envoyé à un ami aristocrate par Des Grieux, et à son avocat par Mirzâ Hossein. Celui-ci rédige son journal en prison pour la première partie, et pour la seconde, à sa sortie de prison, quatre ans plus tard. Les dates sont un peu confuses, il est vrai. À quelle date Mirzâ Hossein est-il allé en prison ? Pour quel motif ? Cela reste obscur. L’avant-propos ne clarifie rien. L’auteur y indique (pure fiction ?) que les événements relatés par Mirzâ Hossein se passent "pendant les années qui précèdent 1920-21", qu’une partie a été rédigée en prison, pendant l’année 1316 (on suppose l’hégire lunaire, 1898) et la seconde en 1320 (hégire : 1902). La date de 1920-21 est donc tout à fait symbolique, et même politique, puisqu’elle indique que les événements précèdent le coup d’Etat de Rezâ Khân. Elle fait donc référence à une autre société, la société qâdjâre, dans sa décadence finale. On voit bien l’idéologie qui sous-tend cette datation.
Le contexte historique et politique du roman est celui de la mashroutiyat (la révolution constitutionnelle). La date de 1920 se justifie dans un plan général de l’auteur qui prévoyait des suites à ces mémoires (cf. Conclusion de la deuxième partie, p. 503 - éd. 1976 - et Avant-propos.). Un autre point assez obscur touche au récit lui-même, par rapport à cet emprisonnement. Il met directement en cause la valeur du temps diégétique, c’est-à-dire le rapport entre récit et histoire. Le récit est adressé par Mirzâ Hossein à son avocat. Une introduction indique cette intention sous forme de lettre (pp. 3-7) et le narrateur, Mirzâ Hossein lui-même, s’adresse à lui régulièrement au cours du récit, notamment au début de la deuxième partie intitulée « Après quatre ans ». Ces marges du récit jouent un rôle essentiel pour la compréhension de son déroulement. Mais on ne saura pas combien de temps exactement s’est écoulé depuis les derniers événements rapportés dans le récit jusqu’à l’emprisonnement ni quel est le rapport chronologique entre cet événement et les autres. On touche ici à la conception même de la fiction romanesque et au degré de maturité de l’écriture du roman dans les premières années du règne de Rezâ Shâh [17].
Reprenant le motif du journal intime, le roman de Rabi’ Ansâri, poursuit dans Jenâyât-e bashar [18] la réflexion sur la condition féminine et la santé publique. Le narrateur fait la connaissance de l’héroïne, Badrieh, agonisante, qui lui confie le manuscrit de son journal : l’histoire de deux bourgeoises kidnappées puis brutalement conduites dans une maison de Kermânshâh. Le récit décrit la vie sordide des deux femmes, la mort de l’amie de Badrieh et la fuite de celle-ci, qui aboutit mourante dans une chaumière en ruine où par hasard la découvre le narrateur. C’est un récit à la première personne, confession de la jeune femme qui prend les événements depuis son enfance et sa jeunesse qu’elle résume à grands traits pour en arriver au drame qui a décidé de sa vie et de sa mort. Cette mort survient dans un coup de théâtre : Badrieh retrouve son fiancé perdu et les deux amants meurent dans les bras l’un de l’autre. Bien conduit, le récit n’échappe pas cependant à un certain didactisme qui entraîne le narrateur dans des développements parfois verbeux sentant la fiche documentaire (à propos de la condition des femmes ou de la santé publique).
Parmi les romanciers à succès de cette époque, on citera Saïd Nafisi (1995-1966) [19] ; Hossein-Gholi Mosta’ân (1904-1982) ; Seyyed Fakhreddin Shâdmân (1906-1967), connu comme un grand feuilletoniste pendant toutes les années du règne de Rezâ Shâh. Le roman social de cette période est marqué par le développement urbain. La cité moderne et les conditions particulièrement rudes de la vie moderne dans les villes - Téhéran en particulier - est le décor en même temps que le motif central des romans de Mohammad Massoud (qui signe du pseudonyme M.Dehâti). Massoud est issu d’un milieu social défavorisé. Originaire de Qom, il fait carrière d’instituteur dans la capitale, puis, après le succès de son premier roman, Tafrihât-e shab, qui paraît en feuilleton dans le journal Shafaq-e sorkh, il part en Belgique, muni d’une bourse pour étudier le journalisme. Dans ses trois romans qui paraissent en série : Tafrihât-e shab (1932), Dar talâsh-e ma’ash (1933) et Ashrâf-e makhloughât (1934) [20], il décrit les diverses classes sociales urbaines, en particulier le milieu des fonctionnaires. [21]
Notes
[1] Machalski, F., « Shams-o Toghrâ, roman historique de Mohammad Bâqir Xosrovi », in Charisteria Orientalia, Prague, pp. 149-163.
[2] Kamshad, H., Modern Persian Prose Literature, Cambridge University Press, 1966.
[3] Browne, E.G., A literary history of Persia, Cambridge University Press, 1930, vol. 4.
[4] Aryanpour, Y., Az Sabâ tâ Nimâ, Tehrân, Djibi, 5° éd., 1971, 2 vol.
[5] Âdamiyat, F, Andisheh-hâ-ye Aghâ Khân Kermâni, Tehrân, Payâm, 1978.
[6] Browne, E.G., The Persian Revolution, 1905-9, Cambridge University Press, 1910.
[7] Mouvement religieux fondé par Mazdak, inspiré du manichéisme et prônant l’égalité des individus. Ce « socialisme » avant la lettre, se développa sous le roi sassanide Kâvaz (488) ; il fut d’abord favorisé par celui-ci avant d’être persécuté. Le mazdakisme se maintint longtemps de façon secrète en Iran et resurgit plusieurs fois dans l’histoire.
[8] Cf. supra, ch. 1.
[9] Pour des listes détaillées et des analyses de ces romans historiques, on pourra se référer à آryanpour, Y., Az Sabâ tâ Nimâ, Tehrân, Djibi, 1971, 2 vol.), Sepânlou, Mohammad-’Ali, Nevisandegân-e pishrow-e Irân, Tehrân, Zamân, 1983. Voir aussi "Ketâb-e jom’eh", no. 13, 14, 15, E’telâ-ye românnevisi dar Irân. (Essor du roman en Iran).
[10] Âryanpour, Y., Az Sabâ tâ Nimâ, tome 2, p. 258.
[11] Mir-Abedini H., Seyr-e tahavvol-e adabiyât-e dâstâni va nemâyeshi, Tehrân, Farhangestân-e zabân va adab-e fârsi, 2008, p. 207.
[12] Mir-Abedini H., Seyr-e tahavvol…, p. 207.
[13] Parmi ses ouvrages, voir, Homâ, 1927, 6° éd. 1964 ; Paritchehr, 1928, dernière édition 1976, Zibâ, 1932, der.éd. 1976. Rabi’Ansâri Jenâyat-e bashar, 1929-1930, 1397,1940
[14] « Education de la pensée » ; équivalent de bureau des affaires culturelles et de la propagande. C’est pendant sa période estudiantine (1925) qu’il forme le dessein de devenir écrivain et rédige son premier roman : Homâ (publié à Téhéran en 1928).
[15] Ces trois premiers romans, comme la quasi-totalité de l’œuvre de Hedjâzi, ont été réédités par Ebn-e Sinâ, Tehrân, 1964 pour le premier et 1976 pour les suivants.
[16] Ce roman français a été traduit en persan peu avant la Révolution constitutionnelle de 1906.
[17] Voir aussi : Mohammad Hedjâzi, Sereshk (roman,1953) ; Parvâneh (roman, 1953). Hedjâzi est aussi célèbre pour son théâtre ; parmi ses nombreuses pièces, on retiendra la plus célèbre, jouée à Téhéran en 1949 : Mahmoud Aghâ râ vakil konid (Faites Mahmoud Agha député).
[18] Rabi’ Ansâri, Djenâyât-e bashar yâ âdamforoushân-e gharn-e bistom (Les crimes de l’humanité ou les esclavagistes du XX° siècle), 1929 .
[19] Saïd Nafisi, Farangis, roman, 1932.
[20] Les trois romans de Mas’oud ont été réédités par Javîdân, Tehrân, 1978. Voir l’analyse de Mir-Abedini, Seyr-e tahavvol…, p. 233-236 ; voir aussi Kubickova, in Rypka, 2° vol. ; voir aussi Aryanpour, Az Sabâ tâ Nimâ.
[21] On peut citer aussi : Djahângir Jalili 1909-1939) ; Mohammad Ghâzi (1913-1997) ; Ahmad-‘Ali Khodâdâdeh Teymouri.