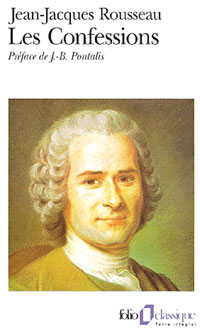|
La seconde moitié du XVIIIe siècle s’accompagne, dans le domaine littéraire, de caractères nouveaux qui s’opposent, par certains traits du moins, à la tradition classique. Mais ils sont peu répandus et trop mêlés au classicisme pour qu’on puisse les considérer comme une mode littéraire nouvelle.
L’insatisfaction de la tradition classique en France et l’épanouissement en Angleterre et en Allemagne d’une littérature extra-classique, préfigurent une nouvelle mode littéraire où une âme nouvelle se manifeste. Elle est faite avant tout de sentiments, c’est-à-dire qu’elle est sentimentale plus que rationnelle. Pour cette littérature, le cœur a autant de droits que la raison, et l’individu en a autant que la société ; peut-être même plus. On appelle cette période de transition le préromantisme.
Pendant cette période, de grands écrivains ont su faire évoluer la sensibilité de leurs contemporains. La figure prédominante de ces artistes préromantiques est Jean-Jacques Rousseau. Le succès de La Nouvelle Héloïse (1761) démontre que Rousseau peut répondre aux vagues aspirations de ses contemporains.
Son cœur sensible et passionné, son âme tumultueuse et ardente se manifestent grâce à une écriture révélatrice. Il inaugure le préromantisme français si bien que la mélancolie qu’il exprime renvoie au thème romantique du mal du siècle. Les hommes de lettres condamnés à l’immobilisme social viennent à ressentir un sentiment de mélancolie et une profonde angoisse. Ils sont pris entre un passé disparu et un avenir imprécis, et le présent, pour eux, est une époque invivable.
Dans la préface de La Confession d’un enfant du siècle, Musset donne une analyse argumentative sur les caractéristiques du mal du siècle. Il conclut sur cette maladie par ces mots : « Tout ce qui était n’est plus. Tout ce qui sera n’est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux. » Le refus du passé, l’incertitude de l’avenir, le dégoût du présent, le désespoir, les passions sans objets, l’isolement et le désir de mort sont quelques traits de ce sentiment étendu au XIXe siècle.
Rousseau exprimait déjà ce sentiment amer. Nous étudierons ainsi, à titre de question principale, quelles sont les variantes de la thématique du mal du siècle repérables dans ses œuvres et dans ses pensées qui nous permettent de considérer Rousseau de ce point de vue particulier comme un précurseur des romantiques, un homme du mal du siècle avant le siècle. Et pour conclure, est-ce que ce grand sage pourrait nous présenter une solution, un refuge contre ce sentiment amer ?
Le mal du siècle désigne une époque où la mélancolie et le désenchantement tourmentent les jeunes générations. C’est une maladie abominable, une maladie morale cependant sous-tendue par des raisons sociales. C’est un excès d’un cœur blessé, d’un esprit malade, d’une imagination qui reproduit les fantômes dont elle est obsédée. C’est le dégoût de tout, l’ennui de tout.
C’est un sentiment mêlé d’un état fugitif qui laisse le cœur inquiet et vide et qui fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après. Mais il n’est pas facultatif, il est obligatoire. L’homme n’a pas choisi. On a choisi pour lui et il ne lui reste qu’à se montrer égal à son destin. En tout cas, cet homme insatisfait est obligé de continuer ce chemin. De plus, il veut se montrer à la mesure de cette obligation, capable de combattre cette insatisfaction ou à vrai dire de combattre ce mal du siècle jusqu’à la victoire.
Sainte-Beuve décrit ce sentiment chez Rousseau avec sûreté : « Les deux natures, celle de René [Chateaubriand] et celle de Rousseau, ont un coin de malade, trop d’ardeur mêlée à l’inaction et au désœuvrement, une prédominance de l’imagination et de la sensibilité… ; mais des deux, Rousseau est le plus sensible, celui qui est le plus original et le plus sincère dans ses élans chimériques, dans ses regrets, dans ses peintures d’un idéal de félicité permise et perdue. » [1]
Rousseau, dans la plupart de ses œuvres, exprime son moi, son insatisfaction et son désespoir ; aussi dans ses œuvres autobiographiques comme Les Confessions, Les Dialogues et Les Rêveries du promeneur solitaire, nous retrouvons beaucoup d’éléments relevant du mal du siècle. Il croit que toute sa vie est remplie de mélancolie, de rêves et de ce sentiment flou de ce mal. Il note sur une carte à jouer : « Pour bien remplir le titre de ce recueil, je l’aurais dû commencer il y a soixante ans, car ma vie entière n’a guère été qu’une longue rêverie divisée en chapitres par mes promenades de chaque jour. » [2]
La rêverie est un mot commun entre Rousseau et le mal du siècle. L’étymologie du verbe, rêver, indique "errer, hors de soi". Ainsi, se promener sans but et vagabonder équivalent à rêver. Pour lui ces deux états se confondent également. Il assure que sa vie entière a été une longue rêverie et aussi une longue errance. Il lui a toujours été impossible de se satisfaire du monde réel. Sa vie a toujours été double : celle qu’il vivait, et celle dont il rêvait : « Ces feuilles ne seront proprement qu’un informe journal de mes rêveries. Il y sera beaucoup question de moi, parce qu’un solitaire qui réfléchit s’occupe nécessairement beaucoup de lui-même. Du reste, toutes les idées étrangères qui me passent par la tête en me promenant y trouveront également leur place. » [3]
Cette âme inquiète sait d’avance que rien dans la réalité ne saurait répondre à l’infini de ses aspirations ou à la richesse de son imagination. Pour dissiper l’ennui, Rousseau se lance dans la rêverie. Détaché de tout, n’attendant plus rien des hommes, Rousseau s’interroge sur sa destinée et pose cette question : « Qui suis-je moi-même ? » Ce n’est qu’en lui qu’il peut espérer trouver la consolation, l’espérance et la paix.
Il faut qu’il se réfugie dans la douceur de converser avec son âme puisqu’elle est la seule que les hommes ne puissent voler. Ainsi, pour cet esprit sublime, pour cette âme inquiète, la rêverie est un refuge fiable et raisonnable. C’est un laisser-aller de l’esprit qui se poursuit passivement, sans diversion, sans obstacle. C’est un mode naturel de la pensée abandonnée à elle-même.
Selon Rousseau, « l’objet de la vie humaine est la félicité » [4] et on ne peut y parvenir que dans la solitude. Cet homme, qui affirme que « tout me ramène à la vie heureuse et douce pour laquelle j’étais né » [5], oppose ce bonheur à la vie en société ; il cherche un bonheur que ni les vicissitudes, ni les avanies de toutes sortes ne pourraient troubler. Le secret du bonheur consiste à se replier sur soi, à se concentrer en soi pour éprouver son existence.
La thématique de la solitude comme une variante du mal du siècle constitue la seconde question de cet article. Conformément à Jean Starobinski, Rousseau « cherche la solitude pour elle-même. La solitude est nécessaire parce qu’elle permet d’accéder à la raison, à la liberté et à la nature. » [6] Rousseau n’a pas toujours fui les hommes mais il a toujours aimé la solitude. Il se plaisait avec les amis qu’il croyait avoir, mais il se plaisait encore plus avec lui-même. Il chérissait leur société, mais il avait quelquefois besoin de se recueillir, et peut-être eût-il encore mieux aimé vivre toujours seul que toujours avec eux.
Préférant l’isolement et la retraite, cette âme se réfugie dans la solitude, grâce à laquelle son imagination active remplace la morale de la raison par celle du cœur. Ce genre de solitude lui fait comprendre que tout dans la société est sacrifié au profit, peu importe que l’homme soit toujours plus malheureux. Le passé est passé, et le présent n’a rien de spécial. Peu à peu, une misère moderne saisit cette âme romantique qui ressent les attaques de cette maladie moderne qu’est la mélancolie.
La passion comme un autre aspect du mal du siècle sera notre troisième question. Une passion est un sentiment violent ayant pour l’étymologie le mot latin patior, c’est-à-dire souffrir. Pendant la période du classicisme, malgré la préférence de la raison au cœur, nous voyons des sentiments comme l’honneur, l’amour d’une femme aimée, l’amour de la patrie, etc., qui outrepassent et deviennent passions comme le Cid de Corneille ou le Phèdre de Racine.
Mais au temps des romantiques, où l’on assiste à la souveraineté du cœur et des émotions ardentes, on aperçoit chaque sentiment qui dépasse et se transforme en passion, surtout l’amour alors représenté comme une passion brûlante, destructive et sans issue.
Rousseau, annonciateur des romantiques, à l’âme inquiète dont la mélancolie est ardente et passionnée, isolé de la société, tourmenté par des passions sans objets, survit dans un monde de rêves. Ce préromantique livré à la passion et à l’imagination, accroît sa torture morale par des visions accablantes.
Le sentiment de l’esprit sublime n’est pas satisfait de la vie commune. Un tel esprit a une âme inquiète, torturée par un besoin de s’abandonner à la violence des passions et se montre incapable de se fixer sur un objet. Quelque chose existe mais tout passe rapidement comme l’éclair, tout s’en va au néant et le sentiment de la fuite du temps renforce une vision pessimiste du monde. Rousseau déclare ses sentiments, ses opinions, quelque bizarres, quelque paradoxales qu’elles puissent être. C’est sa condition qui se contente d’être toujours extrême.
Les contradictions de Rousseau nous montrent bien clairement cette caractéristique de l’extrémité. Pierre Richard, dans son livre Dialogues, Rêveries et Correspondances, s’exprime ainsi à ce sujet : « Il est actif, ardent, laborieux, infatigable ; il est indolent, paresseux, sans vigueur ; il est fier, audacieux, téméraire ; il est craintif, timide, embarrassé ; il est froid, dédaigneux, rebutant jusqu’à la dureté ; il est doux, caressant, facile jusqu’à la faiblesse, et ne sait pas se défendre de faire ou souffrir ce qui lui plaît le moins. » [7]
En un mot, Rousseau passe d’une extrémité à l’autre avec une incroyable rapidité. Il cherche la félicité suprême sans se souvenir qu’il est homme. Son cœur et sa raison sont incessamment en guerre et ses désirs sans bornes sont à la source de sa maladie qui est celle du mal du siècle.
Dans son imagination, il y a toujours un combat entre création et destruction. La création d’un monde imaginaire où Rousseau peut sentir le bonheur et le repos, et la destruction de ce même monde qui lui rappelle le complot des hommes. La peine et la douleur sont si profondes qu’elles deviennent passions et son imagination et sa rêverie accélèrent ce changement. L’imagination qui est toujours son refuge contre la mélancolie, contre le chagrin et contre le mal du siècle, devient son ennemi et crée seulement l’angoisse et l’inquiétude. Rousseau essaie, dans Les Lettres à Monsieur de Malesherbes, d’expliquer la raison du changement d’un sentiment en passion : « L’extrême agitation que je viens d’éprouver vous a pu faire porter un jugement contraire ; mais il est facile à voir que cette agitation n’a point son principe dans ma situation actuelle, mais dans une imagination déréglée, prête à s’effaroucher sur tout, et à porter tout à l’extrême. »
[8]
Cette transformation a pour cause une agitation provoquée par une imagination déréglée, elle n’est pas le résultat de sa situation personnelle mais la conséquence de la période où il vit en société. Nous revenons ici au point initial : chaque mal vient des autres et le vrai coupable est la société. Les maux de ce solitaire sont le fait de la société mais son bonheur est le sien.
Ainsi le seul refuge, le seul abri se trouvent-ils en soi-même. L’art d’être heureux dans ces conditions consiste pour Rousseau à écarter tous les obstacles pour céder à soi-même. Il faut se replier sur soi pour embrasser le repos et le bonheur et éviter le ravage des passions.
Ainsi la passion affirme-t-elle un pessimisme douloureux et déplaisant qui est la conséquence de l’opposition perpétuelle entre le moi et les autres, entre la volonté et la fatalité, entre la liberté et la captivité, et ce pessimisme généralisé, maladif n’apporte qu’un chagrin terne et obscur qui va jusqu’à une mélancolie brûlante annonçant celle de la génération du mal du siècle.
La plus grande caractéristique du mal du siècle, la désillusion, est sûrement le cadeau de la modernisation et de la civilisation. C’est le sentiment pénible et douloureux que tout se lasse et se brise. Il détruit tout aspect de l’espérance et de la vie. L’homme sensible souffrant des préjugés sociaux, se livre à la passion, à la solitude et à la désillusion. Le monde tel qu’il est, ou du moins tel qu’il est devenu entre les mains des hommes, n’est qu’un sujet d’amertume. Le bonheur n’existe plus et l’homme insatisfait ne le trouve nulle part, il a tout examiné et seul le dégoût de l’existence sera son lot. C’est peut-être, selon Charles Dédéyan, le final de l’adieu : « Et à travers mainte détresse, nous allons vers le final adieu, vers l’adieu qu’est la mort. » [9]
Rousseau se réfère beaucoup à cette caractéristique majeure du mal du siècle. Au livre neuvième des Confessions, il écrit : « Je me vis déjà sur le déclin de l’âge, en proie à des maux douloureux et croyant approcher du terme de ma carrière sans avoir goûté aucun des plaisirs dont mon cœur était avide, sans avoir donné l’essor aux vifs sentiments que j’y sentais en réserve, sans avoir savouré, sans avoir effleuré du moins cette enivrante volupté que je sentais dans mon âme en puissance, et qui faute d’objet s’y trouvait toujours comprimée sans pouvoir s’exhaler autrement que par mes soupirs. » [10]
Ailleurs, au livre douzième des Confessions, il parle de ce désenchantement amer qui produit en lui des persécutions et des angoisses : « Dans l’abyme de maux où je suis submergé, je sens les atteintes des coups qui me sont portés, j’en aperçois l’instrument immédiat mais je ne peux voir ni la main qui le dirige ni les moyens qu’elle met en œuvre. L’approche et les malheurs tombent sur moi comme d’eux-mêmes sans qu’il y paraisse. » [11]
Le commencement des Rêveries du promeneur solitaire, sombre et triste, accentue le thème du désespoir. A maintes reprises, Rousseau s’est senti seul, isolé, sans ami, sans parent, étranger dans le monde où il vit, mais jamais la proclamation n’en a été plus douloureuse et plus poignante : « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. » [12] Charles Dédéyan croit que Rousseau à la fin de sa vie ne sent qu’une tristesse immense : « Désormais il est impuissant à fixer son attention, à savourer la vie et à admirer. Quelque chose est mort en lui, ainsi le goût de vivre ; telle est sa tristesse infinie. » [13]
Contre cette désillusion et cette tristesse provoquées par la société, Rousseau choisit de s’enfuir et de s’isoler au lieu de la combattre. Il faut chercher dans la personne, dans le moi de Rousseau, ce besoin de l’isolement qui est lui-même l’une des caractéristiques du mal du siècle.
Rousseau présente la solitude comme un refuge contre le mal du siècle. Plus tard, ce grand philosophe conclut que la solitude ne peut pas être comme un asile sain et sauf car il ne peut chercher son vrai bonheur que dans la félicité publique. Il cherche donc un autre bonheur. L’imagination lui permet alors de refaçonner à son gré le souvenir qu’il conserve des êtres réels qu’il a connus et aimés ou même de créer l’image de ceux qu’il aime sans les connaître. Grâce à son imagination, il veut combattre le mal du siècle. Mais c’est un paradis artificiel et dangereux et sans doute il lui faut un jour s’en réveiller et juste à ce moment, le désespoir l’envahira entièrement.
Quand Rousseau parle de l’amour, il utilise des mots tels le bonheur et le plaisir ; par conséquent, il le croit parfois comme une bonne protection. Cependant, même dans l’amour, l’insatisfaction et le désenchantement se font jour. Le bonheur est menacé, et le mal court du passé au présent, du présent à l’avenir. L’amour se manifeste comme une chose funeste qui punit quand il est bravé, qui poursuit quand il est craint ; l’amour lui-même devient donc nuisible. Il est la cause primordiale de l’insatisfaction pour l’âme sensible. Il est vécu dans l’orage, et c’est l’amour même qui excite l’orage.
Rousseau devient passif et oisif mais il lui faut trouver une solution. Il s’occupe donc de l’écriture grâce à laquelle il peut se donner l’explication de son oisiveté. Cette ressource inépuisable atteste une force secrète, une puissance infinie de se reprendre au mal du siècle. Il croit qu’écrire n’est pas seulement un acte de réflexion, mais une reviviscence. A propos de cette question, Jean Louis Lecercle écrit : « Chaque jour quand il a posé sa plume, il est peut être vrai qu’il retrouve la sérénité et ne pense plus à ses persécuteurs. Ce qui l’agite encore c’est que tout espoir n’est pas perdu. » [14] Mais quand il pense à l’avenir, où sa postérité l’accusera, peut-être, d’avoir écrit une mauvaise œuvre, il désespère alors de l’écriture même.
Mais enfin, quel est l’abri assuré devant ce sentiment ? Le sentiment de rêverie, de passion, de solitude et de désespoir, en un mot le sentiment du mal du siècle qui envahit les hommes de l’ère moderne. L’œuvre de Rousseau y répond ainsi : c’est dans la nature que la douceur de la mélancolie comme l’inquiétude de l’amour trouvent leur asile. Lorsque Rousseau est lassé de tout, même de lui-même, il ne trouve que dans la nature une mère consolatrice : « Alors, me réfugiant chez la mère commune, j’ai cherché dans ses bras à me soustraire aux attentes de ses enfants. » [15] Pour les romantiques aussi, considérés comme les disciples de Rousseau, la nature est essentiellement bonne ; plus l’homme se rapproche d’elle, plus il trouvera le bonheur et le calme. Aux yeux de Lamartine, la nature apaisante et amie fut toujours une grande consolatrice et il célèbre, dans le poème intitulé Le Vallon, la bonté et la paix : « Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime ; Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours ; Quand tout change pour toi la nature est la même ; Et le même soleil se lève sur tes jours. » [16] L’âme de Rousseau trouve dans la nature un refuge calmant qui est loin des servitudes urbaines nuisibles au bonheur. La nature comme miroir de la sensibilité, refuge contre les duretés de l’existence et manifestation de la grandeur divine, permet à Rousseau d’exprimer ses rêveries ou ses réflexions.
Ce grand philosophe sait bien que Dieu seul peut jouir d’un bonheur absolu parce que le bonheur est un état trop constant, et l’homme est un être trop muable pour que l’un convienne à l’autre. Par conséquent, l’homme doit se contenter d’un bonheur relatif. Encore faut-il savoir créer les conditions qui le rendent possible et écarter de soi les obstacles qui bloquent la route. Devant le mal du siècle, il ne faut donc ni combattre, ni se résigner, ni s’enfuir, il faut jouir du mal du siècle au milieu du mal du siècle, et grâce à la nature et à notre propre nature qui est le retour au Créateur de la nature, nous pouvons y accéder.
Références :
![]() Dedeyan, Charles, Chateaubriand et Rousseau, SEDEC, Paris, 1973.
Dedeyan, Charles, Chateaubriand et Rousseau, SEDEC, Paris, 1973.
![]() Dedeyan, Charles, Rousseau et la sensibilité littéraire à la fin du XVIIIe siècle, SEDEC, Paris, 1966.
Dedeyan, Charles, Rousseau et la sensibilité littéraire à la fin du XVIIIe siècle, SEDEC, Paris, 1966.
![]() Lagard, André ; Michard, Laurent, XIXe siècle, Bordas, Paris, 1969.
Lagard, André ; Michard, Laurent, XIXe siècle, Bordas, Paris, 1969.
![]() Lecercle, Jean-Louis, Jean-Jacques Rousseau, modernité d’un classique, Larousse Université, Paris, 1973.
Lecercle, Jean-Louis, Jean-Jacques Rousseau, modernité d’un classique, Larousse Université, Paris, 1973.
![]() Richard, Pierre, Dialogues, Rêveries, Correspondances, Librairie Larousse, Paris, 1938.
Richard, Pierre, Dialogues, Rêveries, Correspondances, Librairie Larousse, Paris, 1938.
![]() Rousseau, Jean-Jacques, Œuvres Complètes, Editions du Seuil, Paris, 1971.
Rousseau, Jean-Jacques, Œuvres Complètes, Editions du Seuil, Paris, 1971.
![]() Rousseau, Jean-Jacques, Les Rêveries du promeneur solitaire, Livre de poche, Paris, 1972.
Rousseau, Jean-Jacques, Les Rêveries du promeneur solitaire, Livre de poche, Paris, 1972.
![]() Starobinski, Jean, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, Editions Gallimard, Paris, 1983.
Starobinski, Jean, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, Editions Gallimard, Paris, 1983.
Notes
[1] Citation de Sainte-Beuve, Les causeries du Lundi, dans Charles Dédéyan, Chateaubriand et Rousseau, SEDEC, Paris, 1973, p. 66.
[2] Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, Livre de poche, Paris, 1972, p. 3.
[3] Ibid. p. 10.
[4] Ibid. p. 190.
[5] Ibid. p. 132.
[6] Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, éd. Gallimard, Paris, 1971, p. 62.
[7] Pierre Richard, Dialogues, Rêveries et Correspondances, Librairie Larousse, Paris, 1938, p. 14.
[8] Jean-Jacques Rousseau, op.cit., p. 230.
[9] Charles Dédéyan, Rousseau et la sensibilité littéraire à la fin du XVIII siècle, SEDEC, Paris, 1966, p. 190.
[10] Jean- Jacques Rousseau, Œuvres Complètes, Editions du Seuil, Paris, 1971, p. 180.
[11] Ibid., p. 192.
[12] Jean-Jacques Rousseau, Op. cit., p. 3.
[13] Charles Dédéyan, Op. cit., p. 11.
[14] Jean-Louis Lecercle, Jean-Jacques Rousseau modernité d’un classique, Larousse Universitaire, Paris, 1973, p. 220.
[15] Jean-Jacques Rousseau, Op. cit., p. 109.
[16] Lagarde & Michard, XIX siècle, éd. Bordas, Paris, 1969, p. 97.