
|
« Comme j’ai publié peu de textes de fiction, l’essai est relativement mieux représenté dans mes écrits, mais en ce qui me concerne, je ne vois guère de différences entre les deux genres : en passant de L’Œil et l’aiguille, par exemple, au Cheval de Nietzsche, je n’ai pas l’impression d’avoir changé essentiellement de registre. A cet égard, Mirella Cassarino, qui m’a traduit en italien, a observé que dans les deux cas "un texte jaillit du mélange de l’écriture et de la lecture". J’ajouterais : de l’émotion. »
Abdelfattah Kilito [1]
La fin des manuels d’histoire
Alain Robbe-Grillet, scandalisé par diverses contraintes scripturales, révèle que la critique rejetait ses œuvres qui sentaient déjà, alors qu’on ne s’y attendait pas, la moisissure de l’esthétique classique et la fraîcheur du renouveau littéraire : "Ce qui me surprenait le plus, dans les reproches comme dans les éloges, c’était de rencontrer presque partout une référence implicite – ou même explicite – aux grands romans du passé, qui toujours étaient posés comme le modèle sur quoi le jeune écrivain devait garder les yeux fixés." [2]
L’auteur des Gommes estime que pour parler de littérature, il est fondamental de mettre en valeur deux facteurs : le premier s’articule autour de la conception de l’histoire comme source de renouvellement des formes et non un réservoir de normes fixes sans autre avenir que de se reproduire à l’infini. Il est évident que « […] les formes romanesques doivent évoluer pour rester vivantes […] » [3]. Le second facteur rappelle que le travail de l’écrivain s’inscrit dans un imaginaire qui le conçoit comme « […] l’exercice problématique de la littérature […]. » [4]. Si cet exercice est problématique, c’est parce qu’il se nourrit du spectacle permanent de ses propres métamorphoses. Les auteurs sont appelés à participer à la mutation de l’œuvre sans jamais avoir peur de forcer sa nature. Quant à sa fonction, l’essence de l’écriture est de s’adapter à la vision que lui accorde l’écrivain.
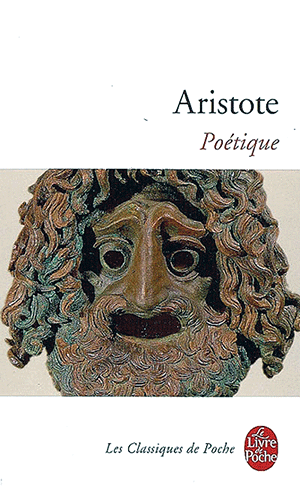
Si ce n’est par souci de classification académique, les maisons d’édition, de leur part, étiquettent les livres qu’ils publient parce que le lecteur a besoin de lire sur la couverture le genre auquel appartient cette œuvre. Comme il achète telle marque d’eau gazeuse au lieu de telle autre, il projette aussi de se procurer un roman d’aventures, par exemple, au lieu d’un roman policier. Le livre est en ce sens une marchandise, sa désignation générique est une sorte de mode d’emploi laconique, l’unique constituant sur la liste de ses ingrédients.
Effectivement, dans un monde à la fois de la démesure et de la censure de la démesure, l’esprit du manuel structure toujours le système de pensée de chacun, à l’école comme dans la rue, dans une librairie ou dans un supermarché. La Poétique d’Aristote, cette référence prestigieuse de la théorie des genres littéraires, a mis sur les rails deux principes de base de la classification : la soumission à la règle et, en cas de révolte, l’expulsion de la cité littéraire. Tout y est soumis au rangement. Deux genres majeurs y sont à l’honneur : l’épopée et la tragédie, et un troisième relégué au rang de la paralittérature : le dithyrambe. Au début de son livre, Aristote confie au lecteur que ce traité de l’art poétique cherche à décrire « […] la manière dont il faut agencer les histoires si l’on souhaite que la composition soit réussie […] » [5]. La réponse de certains nouveaux romanciers à ces exigences théoriques se fonde sur le rejet des trois prescriptions autoritaires :
- Il n’y a pas de critères définitoires qui décident de ce qu’il faut ou de ce qu’il ne faut pas écrire.
- Il n’y a plus d’histoires à raconter.
- Les notions de la réussite et de l’échec de l’œuvre littéraire sont contestables puisque la littérature a des soucis plus sérieux qui la dispensent de réduire son apport aux prévisions de l’industrie de la culture.
De la légitimité de l’œuvre à l’étrangeté du texte
Pour conserver l’esprit de la régularité de l’écriture, le manuel préfère multiplier les courants littéraires. Les genres, eux, restent les mêmes. Ils peuvent se dilater, non disparaître. Ils peuvent enfanter des genres mineurs ou des sous genres, non avorter, et par conséquent encourager les lettres à se charger de la constitution d’une nouvelle grille générique. Quand les romantiques ont projeté l’adoption d’un genre total, c’est à la poésie qu’ils ont pensé. Autrement dit, leur contestation vis-à-vis de la notion de genre n’a pas révolutionné l’histoire littéraire ; elle s’est contentée de remodeler les notions. L’adaptation à la tyrannie du manuel dévoile combien la littérature romantique ne pouvait se débarrasser complètement de la tutelle du classicisme et de ses habitudes esthétiques courantes.
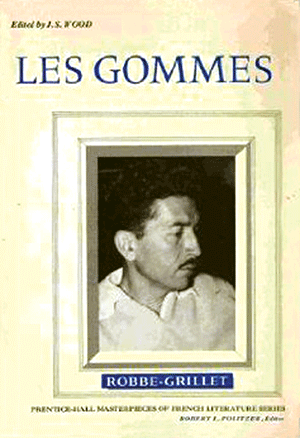
La littérature du XXe siècle est venue avertir le lecteur qu’il a besoin de boussole s’il désire s’aventurer dans le monde des lettres modernes. La machine conceptuelle s’est déchaînée et s’est tout à coup mise à redéfinir ce que le récepteur avait l’habitude de nommer littérature. Du roman naquit l’anti-roman. L’écriture est devenue désécriture. Le théâtre, anti-théâtre. La poésie apoétique. La littérature contemporaine a déclaré la guerre aux conventions génériques ; elle a placé l’écriture sous le signe de la confusion et de la transgression des limites. Qu’est-ce qui déterminerait que tel livre est un roman ? L’intrigue peut-être. Et un roman qui rejette catégoriquement la narration au profit de la description ou de la réflexion purement psychologique, comment le classerait-on ? Le sort de la littérature à l’âge moderne est peut-être mieux exprimé dans l’anecdote suivante : "On raconte qu’un jour Picasso fut prié de peindre le portrait d’un commerçant. Il accepta de réaliser le tableau à la seule condition que son client ne le regarderait que lorsqu’il serait totalement achevé. Quand il eut fini, il montra le portrait au commerçant. Comme celui-ci manifestait son étonnement, Picasso lui tapota l’épaule en lui disant : "Et maintenant, mon ami, il ne vous reste qu’à lui ressembler"." [6]
Sur la toile, le portrait ne ressemble à personne. Au contraire, on devrait tout faire pour lui ressembler. Ainsi est faite la littérature actuelle. Elle prétend être capable d’exister sans avoir besoin d’être adoptée ou prise en charge par la théorie des genres. Elle tient sa légitimité non pas de ses filiations génériques, mais de sa propre structure langagière. Seule la valeur intrinsèque de l’œuvre lui permet d’avoir une validité littéraire. L’écrivain lie l’acte d’écrire à l’esthétique de son œuvre et à sa portée éthique. Comme le tableau peint par Picasso, l’œuvre ne devrait ressembler à rien. C’est au lecteur de fouiner dans ses détails s’il désire contribuer à sa construction et l’amener ainsi à prendre forme. Quand il n’appartient pas à un genre particulier, le livre refuse d’être une œuvre ; il devient manœuvre, un mouvement vers l’accomplissement incertain de l’écriture. D’ailleurs, toute littérature n’est-elle pas potentielle ? Le mouvement OULIPO l’a peut-être bien compris.

C’est dans une revue publicitaire, Aéroports de Paris, que Jean-Marc Roberts avouera : « Chaque texte que j’écris depuis quelques années pose une question. Les réponses parfois tardent à venir. » [7] Peu importe si elles tardent à venir. L’essentiel, c’est qu’elles finissent par arriver et, quand elles arrivent, qu’elles ne soient pas prises en otage par un genre littéraire au détriment d’un autre. L’auteur use du pluriel quand il parle de ces réponses. Pourvu qu’elles multiplient, chacune prise isolément, les chemins qui mènent au point d’arrivée, que ce point d’arrivée soit un livre libre, un texte éclaté, une confession carnavalesque, capable d’aller jusqu’au bout de son étrangeté.
Une œuvre intime
Dans un texte, le lecteur s’introduit dans l’espace intime de l’écrivain. Ici, la métaphore de l’espace nous rappelle l’atelier de Jean Paulhan que lui-même décrit comme un lieu « […] qui nous sert, à ma femme et à moi, de chambre, de salle à manger, de bureau (et même de cuisine et de boudoir) […] » [8]. Il est aussi meublé d’un divan « […] qui se transforme en lit, vers onze heures du soir […] » [9]. Le livre est ouvert à tous les genres possibles. Le lecteur devrait y retrouver une diversité de tons, de tonalités et d’ambiances.

Ce n’est donc pas un hasard si la littérature moderne privilégie le mythe du labyrinthe pour exprimer, entre autres, l’idée de l’éclatement des genres et des formes. Borges, dans ses Fictions, imagine, dans une perspective chaotique, la réécriture à l’infini de la littérature. Sans que ce soit du plagiat, tout ce qui est à écrire est déjà écrit. Parce que tous les livres sont un même livre, « l’œuvre de l’écrivain argentin manque d’un centre. Il se dilue dans les espaces sans bornes d’un sens toujours à définir et à reprendre. » [10] La fixation générique n’a pas de place dans ce type d’écriture dont l’origine est une littérature autosuffisante [11], indépendante des références que lui attribue la critique. Tous les genres littéraires sont voués à la fusion comme l’atelier de Paulhan où tous les espaces sont un seul espace malgré leur divergence apparente.
Dans cet atelier, raconte Paulhan, « […] l’ampoule était cassée […] » [12], alors qu’il « […] rentrai[t] d’une soirée, passée chez des amis » [13], qu’il faisait noir, et qu’il devait traverser cet espace chaotique de bout en bout sans heurter les différents obstacles sur son chemin afin de ne pas réveiller Germaine, sa femme. La traversée a pris du temps. N’est-elle pas semblable à l’exploration d’un lecteur qui tâtonne les objets au fur et à mesure qu’il avance dans la pénombre du texte ? L’instabilité de l’écriture ne promet jamais d’être fidèle à un genre particulier ou à un mode d’écriture spécifique. C’est en apprivoisant les lieux du texte que se construit petit à petit l’intimité avec les mots. Le livre renie la responsabilité que lui imposent les manuels de l’histoire littéraire. Il est libre et n’assume pas la responsabilité de l’empreinte générique que lui attribue l’institution littéraire.
Enrique Vila-Matas en a fait l’expérience lorsqu’il a écrit un ouvrage, Chet Baker pense à son art, qui n’est « ni roman, ni autobiographie, ni essai de critique littéraire […] » [14], texte auquel l’auteur a choisi comme genre « fiction critique ». La réconciliation entre la fiction et la critique ôte à la classification académique du manuel son autorité classique. Le refus de la conformité générique traditionnelle n’annonce pas la mort de la littérature comme le pensent quelques critiques. Le rapprochement entre la fiction et l’essai ajoute à l’œuvre un certain sens d’autoréflexion sur ce que peut définir un texte.

C’est avec Roland Barthes que cet exercice du brouillage des limites entre le littéraire et la critique littéraire sera décisif. Barthes chante l’hymne d’une « jouissance immédiate » [15]. Roland Barthes par Roland Barthes inaugure la fin des limites entre le roman familial et l’autobiographie, l’œuvre étant considérée aussi comme une autofiction à cheval entre la fiction, l’album de photographies commentées et la réflexion littéraire. En sémiologue avisé, il a fragmenté son livre en plusieurs genres difficilement repérables : « Ce doute fondateur avait fait naître des textes tenant de l’essai, de l’autobiographie et de la fiction […]. » [16] Le doute débarrasse la littérature de l’héritage de la théorie littéraire qui résistait longtemps aux temps modernes.
D’emblée, dans cet ouvrage, Barthes signe implicitement un manifeste littéraire où il déclare que "[…] pour que [l’] imaginaire [de l’écriture] puisse se déployer […] sans être jamais retenu, assuré, justifié par la représentation d’un individu civil, pour qu’il soit libre de ses signes propres, jamais figuratifs, le texte suivra sans images, sinon celle de la main qui trace." [17] Le texte suit le mouvement d’une main qui, à son tour, trace quelque chose. Barthes n’a pas remplacé le verbe tracer par le verbe écrire, « une main qui écrit » aurait-il pu dire. S’agit-il donc d’une écriture à valeur iconique ? Elle l’est quand elle se contente d’être une collecte de signes imprévisibles. De même, Barthes n’accorde pas au verbe tracer un complément d’objet direct. L’acte d’écrire n’obéit pas à la réflexion classificatoire de l’écrivain ou du critique. Il est livré au hasard de l’écriture immédiate, libre et nue. La main qui trace n’est pas celle d’un écrivain, mais d’une instance auctoriale abstraite.
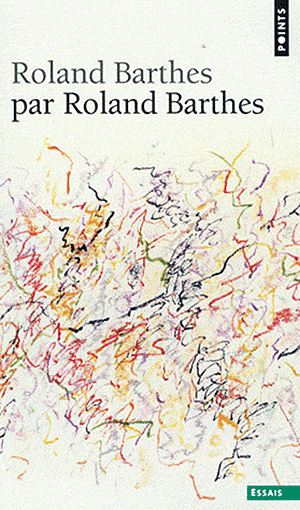
Le fait littéraire
L’instance abstraite, c’est ce à quoi, désormais, l’écrivain est réduit. Le mouvement de l’œuvre suit la trajectoire du regard du lecteur. Kundera décrit la connivence qu’instaure un auteur avec ce lecteur quand il raconte son aventure pendant la lecture d’un texte de Kis : "Je feuillette le livre de Danilo Kis, son vieux livre de réflexions, et j’ai l’impression de me retrouver dans un bistro près du Trocadéro, assis en face de lui qui me parle de sa voix forte et rude comme s’il m’engueulait." [18] L’écriture représente ce lieu de la rencontre virtuelle où auteur et lecteur se rejoignent afin de continuer à partager, au-delà des mots, une intimité précieuse. Elle est précieuse parce qu’elle assure au texte sa valeur scripturale.
Comme l’explique Raphaël Lellouche, ce qu’il faudrait surtout chercher dans une œuvre, c’est ce qui la qualifie de fait littéraire et ce fait « […] n’est rien d’autre que sa possession, ou plus précisément, sa prétention à la possession d’une… valeur littéraire. » [19] Maupassant, dans son livre Choses et autres, dénonce le travail de la critique quand elle réduit sa tâche à un simple exercice taxinomique : « Victor Hugo, Gautier, Flaubert, et bien d’autres se sont justement irrités de la prétention des critiques d’imposer un genre aux romanciers. » [20] Comment convaincre un écrivain, qui croit que « le roman […] tend à absorber à peu près tous les genres littéraires, voire d’autres arts » [21], que son texte reste prisonnier d’une poétique spécifique ? L’écriture l’ouvre sur les divers modes et moyens de la représentation de la sphère littéraire, tandis que l’étiquette générique remet en question sa capacité d’absorption des esthétiques variées.
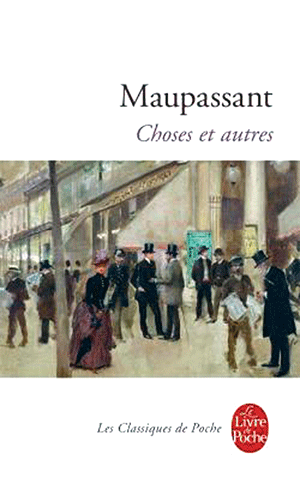
C’est ce qui fait de l’œuvre le lieu par excellence de la rencontre de l’écrivain avec un style original qu’il retrouve au présent de l’écriture. L’analyse textuelle devrait s’intéresser aussi à cet instant particulier de la création. Le Clézio estime qu’au moment où il écrit "Je ne crois pas pouvoir m’abstraire des émotions, et je les ressens quel que soit ce que j’écris. Si j’ai envie d’écrire quelque chose, le rythme, bien sûr, sera différent, la langue ne sera pas la même, mais je crois qu’émotivement je me sens tout autant concerné." [22]
La validité littéraire de l’œuvre ne se justifie pas seulement par la langue dont use l’écrivain. Le texte la dévoile aussi quand il propose un rythme en mouvement, orienté par l’envie d’écrire et l’émotion. Si l’homme se définit d’abord comme style, c’est parce que l’écriture commence avant la rédaction du livre. La littérature naît de la complicité des silences de l’écrivain et des bruissements des mots.
En quoi consiste donc la tâche de la critique littéraire vis-à-vis de la pratique scripturale ? Agnès Rouzier estime que « l’importance de certaines œuvres littéraires tient peut-être à leur pouvoir de nous transmettre le mouvement contemporain dans sa violence vécue. » [23] Mouvement des représentations sociales, certes, mais aussi mouvement de la pensée révoltée. Celle-ci puise son pouvoir contestataire de la liberté même de l’écriture. Sans cette liberté, les mots arriveraient-ils à éviter le divorce fatal avec le vécu ? La violence tient aussi de la persistance de l’œuvre, au-delà de son appartenance générique, à renouveler ses sources d’expressions, à briser le modèle d’une écriture préexistante qui n’est pas adéquate aux nouveaux fondements philosophiques du lecteur.
Un livre libéré des normes est-il libre ?
Finalement, saurait-on un jour écrire une œuvre qui ne serait ni un roman ou un anti-roman, ni une autobiographie, une autofiction ou une fiction à part entière, ni encore une critique ou une pièce de théâtre ? Saurait-on écrire un livre qui serait simplement un livre, une sorte de confidence qu’un auteur offrirait généreusement à son lecteur sans avoir l’intention de lui imposer le cadre de sa réception ? Et s’il est nécessaire de le rattacher à un quelconque genre, qu’il soit lié au genre humain. Ecrire ne serait-il pas, dans ce cas, rédiger une ordonnance efficace où se ravitaillerait l’âme de tout lecteur assoiffé des grandes questions sur sa condition humaine ?
N’existe-t-il donc pas de texte libre qui briserait l’éthique et la logique du marché ? Cette production littéraire ressemblerait à une écriture sur laquelle on fantasmerait, un amas de mots inclus dans un livre opaque, sans code barre, sans prière d’insérer, qu’on craindrait acheter, qu’on achèterait quand même parce qu’il nous délivre de notre condition de consommateur. Ce livre, on aurait du mal à le cataloguer parmi tel genre ou tel autre. Il n’a pas de date d’expiration ou de limite prévisible. L’œuvre libérée n’utiliserait que son titre afin d’entrer en contact avec son lecteur.
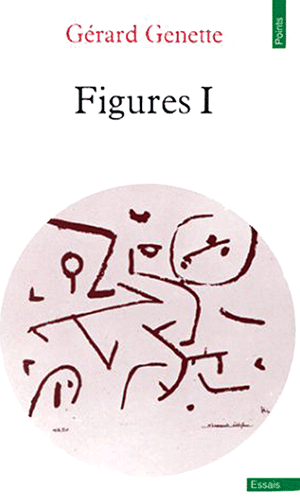
Après avoir fait l’expérience du renoncement aux exigences dictées par les différentes théories littéraires, les écrivains ont pu savourer la redécouverte du « […] plaisir de raconter, sans règles, ni contraintes. » [24] C’est en se libérant des normes génériques et esthétiques d’une poétique ancienne qu’ils ont pu, à leur tour, fonder leur propre conception de la littérature. Ainsi, le roman de formation, appelé aussi d’apprentissage ou d’initiation, s’américanise avec l’invention fantaisiste d’une littérature Young Adult, dédiée à un public restreint, encore composé d’adolescents mineurs, ne dépassant pas l’âge de 18 ans, à la quête d’une personnalité et d’une vision du monde. Parce que ce jeune public est menacé de crises identitaires relatives aux mutations psychologiques, sociologiques et sexuelles, une autre littérature, interactive et consolatrice, appelée New Adult, adressée à des lecteurs âgés de moins de 30 ans, s’est rapidement constituée.
La nouvelle littérature est-elle réactionnaire ? Peut-être, mais elle sait forger son propre chemin loin de la pensée patriarcale. On ne se contente plus d’appeler fiction un roman ou un conte. Il est tantôt métafiction ou fiction critique, tantôt autofiction ou hétérofiction. L’éclatement des genres n’annonce-t-il pas la crise d’une théorie des genres incapable de soumettre l’ensemble de la production littéraire à des valeurs stables et précises ? Chaque écrivain revendique sa part intime de la pratique scripturale. Des genres naissent et ne survivent pas longtemps ; la littérature consomme ce qui la constitue dans l’immédiat. Le lecteur, ravi quand il est initié aux rites de la postmodernité, déçu quand il est encore balzacien, assiste au spectacle de la querelle des modernes.
Les écrivains ont besoin d’écrire. Ce besoin est considéré par les auteurs de Tel Quel comme une force que Gérard Genette qualifie de « […] vide, mais qui, paradoxalement, contribue, et peut-être suffit à remplir la littérature. » [25] Les théoriciens, les critiques littéraires et les éditeurs ont peut-être compris qu’une œuvre moderne se suffit à elle-même, qu’elle se construit après la fin de chaque lecture, qu’elle ne risque de mourir que lorsqu’on la livre, de nouveau, aux manuels.
Bibliographie :
![]() Abdelfattah Kilito, Le Cheval de Nietzsche, Casablanca, Le Fennec, 2007.
Abdelfattah Kilito, Le Cheval de Nietzsche, Casablanca, Le Fennec, 2007.
![]() Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, coll. Critique, Minuit, 1961.
Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, coll. Critique, Minuit, 1961.
![]() Aristote, La Poétique, trad. par Michel Magnien, Paris, coll., Librairie Générale de Française, Le Livre de Poche, 1990.
Aristote, La Poétique, trad. par Michel Magnien, Paris, coll., Librairie Générale de Française, Le Livre de Poche, 1990.
![]() Ivan Almeida, « Un Corps devenu récit », Le Corps et ses fictions, ouvrage collectif, Paris, Minuit, 1983.
Ivan Almeida, « Un Corps devenu récit », Le Corps et ses fictions, ouvrage collectif, Paris, Minuit, 1983.
![]() Jean-Marc Roberts, « Tous les jours à Orly », Aéroports de Paris, 2011, n°57.
Jean-Marc Roberts, « Tous les jours à Orly », Aéroports de Paris, 2011, n°57.
![]() Jean Paulhan, La peinture cubiste, Paris, coll. Folio/Essais, Gallimard, 1990. - Jean Fabre, Le Miroir de sorcière. Essai sur la littérature fantastique, Paris, José Corti, 1992.
Jean Paulhan, La peinture cubiste, Paris, coll. Folio/Essais, Gallimard, 1990. - Jean Fabre, Le Miroir de sorcière. Essai sur la littérature fantastique, Paris, José Corti, 1992.
![]() Philippe Roland, « Essai de roman », Le Magazine littéraire, 2011, n°513.
Philippe Roland, « Essai de roman », Le Magazine littéraire, 2011, n°513.
![]() Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, coll. Ecrivains de toujours, Seuil, 1975.
Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, coll. Ecrivains de toujours, Seuil, 1975.
![]() Claude Arnaud, « L’aventure de l’autofiction », Le Magazine littéraire, 2007, Hors-série n°11.
Claude Arnaud, « L’aventure de l’autofiction », Le Magazine littéraire, 2007, Hors-série n°11.
![]() Milan Kundera, Une rencontre, Paris, Gallimard, 2009.
Milan Kundera, Une rencontre, Paris, Gallimard, 2009.
![]() Raphaël Lellouche, « Faits et Fiats », Quai Voltaire, 1991, n°3.
Raphaël Lellouche, « Faits et Fiats », Quai Voltaire, 1991, n°3.
![]() Maupassant, Choses et autres, Paris, coll. Le Livre de Poche, Librairie Générale Française, 1993.
Maupassant, Choses et autres, Paris, coll. Le Livre de Poche, Librairie Générale Française, 1993.
![]() Roland Bourneuf et réal Ouellet, L’Univers du roman, Paris, coll. Littératures modernes, PUF, 1972.
Roland Bourneuf et réal Ouellet, L’Univers du roman, Paris, coll. Littératures modernes, PUF, 1972.
![]() Jean-Marie Gustave Le Clézio, Ailleurs, entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ezine, Paris, Arléa, 2006.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Ailleurs, entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ezine, Paris, Arléa, 2006.
![]() Agnès Rouzier, Le Fait même d’écrire, Paris, Seghers, 1985.
Agnès Rouzier, Le Fait même d’écrire, Paris, Seghers, 1985.
![]() Gérard Genette, Figures I, Paris, Seuil, 1966.
Gérard Genette, Figures I, Paris, Seuil, 1966.
Notes
[1] Le Cheval de Nietzsche, Casablanca, Le Fennec, 2007, p. 5.
[2] Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, coll. Critique, Minuit, 1961, p. 7.
[3] Ibid., p. 8.
[4] Ibid.
[5] Aristote, La Poétique, trad. par Michel Magnien, Paris, coll., Librairie Générale de Française, Le Livre de Poche, 1990, p. 101.
[6] Ivan Almeida, « Un Corps devenu récit », Le Corps et ses fictions, ouvrage collectif, Paris, Minuit, 1983, p. 18.
[7] Jean-Marc Roberts, « Tous les jours à Orly », Aéroports de Paris, 2011, n°57, p. 62.
[8] Jean Paulhan, La peinture cubiste, Paris, coll. Folio/Essais, Gallimard, 1990, p. 61.
[9] Ibid.
[10] Jean Fabre, Le Miroir de sorcière. Essai sur la littérature fantastique, Paris, José Corti, 1992, p. 469.
[11] Ibid., p. 463.
[12] Jean Paulhan, La peinture cubiste, op. cit.
[13] Ibid., p. 62.
[14] Philippe Roland, « Essai de roman », Le Magazine littéraire, 2011, n°513, p. 28.
[15] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, coll. Ecrivains de toujours, Seuil, 1975, p. 5.
[16] Claude Arnaud, « L’aventure de l’autofiction », Le Magazine littéraire, 2007, Hors-série n°11, p. 23.
[17] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 6.
[18] Milan Kundera, Une rencontre, Paris, Gallimard, 2009, p. 160.
[19] Raphaël Lellouche, « Faits et Fiats », Quai Voltaire, 1991, n°3, p. 93.
[20] Maupassant, Choses et autres, Paris, coll. Le Livre de Poche, Librairie Générale Française, 1993, p. 199.
[21] Roland Bourneuf et réal Ouellet, L’Univers du roman, Paris, coll. Littératures modernes, PUF, 1972, p. 21.
[22] Jean-Marie Gustave Le Clézio, Ailleurs, entretiens sur France-Culture avec Jean-Louis Ezine, Paris, Arléa, 2006, p. 9.
[23] Agnès Rouzier, Le Fait même d’écrire, Paris, Seghers, 1985, p. 7.
[24] Claude Arnaud, « L’Aventure de l’autofiction », Le Magazine littéraire, op.cit., p. 22.
[25] Gérard Genette, Figures I, Paris, Seuil, 1966, p. 253.

