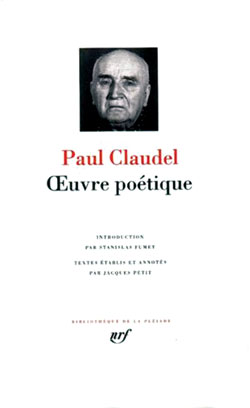|
L’histoire générale de la poésie française peut se confondre avec l’extension de ce genre poétique dont le dictionnaire Robert rappelle qu’il est « l’expression des sentiments intimes au moyen de rythmes et d’images propres à communiquer l’émotion du poète » [1]. Séparé de la musique dès la fin du Moyen آge, le lyrisme se développe comme chant personnel et semble trouver avec le romantisme son domaine de prédilection, en faisant émerger la figure d’un poète puisant dans ses émois ou ses souffrances, la matière même de son poème. Mais « cette accentuation du sujet chantant ne doit pas masquer que le discours lyrique est d’essence vocative, parce qu’il s’adresse nécessairement à un destinataire, qu’il convoque ou qu’il appelle » [2], selon Baudelaire. D’autre part, Valéry a posé la question de la modernité lyrique : « Le paradoxe de la modernité est de faire du lyrisme le mode unique de la poésie, qui voit progressivement disparaître tous les autres genres, tout en remettant violemment en cause les éléments de sa définition classique, à commencer par le statut même du « je » qui s’y déclare. » [3]
Si la poésie moderne s’ouvre à une formidable révolution de ses moyens et de ses buts, c’est parce qu’elle ironise ou conteste les figures du sujet romantique, qu’elle s’est mise à douter profondément de ses capacités à « chanter ». Je tenterai donc, pour la clarté de l’exposé, de conjoindre éclaircissement théorique et parcours historique.
Un lyrisme paradoxal
Dominique Combe a bien analysé, dans Poésie et Récit (1989), comment la poésie moderne a rejeté de son domaine propre tout ce qui touchait au narratif. « Le Hugo de La Légende des siècles (1859) fait aux yeux de Baudelaire figure d’exception monstrueuse, tant par sa volonté d’écrire une épopée, fût-elle composée de « petites épopées » rassemblées, que par la nature didactique de son projet. Mallarmé, quelques années plus tard, exclut de la poésie tout ce qui constitue « l’universel reportage » et assigne au poète une tâche plus noble que « narrer, enseigner, même décrire ». » [4] Cette éviction du récit entérine l’agonie des vieux genres poétiques qui s’étiolent dans la fin du XIXe siècle : la satire, la poésie historique. C’est ainsi tout un pan de la poésie, à sujet pourrait-on dire, qui ne semble plus relever de la définition nouvelle qui s’impose. Parallèlement, le domaine du lyrisme connaît une expansion irrésistible, dans la traduction musicalisée d’expériences intimes, autrement indicibles. Si le sujet – au sens de thème du discours – disparaît, le sujet – au sens d’expression de la subjectivité parlante - occupe tout l’espace. Néanmoins, ce dernier a perdu de son immédiateté romantique, il entre dans un processus de contestation et d’ironisation. Baudelaire marque, dans cette histoire, une charnière capitale : comme l’indique Hugo Friedrich dans Structure de la poésie moderne (1956) : « il se refuse à l’expression du sentiment. » [5]
Influencé par Poe, Baudelaire revendique une poésie de l’intelligence et peut déclarer : « La sensibilité du cœur n’est absolument pas propice au travail poétique. » [6] Les Fleurs du mal (1857) opère une première neutralisation du sujet : « Contrairement à Hugo, Baudelaire ne date aucun de ses poèmes et même si la première personne domine la grande majorité des poèmes, il y cherche « l’impersonnalité volontaire ». Scrutateur de lui même, le sujet baudelairien se met à distance, recourt volontiers à l’ironie mordante, à la dissonance, à la forme souveraine qui bride l’élan sentimental. » [7]
Dernier maillon du romantisme, mais d’un romantisme de l’ironie et du dédoublement, crucifié par toutes les contradictions de la vie moderne, Baudelaire infléchit le lyrisme de manière irréversible. Lorsqu’il se tourne vers le poème en prose, c’est pour y faire l’essai des possibilités d’un Moi démultiplié, soumis aux expériences paradoxales de la grande ville, ballotté entre la projection hors de soi et la souffrance d’être soi. Le « Je » poétique se coupe de son substrat trop directement biographique et l’écriture est le lieu de cette distanciation. Il est ainsi juste de lire, comme le propose Friedrich Hugo, « dans l’émergence de la poésie moderne les progrès de cette décisive impersonnalisation. Les étapes en sont connues, scandées par quelques déclarations célèbres : Rimbaud proclame que « Je est un autre » et exige que la poésie soit le lieu du « dérèglement des sens » ; Mallarmé va jusqu’à prôner la « disparition élocutoire » du poète. Même chez Verlaine, l’émotion personnelle se dissout dans un évanouissement à la fois heureux et redouté du Moi. » [8]
Le paradoxe est donc le suivant : c’est au moment où le poète dit le plus « je » qu’il revendique le plus fortement une dépersonnalisation de soi. Le lyrisme entre dans une crise (crise que l’on pourrait dire « exquise », en reprenant l’adjectif mallarméen) qui devient sa condition d’expression.
Le substrat biographique, même s’il reste fondamental, n’est plus directement lisible, s’il s’agit plutôt de témoigner d’une aventure intérieure dont les lieux, les événements particuliers deviennent opaques au lecteur. La difficulté de la poésie moderne commence là : le poème obscurcit sa référentialité ; il gomme le cadre de son discours, donnant aux déictiques une valeur floue ; il multiplie les lectures plurielles, les niveaux de sens qui se superposent, interdisant de « traduire » un texte qui devient sa propre production de signification.
Selon Friedrich Hugo, c’est avec Rimbaud que se consomme la rupture avec l’expression romantique du Moi. « Si lyrisme il y a, c’est comme dans le poème « Ma bohème », un lyrisme retourné contre son producteur. L’émotion paradoxale du poème passe par cette distanciation ironique. L’éclatement des limites est partout affiché, ne serait-ce que dans la décision polémique de faire parler en première personne un « bateau ivre ». Une saison en enfer (1873) et Illuminations (1886) témoignent, certes, d’une aventure individuelle mais elle exige une sortie des limites subjectives. La fulgurance des images, ma brutalité des changements énonciatifs sont les nouvelles manières de signifier un itinéraire de la désorientation. » [9]
La nature paradoxale du lyrisme moderne est donc au cœur d’une controverse théorique, selon l’accent que la critique choisit de faire porter sur l’une ou l’autre face du même phénomène. Le débat est à l’origine allemand : d’un côté, Hugo Friedrich, partisan - on l’a vu - d’une dépersonnalisation du sujet dans la poésie moderne. Pour lui, « les avancées de la modernité vont vers une toujours plus grande impersonnalisation de la voix poétique. » [10] De l’autre, Käte Hamburger, en disciple de la phénoménologie, privilégie, au contraire, ce qu’elle appelle le « Je-origine ». Dans Logique des genres littéraires (1957), elle entreprend de séparer radicalement deux modalités d’énonciation littéraire : « d’un côté le genre fictionnel qui construit des énoncés feints, de l’autre le « je lyrique » qui s’inscrit, comme l’autobiographe, dans les « énoncés de réalité ». » [11] Elle entend, par cette coupure infranchissable, signifier que « le poème lyrique renvoie bien à un sujet individuel, sans pour autant le ramener à la biographie romantique classique. » [12] Elle insiste donc sur une indéniable différence de réception pour le lecteur, « qui ne doit pas lire le poème comme un roman, comme un univers autonome fabriqué avec des énoncés qui renvoient à des personnages de fiction. Le « Je » qui s’exprime dans Illuminations doit être référé à un « Je- origine » ; il parle de la réalité – brute, serait-on tenté de dire pour employer un adjectif cher à Rimbaud. » [13]
Le statut de ce sujet lyrique reste problématique mais on accordera à Hamburger qu’ainsi, elle ne se coupe pas de l’une des revendications majeures de la poésie moderne : que l’aventure de l’écriture ne soit pas dissociable de la vie, voire selon le vœu rimbaldien repris par les surréalistes, qu’elle la change. La distinction opérée par Kنte Hamburger pose bien des problèmes : « qu’y devient ce qu’il faut bien appeler le « personnage poétique », lorsqu’il s’exprime en première personne, que ce soit dans La Jeune Parque de Valéry (1917) ou dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve de Bonnefoy (1953) ? Faut-il concevoir ce « Je-origine » comme un point fixe, ou doit-on plutôt l’envisager comme une instance mobile et plurielle ? Karlheinz Stierle, revenant sur les termes de ce débat, préfère insister sur la nature problématique de ce « je lyrique », produit par le texte. Il y voit un sujet qui est justement en quête de sa propre identité. Le poème n’est pas énoncé fictif, au sens de Hamburger, mais il donne l’espace fragile d’adéquation et d’authenticité à une voix qui cherche à s’assurer dans et par son propre discours. » [14]
Figures du sujet lyrique (1996) et Le sujet lyrique en question (1996) reviennent sur les termes du débat, et tentent de faire le point. Conformément au geste de Hamburger, il s’agit d’interroger la notion de « sujet lyrique », plutôt que celle du genre lui-même, tout en échappant à la délicate question de l’origine du discours produit. On peut ainsi, en s’aidant des différentes contributions de ces deux volumes, proposer la solution théorique suivante : « La poésie se situe dans un espace figural où peuvent jouer aussi bien des « fictions du moi », sous la forme de personnages imaginaires, que des « figurations du moi ». » [15] L’œuvre de Michaux, telle que l’analysent Laurent Jenny et Étienne Rabaté, permet « d’apercevoir cette malléabilité énonciative, qui la rend apte à passer du récit bref au poème versifié, du masculin à la voix féminine. » [16] On peut aussi dire que le lyrisme est le lieu de figuration de ce qui déborde le sujet. Ce dont parle le « Je », c’est précisément d’expériences qui excèdent la subjectivité, expériences de dépersonnalisation donc, ou même tentatives pour donner figure à la naissance à soi du sujet ou bien à sa propre mort. Il reste ainsi bien un sujet au centre du projet lyrique mais dans une dynamique figurale que permettent à la fois le jeu des blancs sur la page et la mobilité du vers.
Modulations du chant
Que la poésie moderne aille vers l’impersonnalité, la voix blanche, ou qu’elle maintienne l’exigence d’une présence dans la parole comme le défend Yves Bonnefoy, le problème qui se pose aux poètes depuis la rupture de la modernité est que s’est rompu un rapport qui pouvait auparavant sembler naturel avec le chant. « La musique savante manque à notre désir » [17] : la dernière phrase de « Conte », dans Illuminations, ne cesse de résonner depuis plus d’un siècle. L’extraordinaire efflorescence poétique qui caractérise la modernité, la variété de ses solutions rythmiques, techniques, prosodiques peuvent ainsi se comprendre comme les différentes explorations et contestations de cette capacité à chanter le sujet et le monde, à enchanter la langue. Si, pour certains poètes, la poésie prend l’allure ascensionnelle d’un haut lyrisme, parallèlement ou contradictoirement se font entendre des modulations dissonantes, où se manifeste le soupçon que le chant puisse venir à manquer, puisse défaillir.
Appel et célébration : la définition vocative du lyrisme implique cette double ambition qui met la poésie sous le signe de l’invocation de l’être. Claudel et Saint-John Perse illustrent admirablement cette dimension. Le choix de la forme à la fois souple et ample du verset, la puissance du souffle qui passe répondent à la présence des forces élémentaires convoquées par une langue magnifiée. Le poète devient récitant du monde, faisant apparaître sur les tréteaux grandioses de sa parole les figures successives de récitants. Chez Claudel et Saint-John Perse, le poète chante l’être et non le Moi ou la personne. L’accord, parfois conflictuel ou douloureux, avec le cosmos reste le but et l’horizon du poème.
Le surréalisme, selon une autre accentuation, renouvelle aussi le domaine de l’inspiration lyrique. ہ la poésie est assignée la tâche la plus haute comme expression – loin de la tyrannie de la raison – de l’inconscient ou du désir. L’écriture automatique libère un flux de langage qui donne accès, dans la surprise, à une unité postulée de l’être. Récusant la coupure entre l’écriture et la vie, le surréalisme refonde, dans la poésie française, un lyrisme de l’amour fou où si distinguent Breton, ةluard et d’une manière plus esthète, en jouant d’une intertextualité savante, une veine majeure de la poésie d’Aragon. Sous la forme plus crispée du fragment oraculaire, la poésie de René Char reste fidèle à cette mission du haut lyrisme : appel vers l’être, convocation du « dur désir de durer ».
On voit donc que certaines des poétiques majeures de notre siècle redonnent au poète confiance dans son chant. Elles dépassent les apories présentes tant chez Rimbaud que chez Mallarmé, en en reprenant l’exigence et réinvestissent la figure mise à mal par la crise de la modernité du Poète, avec majuscule. D’une certaine façon, Valéry s’inscrit aussi dans ce mouvement : héritier de Mallarmé, il en détourne la leçon vers une poésie savante mais qui repose sur l’idée centrale que « le Moi, c’est la Voix ». La Jeune Parque (1917) se tient ainsi au plus près du surgissement d’une parole affolée par elle-même. « Le Cimetière marin » (1920) se fait vaste méditation sur les paradoxes de l’être, entre mouvement et immobilité, portée par le rythme dissymétrique du décasyllabe.
De façon moins triomphale, toute une partie de la lyrique française depuis la fin du XIXe siècle travaille sur la forme de la chanson. Verlaine fait ici figure d’initiateur en inventant des ressources insoupçonnées au vers impair, à la chanson triste, à la dissonance grise. L’écriture de Laforgue poursuit, d’une autre façon, ces recherches du côté du vers faux, où se donne à entendre un sujet à la fois plaintif et jamais dupe de ses postures. Mais c’est sans doute chez Apollinaire que ce lyrisme mélancolique joue de toute une musicalité, à la fois facile et savante, qui ramène la sophistication symboliste à une expression plus légère. Alcools (1913), entre modernité et acceptation d’un héritage poétique varié, en offre de remarquables exemples, à commencer par « La Chanson du mal-aimé ». Le monde moderne, celui de l’avion, de la vitesse et de la technique, offre, certes ses séductions à une écriture qui, comme chez Cendrars, en chante les bouleversantes manifestations, mais l’instabilité du sujet reste principielle. Dissocié entre « Je » et « tu » dans le poème liminaire que constitue « Zone », le poète cherche dans le lié de la chanson à assurer une identité défaillante et mobile. Le sujet lyrique s’y représente comme passant, voyageur insatisfait parmi les morceaux brisés de son histoire qu’aucun mythe n’arrive plus tout à fait à subsumer.
Une autre tradition lyrique infuse ainsi la poésie moderne : celle d’une parole incertaine d’elle même, qui cherche un ton feutré, une position de voix plus modeste. Reverdy peut en fournir un premier modèle : le poète n’est jamais assuré de sa démarche ; il est en quête d’un « lyrisme de la réalité », plus fragile ou précaire. La poésie s’inscrit dans un défaut entre l’homme et le monde, qu’elle doit moins chercher à combler qu’à nommer. Insécurité et persévérance d’une voix qui se cherche nourrissent ainsi des parcours singuliers, irréductibles à toute école. L’œuvre d’Henri Michaux, en marge du surréalisme, affirme une déconstruction radicale du Moi. « Il n’est pas de moi. MOI n’est qu’une position d’équilibre. (Une entre mille autres continuellement possibles et toujours prêtes) » [18] : lit-on dans la postface de Un certain Plume (1936). L’œuvre est donc, en même temps, lyrique et antilyrique, en ce sens qu’elle ne cesse de nommer le fourmillement intérieur, de l’exorciser sans jamais viser l’expression de soi. « Passages », « Mouvements », « Déplacements, dégagements » : les titres de certains recueils donnent à entendre cette dynamique paradoxale. Poète par défaut, poète du défaut et du manque : cette formule, valable pour Michaux, s’appliquerait aussi à Artaud.
C’est le nom même de poète qui devient problématique. L’œuvre de Ponge, cherchant du côté du « parti pris des choses » de nouvelles ressources expressives, joue de cette hésitation critique. Contre toute effusion bavarde et sentimentale, elle doit donner à lire le travail d’approche vers la part, muette du monde, mais « l’objet » produit reste pris dans une nécessaire jubilation personnelle. Le débat fondamental de la seconde moitié du XXe siècle tourne ainsi autour d’une éventuelle réconciliation avec un lyrisme qui ne peut plus aller de soi. L’œuvre de Jaccottet témoigne de cette lutte entre doute et conquête, travail patient du mot « juste » (qui rend à la fois justice à la réalité et qui soit dans un rapport de justesse). Plus affirmative mais consciente des pièges de l’image ou de l’autonomie du discours, la poétique d’Yves Bonnefoy se place sous le signe de la parole, de l’adresse. Elle tente, sans méconnaître les difficultés du chemin, de dire un ici et maintenant qui reconduit son lyrisme particulier, fait d’abstraction et de sensibilité à l’élémentaire, vers le « vrai lieu ».
Pour la génération actuelle, celle des années 1980-1990, le partage semble se faire entre ceux qui privilégient les jeux sur le langage, les opérations ironiques ou mécaniques de découpage, une mise à plat de l’énonciation, qui neutraliserait les effets de voix, et un courant que l’on a pu baptiser de « néolyrique », autour de Jean- Michel Maulpoix. Poésie grammaticale (Emmanuel Hocquard) et antilyrique (Olivier Cadiot) contre désir de retrouver le chant personnel, sans céder à la trop prompte « illusion lyrique » pour Maulpoix, Benoît Conort ou Hédi Kaddour ? Il est trop tôt pour réduire des démarches singulières à une telle opposition simplificatrice. Ce débat manifeste, à la fin de notre siècle, que la poésie contemporaine continue de nourrir le rapport paradoxal et tendu qu’elle entretient avec la voix lyrique.
Bibliographie :
![]() Dictionnaire de la poésie, éd. Robert, Paris, 2005, p. 446.
Dictionnaire de la poésie, éd. Robert, Paris, 2005, p. 446.
![]() Combe, Dominique, Poésie et Récit, éd. Gallimard, Paris, 1989.
Combe, Dominique, Poésie et Récit, éd. Gallimard, Paris, 1989.
![]() Maulpoix, Jean, Essais sur le lyrisme, éd. José Corti, Paris, 1989.
Maulpoix, Jean, Essais sur le lyrisme, éd. José Corti, Paris, 1989.
![]() Hamburger, Logique des genres littéraires, éd. Le Seuil, Paris, 1999.
Hamburger, Logique des genres littéraires, éd. Le Seuil, Paris, 1999.
![]() Hugo, Friedrich, Structure de la poésie moderne, éd. Hachette, Paris, 1976.
Hugo, Friedrich, Structure de la poésie moderne, éd. Hachette, Paris, 1976.
![]() Jenny, Laurent et Rabaté, Étienne, Poétique de Michaux, éd. Gallimard, Paris, 1987.
Jenny, Laurent et Rabaté, Étienne, Poétique de Michaux, éd. Gallimard, Paris, 1987.
Notes
[1] Dictionnaire de la poésie, éd. Robert, Paris, 2005, p.446.
[2] Ibid.
[3] Ibid., p.447.
[4] Combe, Dominique, Poésie et Récit, éd. Gallimard, Paris, 1989, p. 81.
[5] Hugo, Friedrich, Structure de la poésie moderne, éd. Hachette, Paris, 1976, p. 79.
[6] Ibid., p.80.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid., p. 81.
[10] Ibid.
[11] Op. cit. Dictionnaire de la poésie, p. 450.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid., p. 451.
[15] Ibid.
[16] Jenny, Laurent et Rabaté, Étienne, Poétique de Michaux, éd. Gallimard, Paris, 1987, p. 31.
[17] Maulpoix, Jean, Essais sur le lyrisme, éd. José Corti, Paris, 1989, p. 87.
[18] Ibid., p. 88.