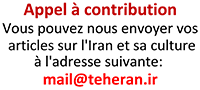
|
N° 55, juin 2010
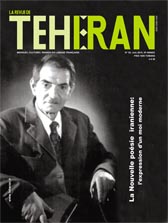
-
CAHIER DU MOIS La Nouvelle poésie iranienne :
l’expression d’un moi moderne Une brève histoire
Une brève histoire
de la poésie persane contemporaine
de Nimâ à nos jours Le point de vue de Nimâ Youshidj sur la poésie
Le point de vue de Nimâ Youshidj sur la poésie
 De Mohammad Hossein Shahriyâr…
De Mohammad Hossein Shahriyâr…
 Deux grandes figures féminines de la poésie iranienne contemporaine
Deux grandes figures féminines de la poésie iranienne contemporaine
Parvin E’tesâmi et Forough Farrokhzâd L’aube détruite
L’aube détruite
 Mort de Forough Farrokhzâd*
Mort de Forough Farrokhzâd*
 Saison froide (extraits)
Saison froide (extraits)
 La poésie politique contemporaine de l’Iran
La poésie politique contemporaine de l’Iran
 La voie de l’Amour
La voie de l’Amour
Poèmes spirituels de l’Imam Khomeiny La poésie moderne ou la poésie nimaienne* un aperçu esthétique et historique
La poésie moderne ou la poésie nimaienne* un aperçu esthétique et historique
 Heydar Bâbâ, le chef-d’œuvre de Shahriyâr
Heydar Bâbâ, le chef-d’œuvre de Shahriyâr
 Iradj Mirzâ, poète de la mere
Iradj Mirzâ, poète de la mere
 Hasht Ketâb - Où est la plume de l’ami ?
Hasht Ketâb - Où est la plume de l’ami ?
 Une halte dans l’instant
Une halte dans l’instant
 Le canari dit
Le canari dit
 Jardin persan
Jardin persan
 Rencontre entre peinture et poésie
Rencontre entre peinture et poésie
CULTURE
Art Un artiste iranien à Paris : Mamali Shafâhi
Un artiste iranien à Paris : Mamali Shafâhi
Repères L’histoire du théâtre moderne persan (1870-1980)
L’histoire du théâtre moderne persan (1870-1980)
(II)
Littérature L’Espoir d’André Malraux : roman de guerre
L’Espoir d’André Malraux : roman de guerre
FENÊTRES
Boîte à textes Les origines de l’identité iranienne
Les origines de l’identité iranienne
Articles de cette rubrique
-
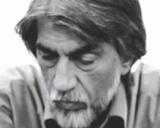
Une brève histoire
N° 55, juin 2010
de la poésie persane contemporaine
de Nimâ à nos joursLa poésie, il va sans dire, constitue un élément fondamental de la culture iranienne, et caractérise les aspects divers de la vie sociopolitique et culturelle de l’homme persan. Elle n’a en effet de cesse à définir sa manière d’être au monde, toujours en décalage avec les exigences du monde moderne, lequel est essentiellement marqué par la prose.
La poésie a effectivement été, cela depuis longtemps, la forme artistique la plus marquante de la culture et de la littérature persanes, la preuve en est le grand nombre de scientifiques, philosophes et mystiques iraniens qui s’occupèrent également de poésie.
-
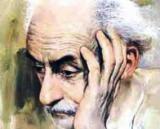
Le point de vue de Nimâ Youshidj sur la poésie
N° 55, juin 2010La parution de plusieurs anthologies de « poésie nouvelle » depuis une quinzaine d’années prouve que cette révolution dans le domaine littéraire, débutée avec le vingtième siècle et les changements socio-politiques qui ont abouti à la Révolution Constitutionnelle de 1906, est désormais entrée dans les moeurs. Dans toutes ces anthologies, Nimâ Youshidj est reconnu comme celui qui, par un travail assidu, ouvrit un nouveau champ à la poésie persane.
-

De Mohammad Hossein Shahriyâr…
, N° 55, juin 2010L’objectif de ce présent article est de présenter une étude de la particularité de Shahriyâr qui eut un succès inouï dans le domaine de la poésie lyrique. La carrière poétique de notre poète coïncide avec les événements socio-politiques survenus durant les années d’entre-deux-guerres ; ses réflexions profondes étant exprimées dans son Divân. Les préoccupations de Shahriyâr pour le destin humain sont apparues dans l’esprit de Parvâneh comme une pensée révélatrice étant sans doute le signe d’une bonté envers ses semblables.
-

Deux grandes figures féminines de la poésie iranienne contemporaine
, N° 55, juin 2010
Parvin E’tesâmi et Forough FarrokhzâdA fin d’évoquer certaines grandes figures féminines de la poésie iranienne contemporaine et de rappeler l’influence que certaines parmi elles exercèrent dans ce domaine et sur la littérature iranienne dans son ensemble, il nous faut remonter et nous intéresser préalablement à l’évolution de l’image de la femme iranienne à travers l’histoire. Il sera alors question d’une évolution et de l’apparition d’une culture artistique féminine dont l’impact se ressent aujourd’hui encore dans l’œuvre des femmes iraniennes.
-

L’aube détruite
Parvin E’tesâmi (1907 – 1941)
N° 55, juin 2010
Traduit du persanUn vent se mit à souffler
Abîmant un petit nid
Un auvent se détacha, s’effondra sur une tête
Une forme tressaillit, une occasion se gâcha
Un oisillon tomba du nid
Une plume rougit de sang
-

Mort de Forough Farrokhzâd*
N° 55, juin 2010C’est durant la nuit du 13 février 1967, dans la banlieue proche de Téhéran, qu’une Land-rover entrait en collision avec une autre voiture venant en sens inverse. La portière de la Land-Rover se plia en deux et la jeune femme qui était au volant se vit projeter hors du véhicule, la tête s’étant fracturée contre le rebord du trottoir. Elle mourut un peu plus tard sur la route de l’hôpital. Fais divers banal, dira-t-on ! Cependant, c’est ainsi que l’Iran venait de perdre une des figures les plus attachantes de sa poésie moderne : Forough Farrokhzâd.
-

Saison froide (extraits)
Forough Farrokhzâd
N° 55, juin 2010
Traduit du persan parAmour
Ô Amour unique entre tous,
qu’ils sont sombres ces nuages
conviés par le soleil
pour regarder monter
le jour
Comme si cet oiseau là ne se voyait qu’au tracé
-

La poésie politique contemporaine de l’Iran
N° 55, juin 2010Quand on parle de la littérature contemporaine de l’Iran, la première dimension de cette littérature qui saute aux yeux est sa dimension politique, sociale et plus ou moins « engagée » ; non pas engagée au sens sartrien du terme, mais plutôt une poésie étroitement imbriquée dans un contexte historique, social et politique troublé, qui l’influence malgré elle.
La modernisation des formes et des thématiques de la littérature contemporaine iranienne commença quelques années avant la Révolution constitutionnelle, c’est-à-dire dès la fin du XIXe siècle et l’entrée de l’Iran dans la modernité.
-
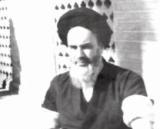
La voie de l’Amour
N° 55, juin 2010
Poèmes spirituels de l’Imam KhomeinyEn 1988 (1367 après l’Hégire selon le calendrier solaire iranien), les éditions de la Radio et Télévision de la République Islamique d’Iran publièrent, sous le titre de Bâdeh-ye ‘eshq (La Coupe d’Amour), les six pages manuscrites d’une lettre de conseils spirituels écrite quelque deux ans auparavant par l’Imam Khomeiny à Fâtima Tabâtabâ’i, l’épouse de son fils Ahmad, accompagnée de quelques poèmes qu’il lui avait confiés.
-
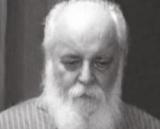
La poésie moderne ou la poésie nimaienne* un aperçu esthétique et historique
N° 55, juin 2010Les poètes de l’« époque de l’éveil », c’est-à-dire de la Révolution constitutionnelle de 1906, avaient déjà modifié en profondeur les thèmes poétiques, mais cette révolution se cantonnait dans le cadre du fond, tandis que les formes poétiques demeuraient les mêmes. Il fallut d’autres évènements historiques d’importance tels que la Première Guerre mondiale, le coup d’État de 1920, et enfin la chute de la dynastie quasi féodale des Qâdjârs et l’arrivée au pouvoir des Pahlavis (1925) pour que le processus de modernisation de la poésie s’affirme davantage.
-
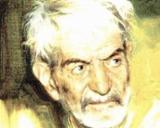
Heydar Bâbâ, le chef-d’œuvre de Shahriyâr
N° 55, juin 2010Heydar Bâbâye Salâm (Salut à Heydar Baba) est le chef-d’œuvre de Mohammad Hossein Behdjat Tabrizi dont le nom de plume est Shahriyâr. Ce poète contemporain d’origine azéri a composé beaucoup de poèmes en persan et azéri, mais Heydar Bâbâya Salam est demeuré son ouvrage le plus connu et apprécié. Ce poème contient deux sections dont la première a été composée de 1951 à 1953.
-

Iradj Mirzâ, poète de la mere
N° 55, juin 2010On dit que Fath-Ali Shâh qâdjâr était très épris de poésie. Il transmit cet attachement à ses descendants, dont Iradj Mirzâ. Le père de ce dernier, Gholâm-Hossein Mirzâ, surnommé Sadr-ol-Sho’arâ (maître des poètes) était l’arrière-petit-fils de Fath-Ali Shâh et comptait parmi les poètes célèbres de la cour. Iradj Mirzâ naquit en 1871 à Tabriz. Il passa son enfance à étudier la langue persane chez des maîtres tels que Bahâr Shirvâni et Aref Esfahâni.
-

Hasht Ketâb - Où est la plume de l’ami ?
N° 55, juin 2010Est-il possible de traduire la poésie ? De manière absolue, la réponse est négative, étant donné que la difficulté ne se situe pas uniquement dans la recherche du rythme et dans le respect de la forme du poème. Selon Robert Ellrodt, « la traduction doit s’adapter à la polysémie de certains textes, mais sans se refuser au choix d’une interprétation. La difficulté majeure est de recréer l’union du sens et de la sonorité qui caractérise la poésie. »
-

Une halte dans l’instant
Sohrâb Sepehri
N° 55, juin 2010
traduit du persan parSi vous venez me chercher :
J’habite
Plus loin que Nulle partPlus loin que Nulle part est un lieu
On y voit
des courants d’airs porteurs d’akènes de pissenlits
messagers de la nouvelle fleur
-

Le canari dit
Nimâ Youshidj (1896-1960)
N° 55, juin 2010
Traduit du persan parLe canari dit que la sphère
de la lune est similaire
à celle des cages à barreaux d’or
et à mangeoires de faïencele poisson rouge transcrivit
son plateau du Nouvel An
-

Jardin persan
Fereshteh Molavi
N° 55, juin 2010
Traduit du persan parFereshteh Molavi est née en 1953 à Téhéran. Elle a publié un roman intitulé Khâneh-ye abr o bâd (La maison des nuages et du vent) ainsi que plusieurs œuvres dont "Bâgh-e irâni" (Le jardin persan), "Nârendj o Torandj" (L’orange et le citron), "Pari aftâbi va dâstânhâ-ye digar" (La fée soleil et autres histoires). Lorsqu’elle vivait en Iran, elle a également traduit plusieurs nouvelles et œuvres littéraires.
-

Rencontre entre peinture et poésie
N° 55, juin 2010Les trois poèmes présentés ici témoignent d’une démarche où la peinture et la poésie se rencontrent et fusionnent. Chaque poème est en même temps un texte et une peinture : il se donne à lire comme poème et à voir comme peinture. Mais les choses ne sont pas si simples car les lettres et les mots en s’exposant échappent au sens et aux chants propres à la poésie pour s’apprécier également esthétiquement, au plan de leur plasticité.
-

Un artiste iranien à Paris : Mamali Shafâhi
Deux regards sur l’exposition WONDERLAND (2500 YEARS OF CELEBRATION)*
, N° 55, juin 2010Le travail artistique de Mamali Shafâhi présenté en 2010 lors de l’exposition Wonderland-2500 Years of Celebration fait écho, dans mon esprit, à la série de photos, intitulée Wanderlust, de l’artiste japonaise Kanako Sasaki. Si les sonorités voisines de Wonderland (« pays des merveilles ») et Wanderlust (néologisme que l’on pourrait traduire par « désir d’errance ») m’ont tout d’abord interpellée, c’est en percevant l’écart des imaginaires entretenus par les deux artistes avec leur pays respectif, l’Iran et le Japon, que j’ai ensuite été captivée.
-
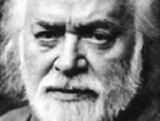
L’histoire du théâtre moderne persan (1870-1980)
(II)Touradj Rahnema
N° 55, juin 2010
Traduit de l’allemand parLe théâtre moderne iranien est redevable à Ahmad Dehghân, directeur de l’une des troupes célèbres de Téhéran dans les années quarante, de plusieurs œuvres. Passionné de théâtre, il forma plusieurs jeunes dont il avait la responsabilité. Ce qui distingue les efforts de Deghân est le fait qu’il s’efforçait de monter, le plus possible, des pièces persanes. Pour la première fois en Iran, des morceaux de musique visant à critiquer la situation sociale furent joués entre les actes des pièces montées sur scène par ce dernier.
-

L’Espoir d’André Malraux : roman de guerre
, N° 55, juin 2010De nombreux écrivains ont été inspirés par la guerre dans leurs écrits, surtout ceux l’ayant vécue de l’intérieur tels Malraux ou Céline. Ces derniers ont été confrontés à des situations d’horreur et on peut considérer qu’écrire fut pour eux un exutoire, une façon de prendre du recul par rapport aux moments d’atrocité vécus, et également de les faire revivre à travers l’écrit pour mieux les comprendre, mieux les juger.
-

Les origines de l’identité iranienne
Mohammad Ali Eslâmi Nadoushan
N° 55, juin 2010
Traduit et adapté parIl faut retourner à l’aube de l’histoire pour pouvoir étudier l’identité iranienne. L’Iran fait partie de ces quelques vieux pays du monde qui ont connu la continuité historique. En fait, dans notre pays nous avons affaire à deux types d’histoire. L’histoire du point de vue du territoire et l’histoire du point de vue ethnique. La première concerne les peuplades qui, il y a des milliers d’années, vivaient sur des territoires qui prendront plus tard le nom de l’Iran.
