
|
Analyse du chef-d’œuvre théâtral de Nimâ Dehghâni intitulé
L’amour est ce que tu apercevras aujourd’hui, demain et après-demain
"Les marionnettes nous présentent plusieurs avantages dont, entre autres, le fait qu’elles ne discutent point et, n’étant pas dotées de vie privée, n’ont pas d’opinions rudimentaires à propos des arts."
(Oscar Wilde)
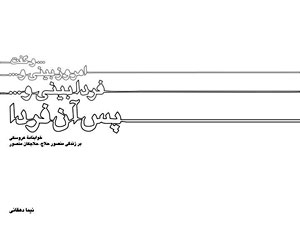
- Affiche de la pièce L’amour est ce que tu apercevras aujourd’hui, demain et après-demain
Doué d’un don rare pour l’art dramatique, Nimâ Dehghâni s’est éloigné de ses études d’architecture pour se vouer à une vie axée sur le théâtre. Ces dernières années, il a écrit et mis en scène plusieurs pièces dont, entre autres, Mored-e mashkouk-e boz zangouleh pâ (Le cas douteux de la chèvre Clochette-aux-pieds), Dor-e Do Farmân (Demi tour en trois mouvements), Asb, sib o bahâr (Le cheval, la pomme et le printemps) et Orpheous (Orphée) qui connurent un succès sans pareil.
Le Théâtre National a récemment monté l’une de ses pièces intitulée L’amour est ce que tu apercevras aujourd’hui, demain et après-demain pour la première fois en Iran après avoir, tout d’abord, suscité l’intérêt des critiques dans la République tchèque comme au Kazakhstan.
Cette pièce, montée à Prague à l’occasion du 15e Festival mondial de la marionnette, fut nominée pour des prix prestigieux dans six domaines différents dont celui du meilleur metteur en scène, celui de la meilleure performance et celui de la plus belle décoration de scène et fut couronnée de deux prix : elle reçut le prix de l’œuvre la plus créative et l’artiste Hodâ Nâseh fut désignée comme étant la meilleure marionnettiste. Ce théâtre remporta également le prix de la meilleure actrice féminine au Festival mondial de la marionnette à Almaty au Kazakhstan.
Il pleuvait à torrents dans la capitale iranienne le jour où je me rendis au Théâtre National pour y voir jouer cette nouvelle pièce de Dehghâni qui avait suscité l’éloge unanime de la critique à l’échelle internationale. La pluie continuait à battre sans relâche alors que je descendais les marches menant au salon Sâyeh où la pièce allait bientôt débuter. En attendant le commencement de la pièce, les grands traits de la vie et de l’œuvre de Mansour Hallâj, ce personnage à la fois mystérieux et attrayant, me revinrent à l’esprit.
Hossein Mansour Hallâj naquit à Tur dans le sud-ouest de l’Iran en 244 d’un père qui s’était converti de sa religion ancestrale, le zoroastrisme, à l’islam. C’est à Basreh (Bassora) en Iraq qu’il fit la connaissance d’Hassan Basri et qu’il décida, désormais, de mener une vie ascétique. Les trois maîtres du soufisme qui influèrent le plus sa pensée et son œuvre sont Amr Maqqui de La Mecque, Ebrâhim de Kouffa et Jonayd de Bagdad.
L’élément principal de sa pensée était que la guerre et la violence ne parviennent qu’à affaiblir l’unité du peuple musulman et que c’est seulement en menant une vie ascétique vouée à Dieu qu’il est possible de préserver cette unanimité. Dans cet esprit, il se rendit trois fois en Terre sainte pour y faire le pèlerinage de La Mecque. C’est sous l’influence de Jonayd qu’il opta, pour la première fois, de porter la robe de laine et le turban propres aux soufis. Lorsqu’il quitta la ville de Basreh pour Soushtar, il y dénonça pourtant publiquement les soufis tartuffes. Plusieurs années plus tard, il ôta même sa robe de laine en signe d’objection au soufisme axé uniquement sur l’individu, et qui s’adaptait sans problème à la politique des califes au pouvoir qui craignaient, secrètement, toute insurrection populaire. Ceci fait, il démontra que les véritables partisans du soufisme sont ceux qui assument leur part des responsabilités sociales.
Nul ne peut nier l’influence de son séjour aux Indes - qui dura près de cinq ans - sur sa pensée mystique. Comme plusieurs autres aspects de sa vie, ce voyage fut l’objet de nombreuses controverses. Certains prétendirent qu’il effectua ce voyage dans le but de propager l’islam dans le subcontinent indien, alors que d’autres parlèrent d’apprentissage de magie.
On lui reconnaît même des miracles. Une anecdote raconte qu’il leva un jour les bras vers le ciel et lorsqu’il les redescendit, ses compagnons découvrirent une pomme dans le creux de sa main. Tous s’étonnèrent et demandèrent d’où ce fruit provenait. Hallâj répondit : « Du Paradis. » Hébétés, ils lui demandèrent comment il se faisait qu’elle était véreuse, le grand mystique rétorqua : « C’est parce qu’elle a fait son entrée dans ce bas-monde et a quitté le Ciel que le ver s’y est inséré ».
Ce fut à l’âge de trente ans qu’il fut arrêté, soupçonné d’avoir initié des révoltes populaires, pratiqué la magie, réfuté les versets du Saint Coran et avoir été le représentant des Gharmati (nom péjoratif donné alors aux chiites). Certains des poèmes qu’il composa au cours de sa courte vie ne firent que détériorer l’opinion publique à son propos, déjà contrariée par sa personne. Son cri "Anna al-Haqq" (Je suis la Vérité [Dieu]), ainsi que les vers suivants sont d’excellents exemples de ses propos qualifiés d’hérétiques : « Je suis amoureux de Dieu, et Lui l’est de moi/ En voyant Dieu, c’est comme si tu me voyais ». Dans la théologie mystique, de tels vers témoignent du concept fondamental de l’unicité de l’existence (vahdat-e vojoud).
Il s’avança même, prêt à se crucifier comme le Christ. Une autre initiative qui fut sujet à de nombreuses controverses est la maquette de la Kaaba qu’il bâtit chez lui afin de pouvoir en faire le pèlerinage, symboliquement, de temps à autre.
Certains ont élevé Hallâj au rang de martyr, alors que d’autres l’ont tenu pour hérétique. Les années qu’il passa à Basreh eurent un impact profond sur son idéologie mystique et le sensibilisèrent aux nombreuses injustices qui existaient dans sa société. Durant sa vie, il fut entre autres, témoin de la révolte des Zand, en réalité une sédition d’esclaves originaires du continent africain contre les injustices de la dynastie abbasside qui les forçait à travailler dans les mines.
Le danger que représentait Hallâj résidait dans le fait que le peuple le voyait comme chef révolutionnaire et c’est ce rôle politique qu’il jouait que le gouvernement craignait par-dessus tout. Ainsi, le mouvement sunnite visant à renverser Al-Muqtader fut dirigé principalement par Hallâj, ce qui précipita d’ailleurs sa chute. Ceci fait, Hallâj s’enfuit et vécut trois ans en cachette avant qu’on ne l’arrêta.

- Scènes de la pièce L’amour est ce que tu apercevras aujourd’hui, demain et après-demain
Photos : Mehdi Hassani
En prison, il rédigea Tasin al-Azal, œuvre reflétant les idées de la dernière phase de sa vie, axée principalement sur la figure de Satan qu’il élève au plus haut rang. Hallâj prétend même que le Diable a bien fait de ne pas s’incliner devant Adam puisqu’étant monothéiste véritable, il ne pouvait se prosterner que devant Dieu. Ce furent de tels propos peu orthodoxes, le changement qu’il opéra dans le rituel du Hajj et son cri de « anna al-Haqq » (Je suis la Vérité (Dieu)) qui l’entraînèrent vers la mort. Hallâj, quant à lui, interprétait cette phrase comme voulant signifier qu’il suivait véritablement la voie de Dieu.
Hallâj s’était fait une réputation d’anarchiste coupable d’hérésie, voire de fou pratiquant la magie. Des rumeurs disaient qu’il cherchait à anéantir le pouvoir des califes. Il était désormais trop dangereux. C’est pourquoi ’Abdollah Ibn Mokarram se fit le devoir de recueillir les signatures en vue de condamner Hallâj. Quand les ulémas décidèrent de décréter la fatwa contre Hallâj pour le condamner à mort, le calife précisa que sans la signature de Jonayd, ancien ami de Hallâj, cette condamnation serait dépourvue de toute validité. Devant l’insistance de ce denier, Jonayd ôta son turban et sa robe de laine, puis signa sa sentence de mort d’une main tremblante. Il déclara que selon l’apparence des faits sur laquelle toute fatwa se base, la peine de mort doit être exécutée, mais que seul Dieu peut véritablement juger de sa culpabilité.
Certaines sources historiques précisent que les califes au pouvoir avaient promis trois pièces d’or à tous ceux qui le maudiraient. Selon ’Attâr, le grand poète persan, quelque cent mille personnes assistèrent à son exécution alors que lui répétait sans relâche « Haqq, Haqq, anna al-Haqq ». De nombreuses personnes lui jetèrent des pierres sans lui arracher une plainte, jusqu’à ce que le soufi Shebli, qui assistait au supplice, lui jette une fleur, lui arrachant une plainte douloureuse. ةtonnés, les spectateurs lui demandèrent pourquoi la fleur l’avait fait souffrir, alors que les pierres l’avaient laissé silencieux. Hallâj rétorqua qu’eux ne savaient pas qu’il disait vrai alors que Shebli était doté d’une connaissance approfondie de ses croyances.
Lorsque la fin fut proche, on lui demanda ses derniers vœux. Sa réponse fut simple : il avisa les hommes de prendre garde à l’âme incitatrice au mal. L’histoire nous révèle qu’on lui trancha d’abord les bras, les jambes et ensuite la langue. Lorsqu’il vit le gibet, il ria jusqu’aux larmes et se mit à prier. Il fut pendu sur ordre du calife et on brûla son cadavre, après quoi on jeta ses cendres dans le Tigre en l’an 309 de l’Hégire.
Comme le dit Ardsehir Sâlehpour, une grande partie de l’identité collective des Iraniens est à retrouver dans les résidus culturels du passé. "Sans chercher à nier les valeurs de la modernité, nous croyons cependant que le devoir nous revient de narrer les événements historiques sous un angle nouveau. En d’autres termes, les œuvres anciennes continuent à vivre, voire grandir avec nous au cours des siècles" (1. p. 6). L’islam médiéval et le modernisme se mêlent et se croisent à un rythme haletant dans cette pièce, ce qui constitue un trait essentiel des textes postmodernes.
Comme nous avertit la metteuse en scène dans la préface de cette pièce publiée récemment aux éditions Namâyesh, l’histoire ne se base pas directement sur la vie de ce grand mystique de l’islam médiéval. Il s’agit, pour reprendre les mots de Zohreh Behrouziniâ, "d’un récit sur et non de la vie de Mansour Hallâj" (2. p. 7). Cette pièce, précisons-le, ne vise pas à simplement narrer les événements historiques et à réciter les vers quelque peu complexes de ce penseur.
Hallâj, lui-même, ne figure même pas parmi les personnages de cette pièce qui nous invite, dès l’incipit, à partager la solitude d’une femme qui ne fait que songer à son époux et aux nombreux enfants qui seraient les fruits de leur relation amoureuse. Dans un passage touchant, elle avoue : "…je me levais chaque matin des cendres de la nuit d’avant et je dansais dans le feu de l’amour tel un papillon jusqu’à ce que la nuit tombe… Je me retrouve seule à présent parmi toutes ces ombres (…) et tous ces délires. Je brûle à présent de revoir Hallâj et toute ma vie se résume dans l’espoir que j’ai placé dans ces Hallâjak Marionnettes qui représentent les enfants de Hallâj." (3. p. 21).
La mise en scène de cette tragédie qui compte huit scènes est des plus simples : des berceaux sont placés dans les quatre coins d’une scène toute blanche. La marionnettiste Hodâ Nâseh est elle aussi revêtue de blanc, couleur qui représente la pureté et l’innocence. Ce personnage principal, dont le nom ne nous est pas révélé, fabrique des poupées pour l’enfant qui se prépare à venir au monde, en faisant des nœuds dans les draps immaculés qui sont accrochés à une corde à linge qui traverse la scène. Mais au fur et à mesure que la pièce avance, elle en vient à croire, dans sa folie, que les marionnettes sont animées de vie. Vers la fin de la pièce, elle admet même avoir oublié son propre nom : "Appelle-moi par mon propre nom (…) Aghigh… Sâreh… Azar, Shams, Zahrâ… Leilâ, Zeinab… Tahmineh… Nâhid… Soudâbeh… tu te rends compte (…) j’ai même oublié mon propre nom…" (4. p. 56).
Les cultures mondiales ont toujours accordé traditionnellement une place inférieure à la femme par rapport à l’homme. A titre d’exemple, les anciens Grecs étaient d’avis que les femmes dissuadaient les hommes de rechercher la vérité et Sophocle, le dramaturge érudit prétendait, en autres, que pour être couronné de grâce, le sexe féminin devait garder silence. L’écrivain anglais Alexander Pope affirmait, pour sa part, que la plupart des femmes n’avaient aucun caractère (5. p. 169).
Le postmodernisme a pour devise de déconstruire toutes les oppositions binaires fondamentales de la culture occidentale (6. p. 147). D’après Cixous, la place privilégiée du masculin par rapport au féminin dans l’opposition binaire homme/femme a pour effet de refréner l’imagination des deux sexes (7. p. 165-66). En donnant la parole à une femme, M. Dehghâni renverse cette opposition ainsi qu’une autre toute aussi centrale à la culture occidentale : celle de sensé/ insensé.
L’atout majeur de cette pièce réside dans les monologues prononcés par cette femme, un personnage périphérique, poussé en marge de l’histoire, qui ne se soumet à aucune autorité, ce qui rend sa narration d’autant plus intéressante. La tragédie se donne le but d’éclairer divers aspects de la vie d’une femme dont le mari marqua l’histoire.
Les propos de ce personnage principal sont des exemples typiques du langage sémiotique élaboré par Kristeva, qui désigne tout emploi de la langue qui n’est pas sous le contrôle total du locuteur. Le langage poétique ainsi que celui employé par les malades mentaux incorporent très bien les caractéristiques du langage sémiotique (8. p. 167). L’un des meilleurs exemples que nous présente ce drame est sans doute le suivant : "J’ai l’impression que cent magistrats abattent le marteau dans ma tête" (9. p. 23).
La femme se plaint des cauchemars qu’elle fait maintenant que son mari ne se trouve plus à ses côtés : “Oh ! Ces rêves… ces rêves… ces mirages affolants !” (10. p. 19). Les fréquentes attaques auxquelles cette femme est sujette témoignent de sa résistance à la patriarchie (11. p. 208). Elle s’écrie même : « Cela fait huit ans que je n’entends que ma propre voix, les questions que je me pose n’aboutissent qu’à d’autres questions. Ces murs… ces marionnettes dépourvues d’âme ne sont pas en mesure de me répondre » (12. p. 20). Elle encourage pourtant son "enfant" à lui poser des questions : « Tes yeux ressemblent à deux galaxies, mais à une plus petite échelle… ils débordent de questions » (13. p. 17). Elle insiste ensuite que le nouveau-né lui pose ses questions, car les murs de la pièce sont avides de les entendre. Elle semble faire allusion, ici, au fait que l’enfant, tout comme son père, a une soif insatiable de connaissance.
En écoutant, hébétée, l’Histoire personnifiée dans le passage où cette dernière s’exclame : "Je représente la répétition des faits historiques. Je symbolise la fixité des grands moments historiques dans la mémoire limitée des hommes" (14. p. 34). Elle lui fait croire qu’elle (Histoire) représente tout ce qu’elle a perdu, et la femme de Hallâj acquiesce finalement en disant qu’elle est à la source de son délire. Cette analyse s’accorde parfaitement avec l’argument de Michel Foucault selon lequel ce qui passe pour vérité dépend de ceux qui contrôlent le discours. Cela va sans dire que dans le cours de l’histoire, la domination du discours par les hommes a piégé les femmes dans une « vérité » dite masculine (15. p. 212) au point de les affoler.
Les tragédies postmodernes nous dévoilent un univers et une vision du soi complètement décentrés, comme c’est le cas dans cette œuvre où le personnage principal se plaint de l’isolement. La femme de Hallâj dit : "Dans cette solitude, le délire est mon seul compagnon" (16. p. 30). Dans ses hallucinations, elle craint même que les gardes n’entendent les soupirs de l’enfant qu’elle se prépare à mettre au monde (17. p. 35). C’est peut-être pourquoi elle lui dit : "N’aie pas peur mon chéri… n’aie pas peur mon enfant… reste en moi, dans le royaume maternel sans frontières… ce royaume perdu est l’endroit le plus sûr que l’on puisse trouver dans ce monde et dans les rêves" (18. p. 24) et, plus loin, elle ajoute : « Mon chéri… tu n’appartiens pas à ce monde… Ta place véritable est le royaume vierge de ta mère… Reste-là où tu es, n’ouvre pas les yeux sur ce monde qui n’a que des laideurs à t’offrir" (19. p. 29).
La sixième scène nous dévoile un tribunal où Hâmed le ministre s’écrie : "Fermez toutes les portes. Le tribunal sera à huis-clos." (20. p. 45). En voyant cette scène, la femme de Hallâj s’exclame affolée : « Quel cauchemar… On peut à peine y croire… Ce tribunal… non c’est ridicule" (21. p. 47). Ce qui rend le tout d’autant plus absurde est le fait que le secrétaire du tribunal est absent. Cette section de la tragédie nous révèle un exemple concret d’intervalle comique, ayant pour fonction de diminuer la tension qui s’est établie au cours des cinq premières scènes et d’offrir un contraste comique avec les éléments dramatiques qui y précèdent. Le langage employé est familier et fait partie du registre de la langue courante. Après l’échange de quelques mots laconiques, le décret du tribunal est prononcé : « Fouets… gibet, mort et brûlure » (22. p. 51).
Cette scène se termine avec la célèbre phrase qui dit que le destin eût voulu que la femme de ce mystique se lie d’amour à son ombre et à son souvenir (23. p. 52). Elle continue par dire, un peu plus loin : "Quand je me maquillais pour moi-même… je mettais du fard, j’appliquais du khôl sur mes cils et je teintais mes mains avec du henné… j’aurais bien aimé savoir auprès du tombeau de quel saint tu te retrouvais alors…" (24. p. 54).
La pièce se termine par ces mots : « (…) on lui demanda qu’est-ce que l’amour et sa réponse fut : « C’est ce que tu apercevras aujourd’hui, demain et après-demain » (…) », d’où est d’ailleurs extrait le titre de cette pièce de M. Dehghâni. « Il fut pendu le jour même, son corps fut brûlé le lendemain… et le surlendemain ses cendres furent jetées à l’eau (25. p. 62). »
A la fin de la pièce, remontant les marches du théâtre, je sentais la pesanteur de l’Histoire, et jetant un dernier regard derrière moi, il m’a semblé quitter une voûte souterraine semblable à ces milliers d’autres qui, au cours de l’histoire, ont été témoins du martyre de grandes personnalités au caractère quelque peu controversé.
Bibliographie :
![]() (7) (8) Bertens, Hans, Literary Theory : The Basics, Editions Routledge, 1ère édition, 2001.
(7) (8) Bertens, Hans, Literary Theory : The Basics, Editions Routledge, 1ère édition, 2001.
![]() (5) Bressler, Charles E. Literary Criticism : An Introduction to Theory and Practice, Pearson Education, 4e edition, 2007.
(5) Bressler, Charles E. Literary Criticism : An Introduction to Theory and Practice, Pearson Education, 4e edition, 2007.
![]() (1) (2) (3) (4) (9) (10) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Dehghâni, Nimâ, …Va goft emrouz bini o… fardâ bini o… pas an fardâ (L’amour est ce que tu apercevras aujourd’hui, demain et après-demain), Editions Namâyesh, 1ère édition, 2010.
(1) (2) (3) (4) (9) (10) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Dehghâni, Nimâ, …Va goft emrouz bini o… fardâ bini o… pas an fardâ (L’amour est ce que tu apercevras aujourd’hui, demain et après-demain), Editions Namâyesh, 1ère édition, 2010.
![]() (6) (11) (15) Selden, Raman, et Peter Widdowson, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. Editions Harvester Wheatsheaf, 3e édition, 1993.
(6) (11) (15) Selden, Raman, et Peter Widdowson, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. Editions Harvester Wheatsheaf, 3e édition, 1993.



