
|
Qui est capable de déchiffrer les hiéroglyphes de ce monde hormis les hommes de désir ?
(Rûzbehân, Le Jasmin des fidèles d’amour)
Je Te veux, je ne Te veux pas en raison de la récompense
Mais je Te veux en raison de la punition
Car j’ai tout obtenu de ce que je désire
Sauf les délices de ma passion dans la souffrance
(Hâllaj)
***
Si, par-delà leur mort, on disait aux amants : « Morts, avez-vous trouvé repos à vos tourments ? » Ils répondraient, à se vouloir sincères : « C’est vrai, notre corps n’est plus que poussière. Mais le feu de l’amour incendie notre cœur.
(Majnûn, L’Amour poème)
***
Deus meus ! Amor meus !
Tu totus meus et ego totus tuus !
Dilata me in amore,
Ut discam interiore
Cordis ore degustare
Quam suave est amare
Et in amore liquefieri et natare
(Thomas a Kempis)
Moreau, Dante, Nezâmi et Rûzbehân figurent tous une liturgie de l’Amour, avant le temps où le mythe littéraire de la Femme ne commença à se corrompre. Et comme le cycle dantesque s’était chargé de théologie et les romans de Nezâmi de mystique fulgurante, les peintures de Gustave Moreau à la fin du XIXe siècle traverseront les scintillements fantasmagoriques du syncrétisme religieux, avant d’atteindre à l’extase rédemptrice du finale de Jupiter et Sémélé. C’est que se retrouvent chez des êtres si différents, les mêmes structures spirituelles : leur psychologie poétique et mystique les conduisant à la possession de l’éternel. Ainsi le rapport entre ces créateurs et leurs sources reste toujours mythologique, le mythe et la mystique étant ensemble les intermédiaires littéraires du voyage perpétuel, du voyage à travers la multiplicité de soi-même et à la recherche de son aventure éternelle, où figurent, en une harmonie complexe, les rêves gnostiques et l’Islam soufi, et que couronne, en son point culminant, la miniature en ses formes et ses couleurs, l’épanouissement paradisiaque au terme du voyage.
L’ascension céleste est, comme le rêve et le souvenir, comme l’amour même et la mort, triomphe de l’ubiquité sur la dispersion et de l’existence sur la nostalgie. Et comme la dévorante faim de l’amour, le « charnel azur » (Norge), il s’agit moins d’imaginaire que d’imaginal. L’enluminure est un lieu où l’invisible prend forme et couleur, où le visible et le sensible accueillent le surnaturel, un lieu de passage, un lien particulier entre l’humain et le divin ; c’est à partir de ce sentiment spirituel que les agitations de l’âme achèvent de s’effacer comme se dissipe un mauvais rêve dans les paradis peints, les trésors célestes et suaves. De quelle nature sont les tableaux de Moreau ? Mutatis mutandis, ce sont des illuminations (Rimbaud) et l’on voit bien aussi chez Dante, comme il est difficile de distinguer entre la vision mystique et l’imagination du poète ; tous sont des inspirés et dans leur œuvre se mêle et se succède ce qui relève de l’art et de l’extase. Ils chantent l’irréductible aspiration amoureuse, la communion paradisiaque, la blessure lancinante et les corps glorieux s’opposant « aux démentis de l’intraitable réalité » (Michaux). Songe, rêve, page conçue comme peinture allégorie, poème, c’est à toutes ces catégories qu’ils appartiennent, entre imagination poétique et vision surnaturelle. Cette notion d’imaginal qu’Henry Corbin a tirée de la mystique musulmane, ce monde imaginal des poètes soufis et des philosophes de l’Andalousie et de l’Iran irrigue subtilement l’enluminure. Le mundus imaginalis est le lieu où le charnel se spiritualise et où l’esprit s’incarne, où le temps s’entrelace à ce qui le transcende, où l’espace de la terre et du ciel se foudroie. Notre vie ici-bas n’est que l’ombre de la vraie, la vivida vita, la vita vitalis de saint Bernard. La miniature s’enivre de paradoxes, s’étourdit d’oxymores et de symboles, absence et présence, délices et tourments ; ce qui dans l’ordre profane n’est que rhétorique, jeu virtuose, revêt dans l’ordre spirituel, une autre nécessité : l’oxymore est coincidentia oppositorum, coïncidence des contraires, réalité paradoxale, expérience indicible, c’est la voie de l’apophase, la théologie négative. [1] Un Mollâ Sadrâ Shirâzi écrira : « Lorsque j’eus persisté dans cet état de retraite, d’incognito et de séparation du monde, pendant un temps prolongé, voici qu’à la longue mon effort intérieur porta mon âme à l’incandescence ; par mes exercices spirituels répétés, mon cœur fut embrasé de hautes flammes. Alors effusèrent sur mon âme les lumières du Malakût [2] tandis que se dénouaient pour elle les secrets du Jabarût [3] et que la compénétraient les mystères de l’Unitude divine. Je connus des secrets divins que je n’avais encore jamais compris. »
Métaphysique des essences ou ontologie ? Voyage de la préexistence transmis par Rûzbehân : « Tout ce temps, je le passai en une profonde nostalgie, car mon cœur plongea alors dans l’océan du ressouvenir de ma préexistence éternelle et dans la senteur des parfums du monde céleste. Plus tard encore firent éclosion en moi les brusques intuitions de fugitives extases, sans commotion physique, bien qu’une certaine douceur envahît mon cœur, tandis que les larmes ruisselaient de mes yeux. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait ; je n’y percevais que ma mémoration de Dieu au présent. » Monde imaginal des néo-platoniciens qui deviendra l’Organon de l’absolu chez les romantiques.
L’enluminure est une mystique de l’éblouissement : la terre incandescente et l’air illuminé où la vie mystique est montrée dans ses cimes :« le calame a gravé tout autour du cœur les hiéroglyphes de l’amour ». [4] Depuis les gâthas de Zoroastre, le feu est concentration spirituelle, onirique et poétique. Le symbolisme est la lumière colorée « en tant que parousie du visible » [5], le spiritus generalis ou Esprit de Dieu, l’irradiation qui créa Borâq, la mystérieuse monture de l’assomption céleste du Prophète. [6]
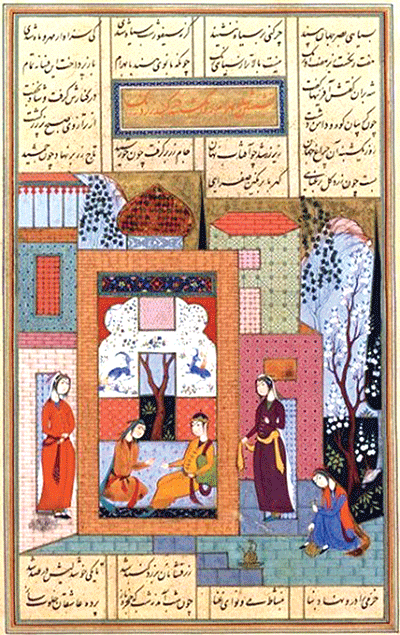
- Le Pavillon des sept princesses de Nezâmi. Dimanche, jour du Soleil, sous la coupole dorée, la princesse byzantine du 2ème climat conte à Bahrâm l’histoire d’un roi dont les concubines sont ensorcelées par une vieille femme bossue vivant dans le palais.
Le voyage chérubinique du pèlerinage vers l’Inaccessible, vers la Réalité prophétique éternelle (Haqiqat mohammadiya) qui toujours se dérobe, « métaphysique qui, dans son refus de l’atteinte définitive et de la possession, illustre non pas tant le motif de la Quête du Paradis que l’idée même du Paradis. » [7] Thème du voyage chez les gnostiques et Philon d’Alexandrie, cette figure centrale du judaïsme au premier siècle de l’ère chrétienne qui, dans ses commentaires sur l’Ancien Testament, interprète de manière allégorique les récits bibliques. Philon, grand admirateur de Platon, veut réconcilier la pensée de ce dernier avec le judaïsme, raison pour laquelle il sera appelé le premier néo-platonicien. Pour lui, la Création a été un processus graduel de moulage de la matière, et c’est au cours de ce processus que le mal a surgi (thème central dans la pensée gnostique). L’âme, emprisonnée dans le corps, a connu une existence antérieure. Pour s’assurer de son salut, l’humanité doit donc briser la servitude de cet emprisonnement et s’élever par une sorte d’extase vers une vision immédiate de Dieu. Un voyage qui rappelle les récits-archétypes (l’expérience de Rûzbehân) pour atteindre le moi spirituel transcendant : « Lorsque je sortis de ma vision, je méditai sur cette parole, mais ce n’est qu’au bout d’un certain temps que je compris qu’elle avait fait allusion aux sept pôles (aqtâb) dans le plérôme céleste (malakût), et que Dieu m’avait accordé la pure substance de leur grade mystique, à savoir le rang des Sept qui sont invisiblement répartis à la surface de la Terre. »
Le néoplatonisme issu du Banquet de Platon véhiculé par Plotin, Porphyre et Proclus est avant tout une mystique de l’Un absolu et originel et pour Proclus, le sommet de l’âme, la « fleur de l’intellect » [8]. Cette mystique de l’Un se retrouvera chez Augustin [9] qui la met en rapport avec la doctrine évangélique de l’Unum necessarium et chez les mystiques rhénans à la fin du Moyen-âge. Dans le Traité Sur le Beau (253 ap. J.-C.), Plotin reprend la démarche spirituelle et platonicienne du Banquet de Platon, lorsque la prêtresse Diotime enseigne à Socrate les voies qui mènent à la Beauté. Les beautés du monde ne sont qu’un reflet fugitif de la beauté transcendante. Néoplatonisme troublé par les cosmologies gnostiques. Dans l’écrit hermétique appelé Poimandrès [10], on voit l’homme-archétype, de nature spirituelle, descendant à travers les cercles planétaires et se montrant à la nature, la puissance du monde sublunaire. Celle-ci voit le reflet de l’homme archétype dans l’eau et son ombre sur la terre. Il s’éprend d’elle : « Alors la Nature, ayant reçu en elle son aimé, l’enlaça toute et ils s’unirent, car ils brûlaient d’amour » : l’apparition du monde sensible est chez les gnostiques, passion et chute de l’âme. La spéculation musulmane tend à concilier le voyage de l’âme des gnostiques et Plotin pour qui l’âme humaine ne vient pas dans un corps mais, projetant un reflet sur lui, elle l’illumine. Nezâmi comprendra le miroir de la Beauté divine dans le sens platonicien de diffraction de la lumière primordiale. Le Pavillon des sept princesses reprend les étapes de la conversion vers la lumière correspondant aux degrés vers lesquels on s’élève, selon le Banquet de Platon, vers la Beauté originelle : beauté des corps, beauté des âmes. Le roman de Nezâmi reflète la force magique de l’amour dans un miroir ensorcelé. On pense à Olympiodore, commentateur néoplatonicien tardif de Plotin et de son miroir de Dionysos : « Les âmes des hommes ayant vu leurs reflets comme dans le miroir de Dionysos sont devenues présentes dans ces reflets, en se précipitant d’en haut. » [11] Le miniaturiste ne copie pas la réalité matérielle, mais l’idée qu’il se fait de la réalité, idée qui cherche à rejoindre le logos, la forme invisible : "Fais éclater d’encre musquée la pointe de ton calame,/ Embaumes-en la brise de l’aube,/ Fais-la danser dans l’ambre gris noir,/ Et passemente, à traits de musc,/ Le champ vert de ta page de soie./ Donne toi de la peine, car ces pages que tu chiffreras/ Formeront le TRESOR DU ROI." [12]
Décisif sera l’usage de la couleur qui fera découvrir la beauté de l’âme vertueuse, la couleur n’étant que le Tout dans sa nécessité noétique ; la couleur de la belle Dame de Rûzbehân : « Quiconque s’accoutume à moi, reçoit de la pure âme de l’âme, la coloration même de la source archétypale (ma’dan asli) de la beauté. Il perd la demi-teinte dérivée qui est la couleur du créaturel éphémère. » [13] Le jaspe et l’émeraude, l’arc-en-ciel, le saphir, couleurs de la lumière éternelle, ce sont aussi les couleurs et les pierres précieuses dont resplendissent les versets de l’Apocalypse.
Nostalgie de la préexistence, nostalgie de l’être Unique, de l’Ens supremum, la voie rédemptrice du pur amour ruine la passion des amants. Les Sawânih d’Ahmad Ghazzâli mettaient en scène l’intolérable disproportion entre l’amour profane et l’initium. Le Soleil de Tabriz pour Rûmi, l’assomption de la théophanie pour Rûzbehân de Shirâz conduisent à la dépossession (fanâ fî-llâh), à la fusion et à l’extinction en Dieu. Cet anéantissement, ce vertige mortel évoque la fulgurante enluminure du miniaturiste ouzbek du XVIe siècle, "le sheikh San’ân terrassé d’amour par sa vision de la Théophanie apparue en la personne de la princesse de Byzance à son balcon." Le corps de l’aimée y est un miroir brûlant, un feu zoroastrien qui se révèle sous les voiles de la déité insondable. Vertigineuse cascade de flammes qui rappelle les Lumières victorielles de l’ « illumination aurorale » de Sohrawardi [14], la vision incandescente et évanouissante de Rûmi qui atomise l’aimé : "Ô Soleil de Tabrîz ! Tu es le soleil lové dans le nuage des lettres ! Quand ton soleil parut se sont abolies les paroles."
Dante, dans le chant XXI du Paradis, évoque l’insoutenable vision de Béatrice : "Car ma beauté qui, sur les degrés de l’éternel palais, brille, comme tu l’as vu, d’autant plus que plus l’on monte, tant resplendit, que si elle ne se tempérait, à son éclat ta puissance mortelle serait comme une feuille que brise la foudre."
Dans l’apothéose rêvée du poète, Béatrice apparaît comme la science des vérités divines en une sublime transsubstantiation. La métaphysique nous entraîne de Rûmi à Dante jusqu’à Gustave Moreau répétant cette puissance inextinguible de l’amour, cette épiphanie de l’absolu dans le visible, ce feu des Grecs antiques- « Le soleil, déclarait Héraclite, est non seulementnouveau chaque jour, mais sans cesse nouveau continûment. [15] Ce déploiement généalogique néo-platonicien ne doit pas surprendre : l’histoire se referme sur un jeu de reflets, de liens analogiques tissés par la théophanie mystique. L’extase est élévation, exaltation dans une accumulation de symboles ainsi que dans le roman Les amours du prince Homây et de la princesse Homâyoûn du poète persan Khwâdjoû Kermânî, contemporain de Dante. Dévotion syncrétique, combinaison et fusion des thèmes appartenant à deux modes cosmologiques de création. Dante, comme Kermâni et Nezâmi, s’inscrivant dans les traditions gnostiques de l’antiquité ; les romans persans ayant pu servir de matrices à La Divine Comédie ou au Songe de Polyphile [16] baigné d’ésotérisme platonicien. Immense arborescence de combinaisons mythopoétiques et de spéculations érudites, la mystique néoplatonicienne de l’islam conduit à l’idéalisation mythique.
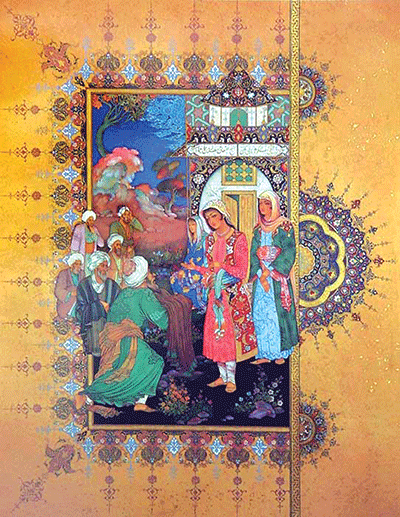
- Sheikh San’ân terrassé d’amour par sa vision de la Théophanie apparue en la personne de la princesse de Byzance à son balcon.
La transmutation alchimique de l’enluminure se reflétant dans l’orbe irradié, la candeur d’une vierge céleste (Homâyoun) saisie par le divin :
Pareille au rubis de ta grotte jaillie,
Hors là, viens-t-en, de ton écrin !
Viens-t’en ! Pareille au flamboyant soleil,
Jusqu’à la lueur de ton zodiaque !
Expérience mystique ou rhétorique érotique du Phèdre de Platon :« Ils regardent l’apparition ; elle flamboie ; c’est le bien-aimé ! Mais à sa vue, les souvenirs du cocher de l’âme se portent vers la réalité de la Beauté : il la revoit, accompagnée de la Sagesse et dressée sur son socle sacré. » [17]
Ces spéculations métaphysiques vertigineuses nous conduisent à une vision plus large et plus plénière encore. Le peintre Gustave Moreau fut un contempteur d’Eros, de l’Eros supérieur, celui qui n’est autre que l’aspiration de Psyché vers la lumineuse splendeur du Bien. Obéissant à la philosophie de Plotin et de la « belle âme » de Hegel [18] :« Que le Bien soit transcendant, c’est ce que montre l’éros qui est inné à l’âme. C’est conformément à cela qu’Eros est uni aux âmes dans les œuvres d’art et dans les mythes. » [19] L’artiste fascina les écrivains Mallarmé, Proust et surtout Joris-Karl Huysmans qui voyait en Moreau un peintre au paroxysme de l’imagination : "Gustave Moreau ne dérivait de personne. Sans ascendant véritable, sans descendants possibles, il demeurait, dans l’art contemporain, unique. Remontant aux sources ethnographiques, aux origines des mythologies dont il comparait et démêlait les sanglantes énigmes ; réunissant, fondant en une seule les légendes issues de l’extrême Orient et métamorphosées par les croyances des autres peuples, il justifiait ainsi ses fusions architectoniques, ses amalgames luxueux et inattendus d’étoffes, ses hiératiques et sinistres allégories aiguisées par les inquiètes perspicuitésd’un nervosisme tout moderne." [20] Dans le roman ہ rebours, le personnage de Des Esseintes se perd parmi les œuvres de sa collection et « scrutait les origines de ce grand artiste, de ce païen mystique, de cet illuminé qui pouvait s’abstraire assez du monde pour voir, en plein Paris, resplendir les cruelles visions, les splendides apothéoses des autres âges. » [21]. Ainsi trouvera-t-on dans cette « peinture subtile, exquise, baignant dans un rêve ancien, dans une corruption antique » [22] des mythes, des archétypes, qui se contamineront avec d’autres archétypes et réincarnations poétiques. Moreau croyait en une cosmologie universelle ; il suivait en cela Eliphas Lévi, adepte de la philosophie occulte et auteur de Fables et symboles (1862), dont il possédait un exemplaire dans sa bibliothèque. Le peintre s’est inspiré de ces symboles extraits des évangiles apocryphes, des traditions rabbiniques et des légendes du Talmud. Parmi les évangiles apocryphes, ceux des premiers gnostiques sont d’admirables symboles kabbalistiques, car les grands hiérophantes du Christianisme étaient initiés à la kabbale. Lévi se situe dans la lignée de l’Apocalypse de saint Jean, des livres de saint Irénée, ceux de saint Clément d’Alexandrie, ceux de saint Denys l’Aréopagite, ceux enfin du savant et poétique Synésius et du Talmud, cette clef occulte de la tradition. Hanté par le passage du cosmos au chaos, partagé entre le désir et la mort, Moreau se perd dans un passé mythique et des images létales indéchiffrables. Pour les deux hommes, le monde dans sa totalité est théophanie et rejoint le nafs [23] de Jurjâni (Ta’rifât).
Dans la théophanie cruelle de Jupiter et Sémélé [24], Moreau use d’images mystiques : le rouge incandescent et l’air illuminé. Dans la révélation de la toute-puissance divine de Jupiter, Sémélé est foudroyée tandis que l’ombre géante et ruisselante de gemmes du dieu dissout l’univers. Pour Gustave Moreau, la mythologie hiérarchise l’ardeur, et l’art a pour fonction d’élaborer le feu : par sa fixité incantatoire, cette toile est l’instrument privilégié d’une élaboration alchimique. C’est la brûlure du cœur éblouie par la lumière céleste. Le feu qui palpite sous les tressaillements mortels de Sémélé et dont l’extinction nocturne motive le désespoir. Architecture enflammée, participant à la fois de la rigueur de la colonne et du fronton antique ainsi que de l’insaisissable mobilité du feu, de l’amour et de l’extase, tel est bien ce tableau érigé en Grand Œuvre mystique, édifié par l’artiste aux extrêmes limites du langage pictural.
La fusion du mythe et de la mythologie ne se pouvait accomplir que dans le feu. Poème eschatologique et cosmologique, Jupiter et Sémélé brûle comme une strophe de l’Avesta. Incendie divin qui n’est pas sans évoquer le Buisson Ardent de Moïse et l’exhortation de Hallâj à pénétrer dans le feu du vouloir divin jusqu’à en mourir, comme le papillon mystique, et à « se consommer ou seconsumeren son objet ». Lumière splendidement insoutenable, celle de l’extase, « L’aurore du bien-aimé s’est levée, de nuit ; elle resplendit, et n’aura pas de couchant. Si l’aurore du jour se lève la nuit, l’aurore des cœurs ne saurait se coucher. » [25] La théophanie destructrice de l’amour se contemplant dans son propre regard. Etreinte au seuil même du mystère fardant les stries de l’aurore des chairs avec du sang. Vision de Sémélé sacrifiée en victime de son audace amoureuse. Son sang se transmue en lumière pure rappelant Rûzbehân : « Mon sang prenait l’aspect des rayons du soleil au moment de son aurore, quand il apparait plus vaste que les cieux et la terre. Et des multitudes d’anges prenaient de mon sang et s’en fardaient le visage. » [26] Il s’agit du passage de l’amour humain à l’amour divin, la pathétique jalousie issue de la mélancolie à présent rédimée. Avicenne pénétré de Platon et d’Aristote a offert une vision de la substance enflammée du désir en son cœur. Le miroir où contempler la face éternelle de Dieu, ce sont les yeux humains illuminés de terreur et d’extase de Sémélé : « Mon anéantissement par ma propre unification de la puissance, se révéla à moi. » [27] L’idolâtrie métaphysique rejointla fonction théophanique de l’image chez Moreau « Telles sont les théophanies des Attributs, car ils sont sans limite » (Rûzbehan). C’est l’éros spirituel, l’éros divin, la religion d’amour du soufisme qui est la rencontre de l’amour divin et de l’amour sensible chez Ibn ‘Arabi. [28] Le feu de la passion se consumant dans la source inaltérable, intarissable « entre les pétales de la rose qui est l’âme de mon amour, tu découvres l’épiphanie du pur amour, les milliers de rossignols, et de colombes que sont les jardins du cœur, les soupirs à la psalmodie douloureuse et suave, leurs ailes-leurs désirs-consumées par le feu d’amour. » [29] Le motif platonicien de l’androgyne rejoint le mythe zoroastrien des fravartis : le tremendum terrible de l’amour, la terreur et la tristesse sublime de Moreau, le sacramentumamoris où se rejoignent Dante, Rûzbehân, Hâfez dans l’adoration extatique et le martyre :« Une ascension vers les sphères supérieures, une montée des êtres épurés, purifiés vers le divin. La mort terrestre et l’apothéose dans l’immortalité. » [30]
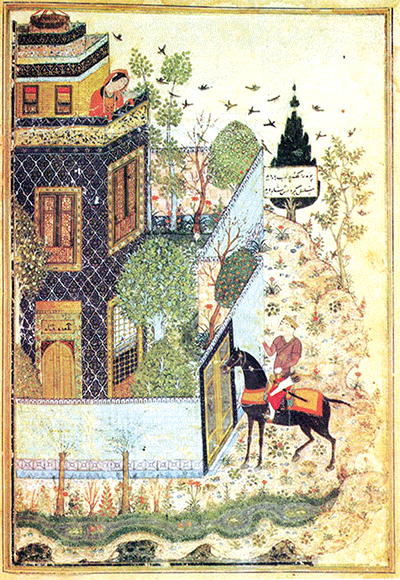
- Les amours du prince Homây et de la princesse Homâyoûn du poète persan Khwâdjoû Kermânî
Le temps n’est plus, ni la douleur. Toute la création se débat dans la nature charnelle ignorante et aveugle des génies, le pneuma matériel et le feu de l’âme animale, les vices et les maléfices de l’idole fermentent dans la peinture et se mêlent aux végétations d’égarement. Sémélé comprenant quel aspect revêt le visage de la Beauté, devint ivre de la divinité. L’expérience de l’amour fou finissant d’espérer l’apocatastase, c’est-à-dire la réintégration finale de toute l’humanité dans la lumière. Ce tableau n’est-il pas les ténèbres au dernier degré et l’icône de la Transfiguration de Denys l’Aréopagite ? Chez Moreau, l’âme charnelle est vouée à l’annihilation et un collyre sanglant aveugle leurs yeux [31] : « Tantôt au contraire avec l’aiguille de la souffrance, il coud fermement l’encolure de son secret. Tantôt avec le feu de l’âme, il brûle par zèle jaloux les provisions secrètes de l’âme charnelle. » [32] La toile reprend ici une curieuse triade : le dieu proférant le logos/lumière et le logos/pneuma ; est-ce un souvenir de Philon ou une trinité chrétienne ?
Le nœud même du syncrétisme de Moreau est la nostalgie de l’aimée au milieu de ruines célestes, son assomption dans les couleurs ardentes des psalmodies coloristes. [33] Ses chevaliers sont des chevaliers soufis s’offrant à des fiancées éternelles, des pèlerins mystiques en quête de l’amour divin : « Les fiancées de la beauté se montrent à eux par l’orifice de la surexistence. » [34] Moreau, dans ses pâles aquarelles, [35]rejoint la miniature persane dans « la transsubstantiation de toute chose en couleurs de lumière. » [36] Dès 1860 et surtout après 1876, Gustave Moreau est influencé par les miniatures orientales et il va réaliser plusieurs versions du Chanteur arabe ou du Poète persanqui fascina Marcel Proust : « Il chante, ce cavalier au visage de femme et de prêtre, aux insignes de roi, que suit l’oiseau mystérieux, devant qui les femmes et les prêtres s’inclinent et inclinent des fleurs, et que regarde son cheval d’un œil tendre comme s’il l’aimait, en levant vers lui son mufle indompté, comme s’il le haïssait et devait le dévorer. Il chante, sa bouche est ouverte, sa poitrine gonfle les branches de roses qui l’enlacent. C’est le moment où on perd pied, où on n’est plus sur la terre ferme, où le vaisseau mis à la mer flotte et déjà miraculeusement s’avance, où la parole, soulevée par les flots rythmiques, devient chant. Et cette palpitation visible se soulève éternellement dans la toile immobile. » [37]
Le Songe du Mongol [38], brillante citation d’une miniature attribuée à Mirzâ ’Ali [39] est une montée spirituelle vers le rêve, vers la lumière sans ombre ni déclin, l’amande éblouissante de la lumière incréée. Sous la forme douce et belle dans la riche splendeur de l’empereur Akbar, le tableau se situe dans l’au-delà du temps. Figure du poète radieux nimbé de l’or de la vie céleste et éternelle, l’azur bleu et jacinthe nuancée de vert, un fil d’or et de sang conduit à la grâce contemplative, la poudre d’or de l’extase. La couleur est consubstantielle aux images de celui qui en fut le peintre, le dramaturge et qui écrivait : « Je suis d’autant plus propre aux rêves, aux fantasmagories de l’imagination que j’apporte à toute lecture, à tout récit des usages, des civilisations, disparues ou lointaines, une naïveté, une crédulité primesautière. » Les lieux sont comme des reliques dont le sens est de rappeler la source céleste, intérieure. Ce langage de sphinx qui contient « en abîme » tous les autres obéit au scintillement des reflets innombrables d’un astre.
« L’esprit purifié par les nombres du temple », ainsi commence un poème de Milosz. Cette architecture symbolique, intérieure, a sa propre beauté. C’est la beauté du chiffre sept, l’unité mystérieuse du visible et de l’invisible, lumineux comme l’écrivit le mystique flamand Ruysbroeck dans les Sept degrés de l’amour spirituel : le septième degré est le « plus haut degré de vie et de trépas, d’amour et de jouissance dans la béatitude éternelle. » Guillaume de Saint-Thierry évoque l’ascension de l’âme à travers les sept degrés du cœur et comme chez Origène, dans les Homélies sur le Cantique des cantiques, l’échelle spirituelle comporte également sept degrés : sept comme les dons de l’esprit, sept comme les jours de la Genèse. L’échelle est un archétype : dans le songe de Jacob, elle relie le ciel et la terre. « L’échelle du Royaume, disait saint Isaac le Syrien, est cachée au-dedans de toi-même. Lave-toi du péché et tu verras les degrés de ton ascension. » L’échelle spirituelle est échelle sainte selon Jean Climaque. Dante obéit à la mystique nuptiale, dont le Cantique des cantiques est la source. Béatrice est la théophanie primordiale, le mystère de l’Anthropos céleste, la révélation du Soi divin (dhât), connaissable seulement pour l’initié. Dans la Divine comédie, Dante s’inspire à la fois de la terminologie chrétienne des sept péchés capitaux mais aussi de l’éthique d’Aristote. L’Enfer a la forme d’un cône renversé composé de cercles. Lucifer, ange déchu, se trouve au centre de la terre, le lieu le plus éloigné de Dieu. Dans le chant neuvième du Purgatoire, Dante voit en songe un aigle aux ailes d’or qui l’enlève jusqu’à la région du feu. A son réveil, il est à l’entrée du Purgatoire, dans les bras de Lucie ou la grâce illuminante. Il est accueilli par le "Te Deum Laudamus" prière d’action de grâce et de reconnaissance. Avec son épée, l’ange grave sept fois la lettre P sur le front du poète comme un symbole des sept péchés capitaux. Achaque cercle du Purgatoire qu’il franchira, Dante verra s’effacer l’une de ces lettres.
Verger de symboles, tapisserie aux mille fleurs qui sont des chiffres, des sceaux, verger spirituel de l’occident, la Divine comédie s’ouvre sur l’abîme d’un songe et nous y sommes éclairés d’une autre lumière, ou s’ouvre comme un retable. L’élection du héraut angélique obéit à la souveraineté de l’amour, au platonisme chrétien. Dans le chant vingt-neuvième, Dante accompagne la belle dame Mathilde et remonte le cours du Léthé. De l’autre côté se déroule une procession étrange et éblouissante dont les éléments ont une valeur symbolique. C’est l’Eglise qui vient au-devant du pécheur repentant pour entendre sa confession et l’accueillir parmi les élus. Le char est tiré par un Griffon, animal fantastique au corps de lion et aux ailes d’aigle symbolisant les deux natures de Jésus-Christ (le Lion symbolise l’homme et l’Aigle symbolise le divin). Il est entouré de trois dames qui représentent les vertus théologales : la Charité ardente est couleur de feu, le vert est la couleur de l’Espérance et le blanc celle de la Foi. Les quatre autres sont les quatre vertus cardinales : la Force, la Tempérance, la Justice et la Prudence. Un candélabre étincelant représente les sept dons de l’esprit et les sept grâces du Saint-Esprit.

- Feuille d’études pour le Chanteur arabe ou le Poète persan, musée Gustave Moreau, Paris
Il s’établit tout un réseau spirituel, une correspondance, un tissu d’analogies, une polyphonie, une symphonie, un chœur, une harmonie, où les réalités charnelles sont le miroir de ce qui ne peut se concevoir ni se dire dans les bornes de notre expérience. Adoration du sept jusqu’à le concevoir comme nombre absolu, éternel, divin. Paradisum. Le monde du sept est symbole et miroir. Nezâmi (XIIe siècle), poète persan médiéval, aurait-il inspiré Béatrice de Nazareth (1200-1268) cistercienne de Louvain et ses Sept degrés de l’amour, le poète comme la béguine devenant le point de concentration et le transcendant exutoire de tous les désirs de complétude, un être au destin unique et incomparable en ses amoureuses vénérations ?
Dans la quatrième des Sept manières d’amour, Béatrice de Nazareth, elle-même, écrivait ces lignes : "Parfois, il arrive que l’amour s’éveille doucement dans l’âme et se lève joyeusement, qu’il se fasse sentir dans le cœur sans aucun concours de l’action humaine. Le cœur alors est si tendrement touché par l’amour, si instamment attiré, si passionnément saisi et si fortement envahi et si aimablement embrassé que l’âme est tout entière vaincue par l’amour." Elle sent alors que Dieu est très proche, elle éprouve une nette clarté d’esprit, une merveilleuse béatitude, une noble liberté, une ravissante douceur, un fort enlacement par un amour puissant, une plénitude surabondante d’ineffables délices. Et elle ressent alors que tous ses sens sont unifiés dans l’amour, que sa volonté est devenue amour, qu’elle est très profondément enfoncée et engloutie dans l’abîme de l’amour et qu’elle est tout entière devenue amour. La beauté de l’amour l’a mangée, la puissance de l’amour l’a dévorée, la douceur de l’amour l’a absorbée, la grandeur de l’amour l’a engloutie, la noblesse de l’amour l’a embrassée, la pureté de l’amour l’a ornée, la hauteur de l’amour l’a exaltée et l’a tellement unie à lui qu’elle lui appartient tout entière et ne peut s’occuper que de lui. Lorsqu’elle ressent cette surabondance de béatitude et cette plénitude de cœur, son esprit s’abîme tout entier dans l’amour. Elle ne maîtrise plus son corps, son cœur se liquéfie et toutes ses forces l’abandonnent. Elle est tellement vaincue par l’amour qu’elle peut à peine se tenir et que souvent elle perd le contrôle de ses membres et de ses sens.
Les mystiques Ruzbêhan et Rûmi ne sont pas sans évoquer la Marguerite Porete du Miroir des âmes simples et anéanties et Hadewijch d’Anvers, béguine du treizième siècle : « Si nous voyions, lumière en sa lumière,/ Dans son abîme la clarté première ». Visions intellectuelles, visions sensibles qui sont le miroir du cœur du poète extatique, brisant la trêve entre le fini et l’Infini dans la fureur d’aimer, l’ire d’amour qui emporte au-delà de tout. Miroir et magie de ces strophes traduites du flamand et rappelant le bruissement énamouré, le battement d’ailes d’une colombe des poèmes de Saadi :
Son amour est si parfumé,
Que mon âme en reste pâmée
Je m’enivre à pleines gorgées
Du noble et divin cordial [40]
Il est certains endroits qui sont le seuil et l’orée d’un lieu d’une tout autre nature où ne règnent plus notre temps ni notre espace. Lieux comme transfigurés par une brèche dans la couleur qui lie ciel et terre, corps et âme dans une Union mystérieuse. Peintre hybride et énigmatique, Gustave Moreau intègre le rêve mystique. L’artiste prend donc clairement sa place dans l’itinéraire spirituel qui conduit de Nezâmi à Dante, reliés par une profonde continuité. C’est parce que Moreau a parcouru tout le chemin qui va de Prométhée à Orphée en passant par Hâfez et Rûmi qu’il parvient à transcender l’héritage de la miniature persane et à transfigurer l’épreuve en œuvre d’art. C’est peut-être en lui qu’apparait le mieux, sous son aspect le plus étrange, cette déchirure intérieure de l’art et du mythe persans. Miniature surnaturelle, merveille resplendissante et douce qui bruisse du passage des anges. Ainsi, le cœur du sentiment mystique serait-il que l’Amour est souverain et que nous vivons devant un voile et le souvenir de notre exil, de notre chute ? « Ce que je veux, c’est justement l’introuvable » écrivait Mowlavi.
Notes
[1] En référence à la rigoureuse theologia negativa du shî’isme ismaélien
[2] Le monde angélique
[3] Le monde des pures intelligences chérubiniques
[4] Ruzbehân, Le Jasmin des fidèles d’amour, p. 125.
[5] Ishaghpour, Youssef, La Miniature persane. Les couleurs de la lumière : le miroir et le jardin, Farrago, 1999, p. 49.
[6] Voir Shaykh Ahmad Ahsâ’i et le symbolisme des quatre colonnes du Trône.
[7] Henry Corbin, introduction à Molla Sadra Shirazi, Le Livre des pénétrations métaphysiques (Kitâb al-Mashâ’ir), Verdier, 1988, p. 78.
[8] Proclus, De decemdubit, 64, 9.
[9] Augustin, Confessions, XI 29, 39 ; Sermo 255, 6 ; cf. De musica VI 17.
[10] Poimandrès, 14, dans A. D. Nock et A. J. Festugière, Corpus hermeticum, T.1, Paris, 1945, p. 11.
[11] Plotin, Ennéades, IV, 3, 12, 1.
[12] Nezâmi, Le Pavillon des sept princesses, traduit par Michael Barry, Gallimard, Connaissance de l’orient, p. 42.
[13] Ruzbehân, Le Jasmin des fidèles d’amour, p. 49.
[14] Shibâboddîn Yahya Sohravardî, Shakh al-Ishrâq, Le Livre de la Sagesse orientale, traduction et notes Henry Corbin, Verdier, 1986.
[15] Les Présocratiques, Gallimard, La Pléiade.
[16] Hypnerotomachia Poliphili, ou Songe de Poliphile, rédigé en 1467 est un roman platonicien.
[17] Platon, Phèdre, 250-254.
[18] Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, VI, C, traduction Hyppolyte, Paris, 1947, tome 2, p. 186.
[19] Plotin, Ennéades, VI, 9, 9.24.
[20] Huysmans, Joris-Karl, A Rebours, 1884, GF Flammarion, p. 109.
[21] Ibid.
[22] Ibid, p. 104.
[23] Le mot nafs (en hébreu nefesh) a bien des significations. Il désigne selon Jurjâni « la substance vaporeuse subtile qui est le siège de la force vitale » et se traduit par « âme ».
[24] Jupiter et Sémélé, huile sur toile, 213 x 118 cm 1894, Paris, Musée Gustave Moreau.
[25] Husayn Mansûr Hallâj, Dîwân, traduit et présenté par Louis Massignon, Editions du Seuil, p. 67.
[26] Avicenne, Epître sur l’amour, texte arabe publié par M A F Mehren, 1979.
[27] Ruzbehân, p. 46.
[28] Ibn ’Arabi, Traité de l’amour, introduction et traduction de l’arabe par Maurice Gloton, Paris, Albin Michel, 1986.
[29] Ruzbehân, p. 67.
[30] Ary Renan, Gustave Moreau, 1900, p. 115.
[31] Galatée, huile sur toile, 85 x 67 cm, 1880. Musée d’Orsay, Paris.
[32] Ruzbehân, p. 127.
[33] Rêve d’orient aquarelle et rehauts de gouache, 37 x 24 cm, 1894, collection particulière.
[34] Ruzbehân, p. 239.
[35] Chanteur arabe, aquarelle avec rehauts de gouache blanche, 20,7 x 14,3 cm, 1884.
[36] Youssef Ishaghpour, La Miniature persane, Les couleurs de la lumière : le miroir et le jardin, Farrago, 1999, p. 34.
[37] Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Paris, 1971, p. 670.
[38] Le Songe du Mongol, aquarelle avec quelques rehauts de gouache, 26 x 22,2 cm, 1881. Collection Hiroshi Matsuo, Japon.
[39] Barbad jouant de la musique pour Khosrow, planche 26, feuillet 77 verso, attribué à Mirzâ ‘Ali.
[40] Ruysbroeck, Le Livre des douze béguines ou de la vraie contemplation, traduit du flamand par P. Cuylis, Bruxelles, 1909.

