
|
Le discours des écrivains francophones : de la blessure linguistique à l’épanouissement culturel
La francophonie, ce concept élastique et confus, suscite toujours des débats et des interrogations portant sur sa nature multidimensionnelle où se superposent le linguistique, l’idéologique, le politique, le géographique, l’historique et l’institutionnel. Substantif dérivé du terme francophone utilisé pour la première fois par le géographe français Onésine Reclus vers 1887 [1], la francophonie, en tant que néologisme inventé pour désigner un ensemble de pays où le français n’est pas la seule langue à être parlée, va tomber dans l’oubli pendant plus de 80 ans avant d’être ressuscité vers 1962 par, cette fois-ci, des écrivains, majoritairement, issus d’anciennes colonies françaises. Avec eux, le terme prendra une signification où la définition de Reclus ne tient qu’une place très étroite. En effet, la francophonie, notion devenant de plus en plus vague, sera assimilée à une certaine entreprise polyvalente dirigée, d’un côté, par les pouvoirs gouvernementaux de la France métropolitaine qui se veut non pas une figure colonialiste mais, plutôt, une grande puissance protectrice des valeurs humaines dans ses colonies de jadis, et, de l’autre côté, par des intellectuels, des politiciens et, tout particulièrement, des écrivains essentiellement non français dont les opinions divergent sur la position à prendre vis-à-vis de cet état de fait.

- Onésine Reclus
Ayant réalisé que la réussite de ses desseins impériaux ne dépendait pas uniquement d’une forte présence militaire sur les territoires occupés, la France coloniale avait jugé nécessaire d’envahir culturellement et linguistiquement ses colonies. Et pour ce faire, elle n’avait épargné aucun effort pour faire de l’apprentissage du français un privilège et un avantage dont bénéficieront les rares chanceux qui auront l’occasion d’accéder à ses écoles. Et comme la langue est, par excellence, l’ambassadrice des idées, l’administration coloniale n’a pas hésité à en faire un instrument de manipulation et de déculturation des autochtones.
Ainsi, une fois indépendantes, ces anciennes colonies se jettent à bras ouverts dans l’anarchie et l’instabilité sociale. Des litiges politiques surgissent et des contestations populaires s’éclatent. Et parallèlement à ces remous sociaux, des débats littéraires ont lieu pour discuter de l’apport de la colonisation française et de l’attitude à prendre à l’égard de l’ex-colonisateur. Et c’est ainsi que la notion de francophonie sera, elle aussi, exposée à des critiques traitant de sa nouvelle signification, celle d’après la décolonisation. Mais, au milieu de cette situation confuse, une réalité était sûre : dans les rangs des écrivains qui se sont trouvés en train d’écrire en français et qu’on a réunis sous l’étiquette de « Francophones » se croisent, en fait, diverses sensations et se répand un sentiment de désarroi face au rapport à entretenir avec la langue française. C’est ce que nous essayerons de démontrer en passant en revue successivement les opinions des écrivains qui voient dans leur bilinguisme un malheur et une répercussion dramatique du colonialisme, et celles des écrivains qui considèrent l’écriture en français comme une aventure linguistique agréable et une conquête culturelle qui ne peut en aucun cas altérer leur identité.

- Albert Memmi
En effet, à cette situation de décentrement géographique dont souffrent les écrivains francophones qui mènent une vie d’éloignement, d’exil et d’errance, s’ajoute une autre forme d’hybridation qui frappe leur être et qui prend une allure linguistique. Il s’agit de ce plurilinguisme auquel ils sont souvent confrontés vu que leurs pays d’origine sont des théâtres où se bousculent plusieurs langues et dialectes. C’est ce qui fait de leur expression en français, langue étrangère et importée, un « choix » dont les termes sont aléatoires. Et c’est dans ce cadre que s’inscrit la réaction rebelle de certains auteurs qui se sont trouvés obligés de s’exprimer en français, langue d’occupation et d’aliénation, langue imposée et incapable de traduire avec fidélité leurs pensées profondes, leurs sensations et leurs désirs. Pour ces personnes, le français n’est pas la langue du pathos ni celle qui reflète leur vraie identité : il ne saurait jamais remplir la place de la langue maternelle. C’est ce qui explique cette impression d’oppression qui pèse sur l’écrivain francophone dont l’acte d’écrire se transforme d’une geste cathartique à un calvaire psychologique dû au conflit permanent qui l’habite en tant qu’ex-colonisé qui n’arrive pas à se débarrasser de la langue de son ex-colonisateur.
A vrai dire, il s’agit d’un combat sans merci entre deux royaumes psychiques et culturels incompatibles représentés par deux langues disparates qui représentent chacune un univers symbolique différent et distinct. C’est pourquoi l’acte d’écrire en français, langue dominante, dégénère en épreuve douloureuse chez l’écrivain et essayiste franco-tunisien Albert Memmi qui considère le bilinguisme colonial comme une conséquence douloureuse du choc de ces deux univers :

- Abdelkébir Khatibi
"[Pour lui], le bilinguisme colonial n’est ni une diglossie, où coexistent un idiome populaire et une langue de puriste, appartenant tous les deux au même univers affectif, ni une simple richesse polyglotte, qui bénéficie d’un clavier supplémentaire mais relativement neutre ; c’est un drame linguistique." [2]
Certainement, en voyant la langue du colonisateur prendre le dessus sur celle de ses ancêtres, le colonisé ne peut qu’éprouver un sentiment de malaise :
"Dans le conflit linguistique qui [l’] habite, sa langue maternelle est l’humiliée, l’écrasée [...] De lui-même, il se met à écarter cette langue infirme, à la cacher aux yeux des étrangers, à ne paraître à l’aise que dans la langue du colonisateur." [3]
Ce même sentiment de déperdition linguistique apparaît chez le sociologue et romancier marocain Abdelkébir Khatibi qui parle de l’impossibilité d’un bilinguisme intégral, puisqu’un travail de hiérarchisation s’effectue obligatoirement et automatiquement dans la pensée de l’écrivain bilingue qui se doit de marquer une prédilection pour une seule langue, pour celle de l’écriture et de la création littéraire. Et bien évidemment, ce choix ne peut se faire qu’au détriment de la langue délaissée. C’est ce qui débouche sur un désordre psychique où l’identité personnelle de l’écrivain se voit mise en cause :

- Abdelwahab Meddeb
"Quand j’écris en français, ma langue maternelle se met en retrait : elle s’écrase. Elle rentre au harem. Qui parle alors ? Qui écrit ? Mais elle revient (comme on dit…). Et je travaille à la faire revenir quand elle me manque. Mais elle revient, ai-je dit, seule, fragmentaire, mutilée…", [4] avait-il déclaré.
L’écrivain et poète tunisien Abdelwahab Meddeb partage l’analyse de Khatibi et pense que l’établissement d’une hiérarchie entre la langue maternelle et les autres langues est une démarche indispensable pour une production littéraire réussie, et qu’il est un des risques du bilinguisme qu’il faut assumer :
"Au sens strict, le dialecte tunisois est ma langue maternelle, langue vite perçue impure, trouée par maints emprunts manifestes, surtout siciliens, pour désigner la timide entrée dans une modernité pauvre et distante." [5]
L’Algérien Kateb Yacine, quant à lui, verra dans son expression en français une répercussion directe de la politique d’aliénation présidée par l’administration coloniale qui n’avait épargné aucun effort pour imposer sa langue et marginaliser celle des autochtones. C’est cette conviction qui l’a poussé à répondre ainsi à une question qui lui a été posée sur les raisons de son recours à l’écriture en arabe parlé au lieu de l’arabe classique :

- Kateb Yacine
"Si j’ai été obligé de me couler dans la langue française une première fois et si je suis conscient qu’il s’agit d’une aliénation, pourquoi irais-je renouveler cette aliénation en arabe, par ce que l’arabe n’est pas ma langue non plus." [6]
L’écrivain et poète suisse Charles Ferdinand Ramuz exprimera son amertume face à cette relation dichotomique qui lie les écrivains francophones à la métropole dans sa lettre à Bernard Grasset où il annonce :
" Vous êtes des Français de France, nous des Français de langue […] Nous sommes à la fois liés avec vous par une étroite parenté […], et étrangers à vous pour de nombreuses autres raisons […] Vous voyez, nous sommes « à cheval » c’est-à-dire dans une situation bien douloureuse et incommode." [7]
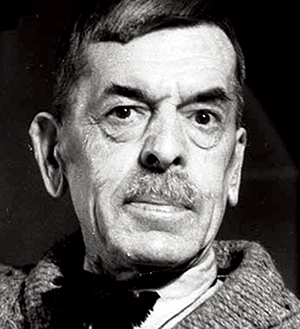
- Charles Ferdinand Ramuz
Il résulte de ces témoignages que le bilinguisme est synonyme d’une expérience linguistique déchirante qui menace l’identité personnelle et nationale des écrivains francophones. Mais, éloignant tout sentiment de méfiance, d’autres figures de la littérature francophone vont rejeter cette attitude conflictuelle et opter, au contraire, pour l’éloge de leur contact avec la langue française. Loin d’être périlleuse, l’expression en français a été pour un certain nombre d’écrivains le moyen linguistique idéal pour la réalisation d’une odyssée culturelle joyeuse. Le statut de francophones était, pour ces personnes, synonyme de création, d’invention et de conquête d’un nouvel imaginaire. C’est ce qui a donné naissance à une panoplie de positions favorables à l’égard du français.
Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor est l’une des figures les plus illustres qui ont défendu la francophonie avec ardeur. Pour lui, la langue française est un repère humanitaire. Elle est une source d’inspiration pour tous les intellectuels et, par conséquent, elle est la langue de culture qui permet d’atteindre l’universel :
"Mais on me posera la question : ’Pourquoi, dès lors, écrivez-vous en français ?’ parce que nous sommes des métis culturels, parce que, si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à vocation universelle que notre message s’adresse aussi aux Français de France et aux autres hommes, que le français est une langue « de gentillesse et d’honnêteté ». Car je sais ses sources pour l’avoir goûté, mâché, enseigné, et qu’il est la langue des dieux. Écoutez donc Corneille, Lautréamont, Rimbaud, Péguy et Claudel. Écoutez le grand Hugo. Le français, ce sont les grandes orgues qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l’orage. Il est, tour à tour ou en même temps, flûte, hautbois, trompette, tam-tam et même canon. Et puis le français nous a fait don de ses mots abstraits - si rares dans nos langues maternelles -, où les larmes se font pierres précieuses. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève et de sang ; les mots du français rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui éclairent notre nuit " [8], explique-t-il.

- Léopold Sédar Senghor
D’après Senghor, le français est un modèle stylistique intangible à qui nous devons répondre par un purisme vigoureux. C’est pourquoi il nous recommande de combattre toute modification syntaxique qui ne s’harmonise pas avec les caractères fondamentaux de la langue française. Et, en réponse à ceux qui parlent de dépaysement et de déculturation, il annonce qu’il n’y a pas de contradiction ou d’opposition entre la négritude et la francité.
La psychanalyste et écrivaine française d’origine bulgare Julia Kristeva refuse, elle aussi, toute idée de déracinement ou de perte en parlant de son choix du français :
"Est-ce qu’il y a deuil dans ma situation ? Non, je ne le crois pas. Rien n’est mort. Chaque élément, y compris l’originaire, a été prospecté et réapproprié dans une autre langue. Il n’y a pas de douleur ou de regret vis-à-vis du bulgare. C’est un jardin secret, mais j’en ai d’autres. J’ai eu la chance, alors que je suis née dans cette Bulgarie bloquée dans les Balkans et le totalitarisme, d’apprendre le français et l’anglais à l’école maternelle" [9], affirme-t-elle.
Cette déclaration conteste donc la justesse des points de vue disant que les tréfonds de l’être humain ne pourront jamais s’extérioriser à travers une langue étrangère à celle des origines considérée comme langue pulsionnelle. Pour Kristeva, la rencontre avec d’autres langues n’entraîne pas, nécessairement, un état mélancolique mais elle peut être, en revanche, une aventure existentielle positive qui permet à l’être de se retrouver et de se reconnaître. C’est ce que ces mots semblent confirmer :

- Gaston Miron
"J’ai éprouvé une sorte de séduction pour le français et, dès que j’ai eu la possibilité de choisir, je me suis reconnue dans cette langue. La séparation d’avec l’origine ne crée pas forcément un manque ou un état mélancolique. La polyphonie, la pluralité culturelle et personnelle me sont apparues joyeuses. On s’y invente un nouveau style, une nouvelle façon de parler, grâce au jeu dialectique des deux langues. On échappe à la pesanteur des origines. On essaie…" [10]
Dans un autre ordre d’idées, le poète québécois Gaston Miron opte pour un contact fructueux et équitable avec la langue française dont les dimensions universelles ne peuvent que servir les spécificités culturelles et identitaires canadiennes :
"C’est entendu, nous parlons et écrivons en français et notre poésie sera toujours de la poésie française. D’accord. Mais notre tellurisme n’est pas français et, partant, notre sensibilité, pierre de touche de la poésie ; si nous voulons apporter quelque chose au monde français et hisser notre poésie au rang des grandes poésies nationales, nous devrons nous trouver davantage, accuser notre différenciation et notre pouvoir d’identification. Sans cesser d’écrire en un français de plus en plus correct, voire de classe internationale. Nous aurons alors une poésie très caractérisée dans son inspiration et sa sensibilité, une poésie canadienne d’expression française et, si nous savons aller à l’essentiel, universelle." [11]
Le recours rationnel à l’usage du français s’est traduit chez le philosophe et écrivain roumain Emil Michel Cioran par la nécessité d’apporter des modifications à cette langue en vue d’assurer une meilleure rencontre linguistique comme en témoignent ces propos :

- Le Martiniquais Raphaël Confiant
"Aujourd’hui, l’écrivain veut avoir son style à lui, s’individualiser par l’expression ; il n’y arrive qu’en défaisant la langue, qu’en violentant ses règles, qu’en sapant sa structure, sa magnifique monotonie." [12]
Ces procédures de déconstruction arrivent à leur point culminant avec des œuvres littéraires où la création langagière débouche sur la naissance d’une langue nouvelle où se mélangent des éléments sociolinguistiques originels et des échos de la culture française acquise. Rappelons à cet égard l’exemple du français créolisé avec le Martiniquais Raphaël Confiant et celui du français « malinkisé » avec l’Ivoirien Ahmadou Kourouma.
En fait, l’écrivain francophone finit souvent par cacheter ses écrits avec des empreintes relevant de son héritage linguistique et culturel personnel. Le Congolais Tchicaya U Tam’Si parle même d’une opération de colonisation :
"Il y a que la langue française me colonise et que je la colonise à mon tour, ce qui, finalement, donne bien une autre langue." [13], avoue-t-il.
Cela revient à dire que ces tentatives de réconciliation donnent lieu à une poétique originale qui peut s’orienter vers la création de néologismes alliant le français et la langue concurrente ou vers l’incorporation de termes non français dans le texte français, de sorte que l’inconfort dans le bilinguisme devient source de fécondité littéraire.
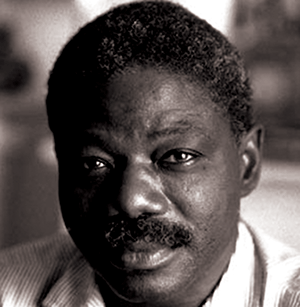
- Tchicaya U Tam’Si
Il ressort de ces différents aveux que la situation des écrivains francophones est très complexe. Ainsi, en plus du déchirement ressenti par ceux qui se sont vus obligés de délaisser leur langue maternelle pour s’exprimer en français, différents obstacles viennent perturber la création littéraire de ceux que la langue française fascine.
En effet, les dimensions idéologiques et sociopolitiques que prend la littérature francophone ne font qu’élargir les disparités et approfondir le fossé qui sépare les visions des parties antagonistes. Toutefois, une réalité s’avère certaine au milieu de cet amas hétéroclite de positions : loin d’être une entrave, la situation confuse de l’écrivain francophone lui sert, paradoxalement, d’élément stimulateur et de source de dynamisation spirituelle.
Onésine Reclus
Albert Memmi
Abdelkébir Khatibi
Abdelwahab Meddeb
Kateb Yacine
Charles Ferdinand Ramuz
Léopold Sédar Senghor
Gaston Miron
Le Martiniquais Raphaël Confiant
Tchicaya U Tam’Si
Bibliographie :
![]() Dion, Léon Québec, 1945-2000, Tome 1, À la recherche du Québec, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 1987.
Dion, Léon Québec, 1945-2000, Tome 1, À la recherche du Québec, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 1987.
![]() Dollé, Marie, L’imaginaire des langues, L’Harmattan, Paris, 2001.
Dollé, Marie, L’imaginaire des langues, L’Harmattan, Paris, 2001.
![]() Gafaiti, Hafid, Kateb Yacine. Un homme, une œuvre, un pays, entretien suivi de Loin de Nedjma, poème inédit (1947), Ed. Laphomic, coll. Voix multiples, Alger, 1986.
Gafaiti, Hafid, Kateb Yacine. Un homme, une œuvre, un pays, entretien suivi de Loin de Nedjma, poème inédit (1947), Ed. Laphomic, coll. Voix multiples, Alger, 1986.
![]() Ghirelli, Marianne, C.F. Ramuz : Qui êtes-vous ?, Editions de la Manufacture, Lyon, 1988.
Ghirelli, Marianne, C.F. Ramuz : Qui êtes-vous ?, Editions de la Manufacture, Lyon, 1988.
![]() Khatibi, Abdelkébir, Pro-Culture n° 12, Spécial Khatibi, Rabat, 1978.
Khatibi, Abdelkébir, Pro-Culture n° 12, Spécial Khatibi, Rabat, 1978.
![]() Kristeva, Julia "En deuil d’une langue ?", Autrement, n° 128, mars 1992, "Deuils - Vivre c’est perdre", Paris, mars 1992, pp.27-36.
Kristeva, Julia "En deuil d’une langue ?", Autrement, n° 128, mars 1992, "Deuils - Vivre c’est perdre", Paris, mars 1992, pp.27-36.
![]() Meddeb, Abdelwahab, “Le palimpseste du bilingue. Ibn ‘Arabi et Dante”, in Du bilinguisme, Denoël, Paris, 2000, pp. 125-140.
Meddeb, Abdelwahab, “Le palimpseste du bilingue. Ibn ‘Arabi et Dante”, in Du bilinguisme, Denoël, Paris, 2000, pp. 125-140.
![]() Memmi, Albert, Portrait du colonisé ; précédé du Portrait du colonisateur, Payot, Paris, 1973.
Memmi, Albert, Portrait du colonisé ; précédé du Portrait du colonisateur, Payot, Paris, 1973.
![]() Reclus, Onésine, La France et ses colonies, Ed. Hachette et Cie, Paris,1887.
Reclus, Onésine, La France et ses colonies, Ed. Hachette et Cie, Paris,1887.
![]() Rombaut, Marc, Nouvelle poésie négro-africaine : la parole noire, Éditions Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1976.
Rombaut, Marc, Nouvelle poésie négro-africaine : la parole noire, Éditions Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1976.
![]() Senghor, Léopold Sédar, Éthiopiques, Seuil, Paris, 1956.
Senghor, Léopold Sédar, Éthiopiques, Seuil, Paris, 1956.
Notes
[1] Onésine Reclus, La France et ses colonies, Paris, Ed. Hachette et Cie, 1887.
[2] Albert Memmi, Portrait du colonisé ; précédé du Portrait du colonisateur, Paris, Payot, 1973, p. 136.
[3] Ibid.
[4] Abdelkébir Khatibi, Pro-Culture n° 12, Spécial Khatibi, Rabat, 1978, p. 49.
[5] Abdelwahab Meddeb, “Le palimpseste du bilingue. Ibn ‘Arabi et Dante”, in Du bilinguisme, Paris, Denoël, 2000, pp. 125-140.
[6] Kateb Yacine, Un homme, une œuvre, un pays, Entretien réalisé par Hafid Gafaïti in Voix multiples, Alger, Éditions Laphomic, 1986, p. 45.
[7] Cité par Marianne Ghirelli dans C.F. Ramuz : Qui êtes-vous ?, Lyon, Éditions de la Manufacture, 1988, p. 213.
[8] Léopold Sédar Senghor, Postface, Éthiopiques, Paris, Seuil, 1956.
[9] Julia Kristeva, "En deuil d’une langue ?", Autrement, n° 128, mars 1992, "Deuils - Vivre c’est perdre", Paris, mars 1992, p.27.
[10] Ibid.
[11] Cité par Léon Dion dans Québec, 1945-2000, Tome 1, À la recherche du Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987, p. 46.
[12] Cité par Marie Dollé dans L’imaginaire des langues, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 164.
[13] Marc Rombaut, Nouvelle poésie négro-africaine : La Parole noire, Paris, Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1976, p. 141.

