
|
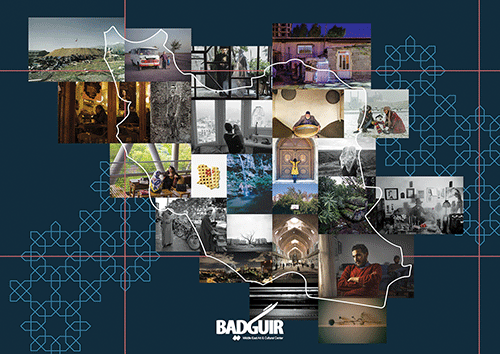
Lors de sa venue en France l’année dernière, la photographe Shâdi Ghadiriân concluait ainsi la présentation de son œuvre et celle de certains de ses confrères : “Il y a beaucoup de complexité culturelle et humaine dans mon pays, l’Iran est le dix-huitième pays le plus grand du monde. Il y a plus de vingt-cinq groupes ethniques et soixante-quinze dialectes, il est très difficile de montrer la réalité de la vie des femmes.” L’Iran, comme un puzzle à la réalité multiple, à composer au gré de ses paysages, ses habitants, son histoire.

- Sinâ Shiri, No man’s land
Invités au voyage, nous sommes allés découvrir le kaléidoscope présenté par l’association Badguir, la belle exposition Iran Photo. Une idée originale qui nous a conduits de Téhéran à Ispahan en passant par Mashhad ou la région du Guilân, avec vingt-quatre artistes, dix conviés et déjà reconnus en France, quatorze dont le talent a été repéré suite à un appel à candidature. Vingt-quatre illustrations de la photographie contemporaine et autant de possibilités pour nous de passer au-delà des images ou des idées reçues. Tenter de découvrir l’Iran autrement.
« Les vrais voyageurs sont ceux qui partent pour partir, cœur léger. » Alors allons. Commençons par suivre Sinâ Shiri dans son ‘no man’s land’, faisons ensemble un bout de chemin sur une route de campagne, entre deux villes, à la rencontre d’un homme et de son fils. Attendons de voir si le van et le bunker d’un autre temps décolleront comme de petits ovnis et s’ils nous mèneront jusqu’à Sinâ Momtaheni, contempler « la nuit brillante », sur l’île de Kish. Et saisir ce que la petite porte de toile et sa lumière contenue ont volatilisé de notre monde.
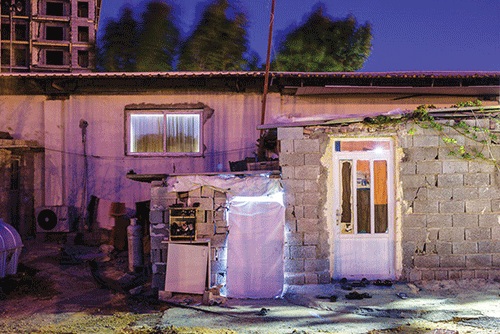
- Sina Momtaheni, La nuit brillante
La surprise se cache à l’intérieur, dans ce que l’on voit moins tant on le côtoie de près, dans les « rencontres » du quotidien offertes par Alborz Kazemi. Le chardon sous la lumière rosée, la petite fleur séchée, compagne oubliée, devenue floue et imperceptible. La lumière qui dessine un début de visage ou ponctue de façon fantaisiste le canapé vide, à la chaleur d’un matin ou d’une fin d’après-midi. Une image de l’absence et du bien-être ou d’une tristesse légère.

- Alborz Kâzemi, Rencontres
On part. Sans vapeur et sans voile, on retrouve les impressions et les ressentis persistants que nous laissait la caresse d’un sofa ou d’un lieu sans qu’on puisse se les représenter vraiment. Doucement, nous rentrons dans ce quotidien que n’interrompt jamais le regard du photographe, et avançons jusqu’à l’intime, guidés par Mohsen Shahmardi et la collection « Bi Nam ». Du haut d’un petit appartement cloisonné, observatoire sublimé par le lien particulier qui unit les maîtresses à leurs animaux de compagnie, nous contemplons Téhéran.

- Azin Nafar Haghighi, Moments
Vue de l’intérieur par une dame et son chien, la ville, décor brumeux, se dessine derrière la vitre et éveille notre curiosité. Par-delà la solitude perceptible de ces êtres qui en sont un peu exclus, en partie à cause de leur relation singulière, transparaissent la proximité et la finesse de leur lien. Quelque chose qui se donne à voir sans attirer l’attention, dans un geste naturel et presque anodin, du côté de l’inframince évoqué par Marcel Duchamp. La subtilité et la tendresse face à l’extérieur qui semble si lointain, une fois passée la barrière de la fenêtre.
Chez Azin Nafar Haghighi, la distance est là aussi. Celle aux autres et à soi, l’écart auquel conduisent la technologie et les outils de communication tout en favorisant les échanges. Les personnages font la moue. L’esprit ailleurs, l’homme au pull rouge oublie son voisin de salon, la mère se trouve à la cuisine mais sur son téléphone, les proches à l’écran ne disent pas un mot. Les espaces se superposent en clair-obscur et sans se rencontrer, les générations, les différences de pratiques aussi. La lumière porte sur ce qui n’est pas là, l’échange virtuel, le rideau entrouvert du salon. Les regards vers le hors-champ, questionnent l’image et la représentation.

- Negâr Yaghmâiân, Appelle-moi
Nous trouvons-nous en compagnie des peintres de la vie moderne comme le revendiquait Jeff Wall ? Retournons sur la route avec Negâr Yaghmâiân pour un autre voyage vers l’Iran sacré, nous verrons bien. Suivons par l’haptique, les petites filles parties à la recherche du Ziâratgah. Au point d’effleurer les robes qui volent, les voiles légers des femmes, des mères, des grands-mères comme le faisait la photographe, enfant. Jusqu’à apercevoir le lieu sacré, plus qu’un sanctuaire, un point de rencontre, une « raison d’espérer », un endroit où « on aurait dit que l’univers pouvait nous entendre appeler plus fort ».
Un lien entre passé et présent qui fait voler la grenade de la fête de Yaldâ sous les yeux de Mehdi Mansouri, réinventée. Dans les ombres et la poussière magique de la plus longue nuit de l’hiver, on s’apprête à écouter l’histoire de l’invité mystère. Et on entend d’autres récits… Celui du bonhomme de neige de Majid Hojati sur la place de Naghsh-e Jahân, à Ispahan, ou le conte du pain qui reprend vie dans les mains de Marjân Khoram-Gholkârân. Chaque morceau de la tradition reconstitué l’un après l’autre avec une touche de glamour ludique.

- Mehdi Mansouri, Ma vie
Rouge des fruits, rouge des lèvres et des baisers, l’homme iranien moderne se fait prestidigitateur. Un peu cinématographique, toujours en mouvement, il nous entraine dans ses escapades et part quand il le peut, loin de sa ville, retrouver « ce qui nous reste ». Avec Poolâd Javâher-Haghighi, il nous égare dans un lieu inconnu, celui d’une cascade et ses fantômes. Capter l’insaisissable, sans doute les meilleurs moments d’une vie, loin de tout, avec les autres, sans les autres, profiter d’un paysage dans l’insouciance de l’amitié et rendre une impression d’un instant à travers l’œil du sténopé et jusqu’à soixante minutes d’exposition.
Le paysage repensé pour représenter l’Iran moderne, son lien à la nature. Téhéran, Ispahan, Shiraz et la campagne. Mohsen Shâhmardi nous invite à la recherche des parcelles de terrain vierge, en dehors des limites de la ville, et à regarder le pays à travers les négatifs anciens, expirés de son analogique. Avec la surprise de ne rien trouver au premier abord qu’une place aride. Puis, en s’attardant un peu, on admire les détritus abandonnés remontant un chaos subtil, cachant à demi entrepôts et résidences habitées, surmonté d’un fier drapeau, sur fond de monts enneigés.

- Majid Hojati, Ma Patrie
Le dépaysement vient dans la ville, où on ne l’attend pas. On s’y promène et on recherche « un endroit où rester », le temps de poser son regard au rythme des corps en promenade entremêlés aux lignes du pont Tabiat. La Téhéran moderne, esquissée par Marzieh Mohammadmiri, s’aménage au centre, dans la couleur, loin de la circulation. L’espace public se réinvente pour lutter contre l’expansion incoercible des frontières bétonnées, une préoccupation réelle qui pousse Hâmed Farhangi à nous abandonner hors de la cité, loin des forêts.
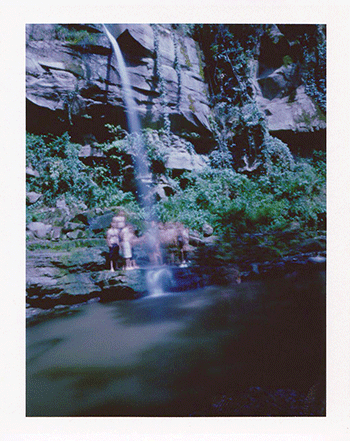
- Poolâd Javâher-Haghighi, Ce qui nous reste
Dans un mystérieux terrain vague, le Mamiya RB67 élargit notre point de vue à la taille du vingt-deuxième arrondissement, une extension du Nord-Ouest de la capitale qui a fait l’objet d’études sur les pollutions et l’impact négatif des nouvelles constructions. Téhéran menacée et menaçante nous guide aux racines tourmentées de la vie de ses habitants, une image réalisée sans effets, à la frontière du réel. La ville inspire. Omniprésente, elle s’insinue dans les rêves apocalyptiques de Farâz Habiballâhiân où elle attire la lune à elle et ses énigmes.

- Faraz Habiballâhiân, Apocalypse à Téhéran
L’Iran vaste et complexe, moderne et attaché à son histoire, ses traditions, se laisse parcourir entre ville et nature, réalité et illusions. Jusqu’à la frontière de la vie à la mort pour laquelle Aryâ Tâbandehpoor tisse un portrait singulier, photographie grandeur nature de l’être actuel à laquelle se mêle celle de ce qui advient de lui sous terre. Dans la série « L’Os », il décompose l’objet photographié qui devient matière et effritement, impossible à fixer et sans cesse altéré comme le regard. « Si la vie est une déformation, la mort est une trame, des entités inséparables qui créent l’existence. » Avec un sentiment de frustration dans la vision, d’insaisissable, la conscience de sa propre subjectivité.
Vingt-quatre œuvres qui nous entraînent à travers le pays et nous donnent la chance de nous rapprocher de ceux qui l’habitent, de voir à travers leurs yeux. Vingt-quatre impressions qui nous poussent à explorer les choses par nous-mêmes, à avoir un regard plus actif et à le porter si loin qu’il permette de mieux nous découvrir aussi. « Iran photo » et non Photos d’Iran pour percevoir la photographie comme le suggérait Suzanne Laffont, non pour « cataloguer le monde » mais pour « trouver une nouvelle relation entre le monde et [cet] instrument ».

- Mehdi Morâdpour, Abandonnés, perdus, néants
« Un jour où je n’avais rien à faire, je me suis acheté un appareil photo Yashika bon marché et j’ai pris le chemin de la nature. J’avais le désir de faire un avec elle. J’avais en même temps le désir de partager avec les autres ces moments agréables dont j’étais le témoin. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à prendre des photos. Éterniser en quelque sorte ces moments de passion et de douleur. »
Abbâs Kiârostami


