
|
A propos de la qualité iranienne au cinéma
De La nuit du Bossu à Tout à propos d’Elly
Le cinéma est une manière de rêver différent de ce que nous dictent les manières du temps et de l’époque.
Kiârostami
Rares sont les pays dotés d’un cinéma à caractère national, et possédant des particularités leur permettant de se mesurer au niveau mondial. La présence des films iraniens aux plus importants festivals internationaux, et cela depuis une vingtaine d’années, montre bien le caractère spécifique et en même temps universel du cinéma iranien. Par son dynamisme et sa diversité, tant pour la forme que pour le sujet, il figure aujourd’hui parmi les cinémas les plus prestigieux du monde. Cette force trouve évidemment son origine dans une riche culture millénaire et des réalités modernes qui donnent ensemble une spécificité à ses phénomènes sociaux, religieux, moraux, esthétiques et techniques.
Le cinéma iranien naît, comme dans la France des frères Lumières, son pays d’origine et avec un petit retard de cinq ans, dans la naïveté des « scènes de rue », des actualités et événements dont le seul enregistrement dans la durée, suffisait à séduire le public. Une reproduction brute du réel n’étant destinée qu’à divertir, et bien loin du cinéma d’art de nos jours. En effet, le septième art, l’art des temps modernes, trouvera assez lentement sa place dans la société iranienne, marquée profondément par la tradition. Cette société ne peut au départ mettre au monde qu’un cinéma populaire dont les films sont marqués par un moralisme oriental et religieux, et dont les scènes principales sont celles de danses, de chants et de bagarres ; des films qui finissent souvent, si ce n’est toujours, par une leçon de morale naïve et le mariage d’un louti avec la femme qu’il a sauvée de la chute dans la corruption ou la misère. La formule de film-e fârsi (le film persan) dominera à ce titre longtemps, jusqu’à la Révolution islamique, la scène cinématographique iranienne. Cependant, l’apparition, dans les années 1960-1970, d’un « cinéma différent » (cinemâ-ye motafâvet) marqua un tournant décisif dans l’histoire du cinéma iranien. Un cinéma plus sérieux, voire plus intellectuel promu par des cinéastes qui avaient fait, pour la plupart, leurs études à l’étranger et qui connaissaient bien la littérature.

- Photo extraite du film Shab-e Ghouzi (La nuit du Bossu) de Farrokh Ghaffâri
Le réalisateur Farrokh Ghaffâri, l’assistant d’Henri Langlois et fondateur de la cinémathèque iranienne, est l’une des figures principales de l’émergence de cette modernité cinématographique. Avec Shab-e Ghouzi (La nuit du Bossu) en 1964, une comédie inspirée des Mille et une nuits, Ghaffâri s’attaque aux mauvaises mœurs, en particulier l’hypocrisie marquante de la société de son époque. Hajir Dârioush, le célèbre critique et cinéaste contemporain du réalisateur salue en ce film la vraie naissance du cinéma iranien : « Nous pouvons maintenant annoncer avec certitude la naissance du cinéma iranien, et ce qui est remarquable et qui inspire la joie, c’est que le bébé montre les tous premiers signes d’une santé parfaite ». [1] L’écrivain Ebrâhim Golestân avec Khesht va aineh (La brique et le miroir), et le poète Fereydoun Râhnamâ avec Siâvosh dar takht-e Jamshid (Siâvosh à Persépolis) (1963) sont deux autres figures intellectuelles qui se trouvent à l’origine de ce mouvement novateur. Réalisé en 1965, Khesht va aineh démasque, dans un nouveau style, la misère des classes populaires et se présente comme le premier film qui dépasse le cliché au cinéma iranien de l’image de la femme, soit vertueuse et mère de famille, soit impudique, danseuse et chanteuse de cabaret, par l’analyse profonde et humaine qu’il en donne.
Autre événement marquant la période prérévolutionnaire est la création en 1965 de l’Institut pour le Développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes (Kânoun), un centre à vocation éducative et artistique dont l’un des fleurons est la section cinéma. Des réalisateurs de talent tels que Bahrâm Beyzâ’i et Abbâs Kiârostami ont commencé leur carrière cinématographique dans ce centre. Les premiers films de Kiârostami, ses court-métrages, Nân va koutcheh (Le pain et la rue) (1970) et Zang-e tafrih (La récréation) (1971) sont l’œuvre du Kânoun où leur réalisateur élabore sa conception exigeante et moderne du cinéma futur. Autre figure remarquable de cette époque est Amir Nâderi, qui avec son Harmonica marque les activités cinématographiques de ce centre.
L’année 1969 est très significative dans l’histoire du cinéma iranien. Elle marque, pour reprendre Hormoz Kéy, le début de la politisation du cinéma en Iran [2]. Sous l’appellation de « Nouvelle vague iranienne », prend forme, dans le cinéma, une tendance intellectuelle plus dynamique que celle de la période précédente, avec l’émergence d’un « nouveau langage aux allures humanistes, …avec des dialogues créatifs, et à l’influence mondiale ». [3] La vie ordinaire des gens ordinaires est ainsi écrite dans un langage poétique, qui brouille les frontières entre la fiction et la réalité. De facture à la fois poétique et philosophique, ces films cherchent en effet à transmettre un message politique. Dârioush Mehrju’i avec Gâv (La vache) et Massoud Kimiâi avec Gheysar sont les figures principales de ce mouvement. Par leur impact sur la société iranienne de l’époque, ces deux films ont une place privilégiée dans l’histoire de notre cinéma. Constamment admiré depuis son premier écran, Gâv, adapté d’une nouvelle éponyme du célèbre écrivain Gholâmhossein Sâ’edi, serait considéré à l’époque comme un appel à la révolte, une allégorie de la condition socio-politique de la fin de l’ancien régime, un film qui était censé, dans l’esprit de son réalisateur, préparer le public pour un transfert politique. Il offrit par ailleurs un prestige et un nouveau style à la profession d’acteur et présenta bon nombre d’acteurs éminents au cinéma à venir : Ezzatollâh Entezâmi, Ali Nasiriân et Jamshid Mashâyekhi marqueront désormais cette carrière par l’excellence de leurs jeux. Le film Gheysar a de son côté un impact important sur le cinéma de l’époque. Chargé d’un sens politique et de nature protestataire, ce second film de Kimiyâi sera compris, par bon nombre de critiques, comme un appel à la vengeance formulé par un auteur qui se trouve face à une société « déshonorée », à l’image de la sœur du héros du film, une société en ruine. Il provoque à ce même titre beaucoup de controverses. Car, malgré son importance et sa qualité, Gheysar est finalement un film classé genre commercial, mais il est « le premier film commercial iranien, écrivit alors Najaf Daryâbandari, qui était à la fois de divertissement et remarquable par l’habileté professionnelle de sa facture ».

- Photo extraite du film Gâv (La vache) de Dârioush Mehrju’i
Le début des années 1970 est prospère en matière de films sérieux et de qualité : Kimiyâi continue dans la veine de Gheysar et réalise deux autres films également considérables de notre cinéma : Rezâ motori (Rezâ le motard) et Dâsh Akol. Postchi (Le facteur) et Aghâ-ye hâlou (Monsieur naïf) de Mehrju’i, Khodâ Hâfez rafigh (Adieu camarade) de Nâderi, Ragbâr (L’averse) et Gharibeh va meh (L’inconnu et le brouillard) de Beyzâ’i (qui saura bien s’imposer à la scène par ses soucis esthétiques et son langage métaphorique), Moghol-hâ (Les Mongols) de Parviz Kimiâvi (grand admirateur de la Nouvelle vague française, son film fut en effet un hommage évident à Jean-Luc Godard) et Yek ettefâgh-e sâdeh (Un simple événement) de Sohrâb Shahid-Sâles sont, entre autres, des œuvres remarquables de cette période. Ce dernier cinéaste réalise son chef-d’œuvre Tabi’at-e bi jân (Nature morte) en 1975, une œuvre marquée par la poésie et la mélancolie, et qui recevra l’Ours d’argent du meilleur réalisateur au festival de Berlin. Sâles met en scène dans ce film la vie quotidienne d’un vieux couple, victime du caractère inhumain des relations administratives dans la société moderne. Le vieillard du film, chargé, dans un endroit isolé, du service et de l’entretien d’un poste d’aiguillage, apprend un jour qu’il doit se retirer et donner la place à un jeune couple. Il doit donc, avec sa femme, quitter son seul abri et partir. Et la condition tourne au tragique quand on apprend qu’ils n’ont nulle part où aller.

- Photo extraite du film Gheysar de Massoud Kimiâ’i

- Photo du film Dâsh Akol
Mais le film le plus marquant du cinéma de cette période prérévolutionnaire est Arâmesh dar hozour-e digarân (La tranquillité en présence des autres) de Nasser Taghvâ’i, réalisé en 1974 et interdit à l’écran durant quatre ans. De facture naturaliste, cette œuvre, adaptée d’une nouvelle du même Sâ’edi, raconte l’histoire d’une famille et de son entourage qui sombrent tous dans la perversité et la débauche, l’image de l’Iran de l’époque.

- Photo extraite du film Rezâ motori (Rezâ le motard)
Dans les années qui suivent, malgré le déclin important de la production cinématographique, quelques films de qualité voient encore le jour : Souteh delân (Les endoloris) d’Ali Hâtami en 1977 ou Dâyereh (Le cercle) de Mehrju’i, sorti en 1978, figurent parmi les meilleurs exemples. Le cinéma iranien vit cependant une situation critique dans ces dernières années du régime pahlavi. Il y a des journaux qui parlent même de « la mort du cinéma en Iran ». On assiste à vrai dire à la mort d’« un cinéma », tant le cinéma d’après la Révolution sera différent. Sujettes à la contestation révolutionnaire, la plupart des salles sont fermées ou même incendiées. Le cinéma était en effet considéré au regard des révolutionnaires comme véhicule des valeurs occidentales et donc condamné à mort. Mais l’Histoire décida autrement du sort de cette industrie culturelle.

- Photo extraite du film Zang-e tafrih (La récréation) de Abbâs Kiârostami
La Révolution de 1979 marque la renaissance du cinéma à l’iranienne. Elle attache en effet une grande importance au secteur culturel, donc au cinéma, lequel se doit de se mettre au service des valeurs révolutionnaires et refléter le dévouement et le courage de ses acteurs qui, à peine sortis du mouvement révolutionnaire, sont mobilisés sur le champ d’une guerre imposée.
Le cinéma postrévolutionnaire met un certain temps pour se retrouver et prendre la mesure des bouleversements vécus et en cours. La scène n’est évidemment pas encore propice à la production de chefs-d’œuvre. Le modèle du cinéma de l’ancien régime, ses images et thématiques courantes sont rejetés et la recherche d’un modèle du « cinéma islamique » est l’ordre du jour. Ce qui ne mène pas à grande chose vu le manque de cadres intellectuels précis et de ressources en matière du cinéma, qui est un art récent. La mise en place du Festival international du film de Fajr en 1982 ainsi que la création de la Fondation cinématographique Fârâbi sont en ce sens considérées comme des tentatives pour donner une structure à la production et au développement du cinéma iranien d’après la Révolution. La première de ces structures est créée avec pour objectif la commémoration de la Révolution par le cinéma qu’on cherche à promouvoir dans le monde entier, et la seconde est censée fournir le matériel technique et les financements nécessaires aux producteurs privés. De grands metteurs en scène de la génération prérévolutionnaire comme Beyzâ’i, Mehrju’i, Taghvâ’i, Hâtami, Kiârostami, Khosro Sinâ’i ou encore Nâderi, dont Davandeh (Le coureur) en 1985 est à l’origine de la connaissance hors des frontières du cinéma iranien, se mettent plus sérieusement et avec plus de liberté au travail. A côté de ces chantres du cinéma, de plus jeunes réalisateurs (dont certains appartiennent à la génération postrévolutionnaire) comme, entre autres, Kâmbuziâ Partovi, Majid Majidi, Alirezâ Dâvoudnejâd, Rasoul Mollâgholipour, Kiânoush Ayyâri, Ebrâhim Hâtamikia, Siâmak Shâyeghi et Rakhshân Bani-E’temâd contribuent également à la prospérité et la richesse des productions cinématographiques de leur pays en traitant, chacun dans son propre style, les enjeux majeurs de la société iranienne.
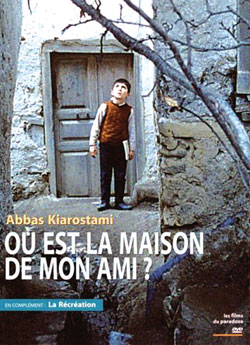
- Affiche du film Khâneh-ye doust kojâst ? (Où est la maison de mon ami ?) de Abbâs Kiârostami
Mais la caractéristique marquante de la première décennie d’après la Révolution est l’émergence d’un nouveau genre : le cinéma de la « Défense sacrée » (Defâ’-e moghadas). La guerre imposée à l’Iran par son voisin irakien est, et cela dès le début, abondamment mise en scène ; le dévouement et l’héroïsme des Iraniens sur les champs de bataille constituent la thématique essentielle des films tournés à l’époque. Des œuvres qui s’efforcent de célébrer la force des soldats iraniens dont la mort est sacralisée, traduite en martyre et donc montrée solennellement à l’écran. Entre autres, Mortezâ Avini, Mollâgholipour, Ahmadrezâ Darvish et Hâtamikiyâ sont les figures les plus remarquables de ce genre.

- Photo extraite du film Rang-e Khodâ (La couleur du Paradis) de Majid Majidi
Avini, membre du « Jihad de construction » - organisation mise en place au début de la Révolution islamique pour surtout s’occuper de l’amélioration de l’état des villages, ignorés totalement à l’époque du Shâh -, avait déjà commencé sa carrière de cinéaste en réalisant quelques documentaires. Avec le commencement de la guerre, il se rend aussitôt sur le front et se fait cinéaste de guerre. Il y réalise l’un de ses premiers films, Fath-e khoun (La conquête du sang), un documentaire sur l’occupation de la ville de Khorramshahr par l’armée irakienne. Mais son travail le plus considérable est la réalisation d’une série documentaire, Ravâyat-e fath (L’histoire de la conquête), racontant l’épopée des soldats iraniens durant les huit années de guerre. Mais les œuvres les plus considérables tournées dans ce genre sont celles de Hâtamikiyâ. Ce dernier, qui deviendra peu à peu un cinéaste critique envers la guerre, dont il montrera les atrocités et l’aspect tragique, réalisa durant cette période deux films importants : Dideh bân (Le veilleur) (1989) et Mohâjer (L’immigré) (1990). Ce dernier film est prometteur d’un bel avenir pour son réalisateur, lequel donnera par la suite les œuvres les plus remarquables du cinéma de guerre : Az Karkheh ta Râin (De Karkheh au Rhin), Agens-e shisheh’i (L’agence de Verre) et Be nâm-e pedar (Au nom du père) dont les deux dernières portent un regard critique sur la guerre. Ils s’interrogent, comme nous venons de l’évoquer, sur les conséquences désastreuses de la guerre, dont le souvenir et les effets maléfiques persistent, bien après la guerre, dans la conscience humaine. Ces films cherchent en effet à mettre en scène des invalides qui ne sont plus à même de mener une vie active et dont les sacrifices risquent de s’effacer de la mémoire de la société. Ils évoquent pour ainsi dire les mutations d’une société qui ne reconnaît plus, au moins comme ils le méritent, ses soldats du passé et les considère parfois même comme inutiles, voire embarrassants. Par son caractère intelligent mais aussi par sa qualité technique, l’œuvre de Hâtamikiyâ réussit à récolter bon nombre de prix dans le festival de Fajr.
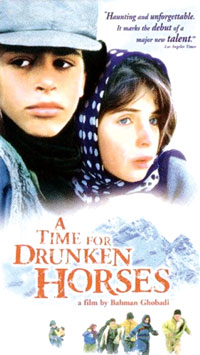
- Affiche du film Zamâni barâye masti-e âsp-hâ (Un temps pour l’ivresse de chevaux) de Bahman Ghobâdi
La guerre finie, le réalisateur qui attire l’attention internationale sur le cinéma iranien et qui en dévoile les secrets et l’originalité est Abbâs Kiârostami. L’œuvre de ce dernier est en plein épanouissement dans les années 1990. Elle exploite « avec une surprenante liberté » toutes les hypothèses et toutes les combinaisons possibles pour le cinéma. Kurosawa, le grand maître du cinéma japonais et mondial parle de lui en ces termes : « Je pense que les films de Kiârostami sont extraordinaires. Les mots ne peuvent traduire mes émotions et je vous conseille simplement de voir ses films. » [4]. Kiârostami est découvert en 1989 par la critique internationale grâce à son chef-d’œuvre, Khâneh-ye doust kojâst ? (Où est la maison de mon ami ?). A la sortie de ce film, les journaux iraniens parlent d’emblée d’un « événement heureux » dans l’histoire du cinéma iranien. Close up réalisé en 1990 suivi par Zendegui va digar hitch (Et la vie continue) en 1992 confirment son œuvre et l’originalité de son cinéma. Avec Zir-e derakhtân-e zeytoun (Au travers des oliviers), réalisé en 1994, cette œuvre est enfin consacrée et fait asseoir son auteur côte à côte avec les plus grands réalisateurs du monde tels qu’Hitchcock ou Rossellini. Ce dernier film dévoile, dit Serge Bouquet, ce qu’on pressentait depuis longtemps : « Il y a moins chez Kiârostami un goût pour l’enregistrement innocent du réel qu’une pulsion démiurgique, une volonté farouche de se faire le créateur du monde en creusant le monde d’un double ou triple fond… » [5]. La palme d’Or attribuée à Ta’m-e guilâs (Le goût de la cerise) en 1997 consacre enfin le cinéma kiârostamien auprès du grand public et confirme le statut mondial du cinéma iranien qui s’imposera désormais dans tous les festivals internationaux importants. Les films iraniens ne cesseront plus d’enthousiasmer le public étranger qui trouve dans ce cinéma des codes esthétiques et éthiques différents de ceux des autres cinémas, qu’ils soient américains, français, allemands ou indiens. Certains critiques ont en effet voulu voir dans cette réussite internationale la preuve d’un cinéma fait pour les festivals, qui aurait recouru aux éléments et atmosphères culturels spécifiques pour s’attirer l’attention des étrangers. Ce qui paraît complètement faux vu la qualité technique et thématique de ces œuvres admirées par les plus exigeants des critiques et réalisateurs du monde, tels que Werner Herzog ou Jean-Claude Carrière, qui le qualifie de « cinéma véridique, et par là-même indispensable ». Car, c’est un cinéma qui donne plus de temps et de possibilité à son spectateur, et qui se laisse compléter avec l’esprit créatif de son spectateur. Cette leçon est bien apprise par les élèves et contemporains de Kiârostami. L’admirable Bâdkonak-e sefid (Ballon blanc), caméra d’Or de Cannes de 1995, raconte dans une fluidité et simplicité surprenantes l’histoire d’une petite fille qui désire s’acheter, quelques instants avant le Nouvel An, un poisson rouge « en forme de mariée ». Elle arrive à obtenir l’argent nécessaire de sa mère, qui doit gérer les dépenses de sa pauvre famille, mais perd son billet en chemin. Le monde innocent des enfants, ces principaux acteurs non-professionnels du cinéma de l’époque, constituent une autre caractéristique de ce film simple qui, selon Vincent Rémy, critique à Télérama, sait entraîner son spectateur étranger dans un monde « pluriel, ouvert et généreux ». Yek dâstân vâghe’i (Une histoire vraie) d’Abolfazl Jalili est un autre film remarquable de ces années-là ; son caractère expérimental et son audace qui oblige le documentaire à devenir fictionnel nous fait encore songer au cinéma de Kiârostami. Ce long-métrage sera couronné, en 1996, par le grand prix du meilleur film du festival des Trois Continents de Nantes.

- Photo extraite du film Batcheh-hâye talâgh (Enfants du divorce) de Tahmineh Milâni
La fusion de la fiction et de la réalité, cette vie de tous les jours, a pour maître un autre réalisateur dont l’œuvre doit également être évoquée. Le cinéma de Majid Majidi présente de façon magnifique le fusionnement de la beauté naturelle, de la poésie et du chagrin, ainsique l’histoire simple et bouleversante des gens ordinaires filmée dans la splendeur des paysages campagnards. La matière principale en est encore l’innocence du monde des enfants, marquée par la douceur et le goût de la vie, manifestes dans la pureté des couleurs. Le visuel joue à ce titre un grand rôle dans les films de Majidi qui ne manquent pas de nous communiquer par toutes les nuances des sentiments humains. En est ainsi des Bacheh-hâye âsemân (Les enfants du ciel), réalisés en 1997 et nominés à l’Oscar du meilleur film étranger en 1998, et de Rang-e Khodâ (La couleur du Paradis), réalisé en 1999. Le sujet de ce dernier, filmé dans un village au nord de l’Iran, porte sur un enfant aveugle qui n’est pas aimé de son père solitaire. Il fait ses études à Téhéran dans une école pour aveugles ; pour les vacances, Mohammad doit retourner dans son village natal accompagné de son père. Sur le chemin du retour, qui se fait à cheval, nous assistons avec cet enfant à la redécouverte de la nature, pleine de chants d’oiseaux, d’arbres et de fleurs, du murmure des rivières, bref, pleine d’une vie cachée aux yeux, mais visible par les sens et le cœur.

- Photo extraite du film Be hamin sâdegui (Aussi simplement que voilà) de Mir Karimi
Parallèlement à l’épanouissement, dans les années 1990, de ce cinéma d’auteurs et la professionnalisation en général du monde cinématographique iranien, nous assistons à l’émergence de trois phénomènes importants qui seront à l’origine de la vitalité et de la diversité du cinéma de ces dernières années. Primo le développement d’un cinéma de vedettes dont Fariborz Arabniâ, Mohammad Rezâ Foroutan, Niki Karimi, Hediyeh Tehrâni sont les acteurs les plus célèbres ; de nouvelles stars qui vont grandement contribuer à une nouvelle commercialisation du cinéma iranien, qui a su quand même se tenir à l’écart de la banalité du cinéma commercial d’avant la Révolution. Sont ainsi portés à l’écran des films qui font largement appel à l’émotion des spectateurs mais qui sont en même temps ancrés dans la réalité sociale. Les évènements sociopolitiques des années 1990 ne restent évidemment pas sans écho dans le cinéma. Qermez (Le rouge) de Fereydoun Jeyrâni et Do zan (Deux femmes) de Tahmineh Milâni, tous les deux réalisés en 2000, sont de bons exemples pour ce genre de films. En 2001, Behrouz Afkhami, porte à l’écran Showkarân (La ciguë), un mélodrame qui battit le record du Box office iranien et put même gagner les écrans américains. Afkahmi, il est utile de le rappeler, avait déjà réalisé, une dizaine d’années auparavant, un autre film important, Arous (La mariée), qui laissait montrer des scènes jusque-là considérées comme tabous : celles de l’histoire d’amour parfaitement terrestre d’un couple jeune et beau.
Le second phénomène est l’ouverture d’un espace, bien sûr pas très large, pour les femmes cinéastes. Le cinéma iranien n’avait présenté jusque là qu’une seule réalisatrice, la poétesse Forough Farokhzâd, auteur de Khâneh siyâh ast (La maison est noire) tourné en 1962. La consécration de cette présence féminine derrière la caméra se réalise en effet à partir de l’année 1987 où Parandeh-ye koutchik-e khoshbakhti (Le petit oiseau du bonheur) est porté à l’écran par Pourân Derakhshandeh. Rakhshân Bani-E’temâd, autre figure féminine des années 90, s’interroge sur l’origine des inégalités existant entre les femmes et les hommes dans sa société. Son admirable Rousari-e âbi (Foulard bleu) (1993) met en scène l’histoire d’une jeune femme (Nobar) qui travaille dans la ferme d’un homme âgé (Rasoul) afin de gagner la vie de sa pauvre famille constituée d’une mère toxicomane, d’un frère clochard et d’une petite sœur. L’amour qu’éprouve le patron pour son ouvrière aurait provoqué un scandale, estiment les filles de Rasoul. Celles-ci décident donc d’empêcher cette union… Une autre figure marquante du cinéma féminin de l’époque est Tahmineh Milâni, qui, avec ses Batcheh-hâye talâgh (Enfants du divorce) (1989), se penche sur l’étude des effets du divorce sur les enfants.
Le troisième événement remarquable qui se produit vers la fin des années 1990 et qui mérite l’attention, est l’avènement du cinéma comique avec d’illustres réalisateurs comme Mohammad Hossein Latifi et Iraj Tahmâseb. Le premier se trouve avec ses Eynak-e doudi (Lunettes de soleil) (2001) à l’origine de ce mouvement qui saura désormais se faire une place privilégiée chez les spectateurs iraniens.
Le cinéma du début du XXIe siècle se montre aussi actif et productif. Il est même marqué par une plus grande variété de voix et de choix esthétiques que la décennie précédente. De nouvelles signatures émergent comme celle de Bahman Ghobâdi, dont l’œuvre, récompensée dans de nombreux festivals, a pour cadre principal la région du Kurdistân à l’ouest de l’Iran, très riche de par sa nature, ses sujets intacts et son peuple possédant des traditions millénaires. Zamâni barâye masti-e âsp-hâ (Un temps pour l’ivresse de chevaux), Caméra d’or du festival de Cannes en 2000, est pour ce jeune cinéaste un commencement formidable. Ce film, outre la puissance des images et du scénario et l’attraction de sa musique (composée par le maître Alizâdeh) profère des sentiments humanitaires, et cela par des enfants dont la vie est pourtant marquée par la pauvreté.
Mais si les principaux films de Ghobâdi portent toujours l’empreinte du cinéma de Kiârostami, ceux de Rezâ Mir Karimi et Asghar Farhâdi présentent des caractères originaux de par la thématique et les sujets qu’ils traitent. Nous pouvons en effet qualifier ces deux jeunes auteurs de phénomènes du cinéma actuel. Des cinéastes qui ont fait preuve d’un progrès sensible durant leur carrière, de manière à donner naissance par leurs derniers films à deux chefs-d’œuvre du cinéma, sans exagération aucune, mondial. Mir Karimi avait déjà attiré l’attention du public et de la critique, dans Zir-e nour-e mâh (Sous le clair de lune) (2001), par son choix d’une thématique sacrée, celle de la vie d’un jeune rohâni (homme qui fait ses études dans une école religieuse et en sort pour aller répandre les décrets de l’islam et veiller à leur bonne pratique). Par son réalisme et l’effort qu’il déploie à rendre la vie humble et ordinaire de ce jeune religieux, à qui il fait découvrir « sous le clair de lune », la ville, sa grandeur et ses misères, le film peut être en effet considéré comme un rappel des dirigeants spirituels du pays à la responsabilité et au lourd devoir qu’ils ont envers le peuple et auprès de Dieu. Cette œuvre est également à même de dévoiler les préoccupations essentielles de son auteur, profondément religieux mais conscient de la condition socio-historique de son pays vivant des moments difficiles de transition : de la tradition à la modernité. Cette préoccupation, celle d’ailleurs de la plupart des artistes de nos jours, traverse toute l’œuvre de Mir Karimi. Ce dernier sait cependant en faire une belle matière en mesurant sa distance avec le sujet qu’il aborde : ni très loin ni très proche. Il arrive à ce titre à bien maîtriser et le cadre, et le temps et le sujet pour mettre au monde un chef-d’œuvre qu’est Be hamin sâdegui (Aussi simplement que voilà). Réalisé en 2007, ce film fusionne l’évidence et le mystère, le banal et le curieux, le clair et l’obscur pour laisser finalement un spectateur indécis ! La banalité de la vie d’une femme ordinaire est tournée dans un modeste appartement, l’unique espace du film, où rien ne se passe à vrai dire. Ou bien tout se passe au fond du personnage et reste obscur au spectateur, lequel a vu en sortant de la salle la naissance de l’exceptionnel de l’habituel. Mir Karimi s’offre, nous le pensons, avec ce film une place à côté des maîtres du cinéma iranien : Kiârostami, Mehrju’i et autres. Mais il n’est pas le seul à réclamer cet honneur ; Asghar Farhâdi, autre jeune réalisateur de ces dernières années, mérite également cet honneur. Farhâdi porte son regard particulièrement sur la mutation des relations humaines, qui perdent peu à peu leur sens traditionnel dans une métropole comme Téhéran. Sont ainsi abordés la vie de couple de la classe moyenne marquée par la complexité des rapports entre l’homme et la femme. La trahison, le mensonge et le souci de la vérité constituent les principaux thèmes de son œuvre. Il s’efforce en effet de dévoiler le monstre qui peut se cacher en nous, travesti en vérité, et qui ne révèlera pas son vrai visage, et cela malgré l’attente du spectateur traditionnel, même au terme du film. Dar bâreye Elly (A propos d’Elly), réalisé en 2009, Prix de la meilleure direction au festival de Fajr et primé à Berlin, est un vrai coup de maître, un événement dans le cinéma iranien. A partir d’une simple histoire, celle du départ en vacances d’amis qui sont censés préparer le terrain pour la rencontre et le mariage d’Amir, un divorcé rentré récemment d’Allemagne et Elly, une jeune femme dont on ne sait rien (et dont on ne saura rien) sauf qu’elle travaille dans une crèche, le film, en créant le nœud par la disparition d’Elly, nous entraîne dans l’angoisse des moments de tensions extrêmes, lesquels touchent et les personnages et le spectateur et la caméra et les images. Nous vivons ainsi des sentiments apocalyptiques provenant plus du maniement de la forme que de l’accident produit. Aussi Farhâdi montre qu’il est un réalisateur qui maîtrise bien la technique pour mettre en valeur son sujet et ses acteurs.

- Affiche du film Dar bâreye Elly (A propos d’Elly) de Asghar Farhâdi
La scène actuelle du cinéma iranien ne manque pas de tels jeunes cinéastes prometteurs qui sont à même de contribuer à l’enrichissement de leur cinéma national mais également du monde. Riche en thématiques, l’Iran présente en effet un vaste terrain de recherche aux cinéastes qui n’ont qu’à se perfectionner en technique afin de rendre leurs sujets sous une forme plus travaillée, disons plus moderne.
Bibliographie :
![]() Abbas Kiârostami, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma, Ed. De l’étoile, 1997.
Abbas Kiârostami, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma, Ed. De l’étoile, 1997.
![]() Kéy, Hormuz, dans Le cinéma iranien, l’image d’une société en bouillonnement, Ed. Karthala, 1999
Kéy, Hormuz, dans Le cinéma iranien, l’image d’une société en bouillonnement, Ed. Karthala, 1999
![]() Mehrâbi, Massoud, Târikh-e cinemâ-ye Irân, az âghâz tâ sâl-e 1357 (L’histoire du cinéma iranien, dès le début jusqu’à la Révolution), Ed. Peykân, Téhéran, 2004.
Mehrâbi, Massoud, Târikh-e cinemâ-ye Irân, az âghâz tâ sâl-e 1357 (L’histoire du cinéma iranien, dès le début jusqu’à la Révolution), Ed. Peykân, Téhéran, 2004.
![]() Mihandoust Esmâil, Jahân-e no, sinamâ-ye no (Un monde nouveau, un cinéma nouveau), Entretiens avec les réalisateurs iraniens, Ed. Cheshmeh, Téhéran, 2008.
Mihandoust Esmâil, Jahân-e no, sinamâ-ye no (Un monde nouveau, un cinéma nouveau), Entretiens avec les réalisateurs iraniens, Ed. Cheshmeh, Téhéran, 2008.
Notes
[1] Mehrâbi, Massoud, Târikh-e cinemâ-ye Irân, az âghâz tâ sâl-e 1357 (L’histoire du cinéma iranien, dès le début jusqu’à la Révolution), Ed. Peykân, Téhéran, 2004.
[2] Voir Hormuz Kéy dans Le cinéma iranien, l’image d’une société en bouillonnement, Ed. Karthala, 1999.
[3] Rose Issa, « Real Fictions », The House of World Cultures, 2007.
[4] Abbas Kiarostami, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma, Ed. de L’étoile, 1997, P. 55.
[5] Ibid. P. 133.

