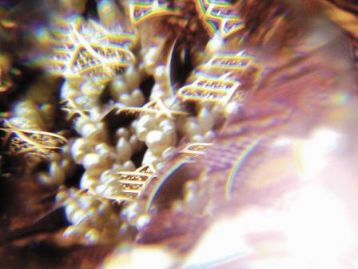|
Deux jours de repos intégral ont finalement raison du choc ressenti. Le sourire de la vieille Zahra, le goût de l’eau si douce, la visite régulière du chat roux ayant ses habitudes dans la maison, les variations de la lumière du jour se projetant sur le mur, les ondoiements de la portière de la chambre légèrement soulevée par l’air chaud de la cour, un bol fumant de pois chiches cuisinés aux oignons et à la graisse de mouton, un excellent pain, deux visites du vieux mollah qui se montra bienveillant et peu curieux… Sur ces petites choses, un présent tangible se construit, une nouvelle base s’établit. C’est comme une nouvelle naissance. C’est étrange de naître lorsque l’on est déjà adulte, lorsque l’on a déjà une vie ailleurs. Mais là, pour le moment, cet ailleurs est hors de portée. Il faut recommencer, ne pas trop y penser, s’ancrer dans ce qui est, là, ici, maintenant. Ici et maintenant, la vieille Zahra et le vieux mollah sont les seuls êtres à connaître Lalla Gaïa. Après tout, c’est comme cela à chaque fois que l’on arrive dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville. Quelle différence y-t-il entre un déplacement dans l’espace et une chute dans le temps ? Il y a tout d’abord cette constante, ce fil ténu, ce « soi » bien connu qui nous accompagne toujours, qui nous colle à l’âme, ayant presque l’air de nous narguer, tant on ne peut s’en défaire. Ensuite, ce n’est qu’une série de nouveautés, auxquelles on s’adapte au fur et à mesure. Pouvoir rentrer chez soi ? On ne peut jamais en être sûr. Et ce n’est pas une raison pour éviter de se mettre en route… Et puis, « chez soi », est-ce la maison d’où l’on est parti ou bien un lieu auquel on parvient ? A moins que ce ne soit lui qui nous trouve… A moins que cela ne soit partout, ou encore nulle part… En somme, Lalla Gaïa peut une nouvelle fois goûter à cette liberté grisante qu’offre habituellement le voyage : un nouveau départ, des perspectives inconnues, un espoir contenu, une saine résignation face à ce qui arrive, avec comme véhicule la confiance accordée au présent, perpétuellement illuminé de l’intérieur par la lumière de l’être, le flambeau de l’existence.
La première sortie est pour retourner au sanctuaire, tout proche. Les abords en sont très animés. On y vend toutes sortes de menus articles religieux, on peut y boire et manger. Des écrivains publics officient à demeure sous les porches. Beaucoup de mendiants passent là le plus clair de leur temps. La grande cour est parsemée de tombes : des religieux importants, ou des gens ayant les moyens de s’offrir une sépulture à quelques mètres de l’enceinte sacrée, la croyance disant que ceux qui reposent auprès d’un Imâm iront au Paradis avec lui… On arrive là selon la taille de son mérite, ou selon celle de sa bourse… Cette cour est traversée dans les deux sens par une multitude de gens entrant et sortant du mausolée. Face à l’entrée principale menant au cœur même du sanctuaire où se trouvent les sépultures des deux Imâms, on sollicite des maîtres du lieu l’autorisation d’entrer en récitant une invocation. C’est le cœur du pèlerin qui doit lui dire si la permission est obtenue. Lalla Gaïa suit le mouvement collectif, il est parfois bon de s’en remettre à une foule ordonnée et de se sentir telle une simple particule... Aussi, elle a besoin de revenir à l’endroit de sa « chute », et elle veut se confier à ceux qui entendent toutes les requêtes. Parvenue à la clôture des tombes, magnifiquement ouvragée, elle s’adresse directement à l’Imâm Moussa al-Kâdhim et à son petit-fils, l’Imâm Jawâd. Émue, elle les remercie pour l’avoir invitée à se rendre auprès de leur seuil, elle leur renouvelle sa confiance en ce qui est, ne leur parle pas du choc qu’elle a affronté, ne se plaint pas, se contentant de solliciter leur assistance dans le bien, pour le bien, vers le bien.
Son entretien terminé, elle retourne au dehors, enfin légère, avec l’intention cette fois d’entrer franchement et sereinement dans ce « nouveau présent », sans arrières pensées. A toute époque, manger, avoir un toit, se déplacer nécessite quelque argent… Lalla Gaïa se rend au grand souk de la ville et se met en quête du quartier des orfèvres, ayant l’intention de vendre le joli bracelet qui orne son poignet. Si elle avait su qu’elle lui devrait un jour sa survie ! Elle s’enfonce dans les venelles, se mêle à la foule. Si ce n’est l’habit, les gens ne sont pas vraiment différents, pas plus qu’il ne lui semble qu’elle fasse l’objet d’une quelconque attention. Elle se surprend à se sentir de mieux en mieux au fur et à mesure qu’elle enfile les ruelles, les allées. On lui indique un quartier précis du souk, cerné par un mur et muni d’une unique porte, bien gardée. C’est là que se vend et s’achète une grande partie de l’or circulant dans la ville. Il faut trouver un négociant ayant l’air honnête, qui ne soit ni trop riche - car l’on ne devient pas riche sans tirer sur le profit -, ni trop pauvre - car il ne faut pas le ruiner davantage - ! Lalla Gaïa prend son temps. Elle attend une indication, un signe, n’étant pas experte en la matière… Elle sait qu’il ne faut pas non plus se fier aux apparences. La voyant passer et repasser, un homme entre deux âges l’interpelle :
« Que cherches-tu ? Tu n’es pas d’ici ? »
« Je viens de Misr [1], j’aimerais vendre un bijou. »
« Fais-voir. »
« Le voici. »
Elle tend le fin bracelet, façonné quelque part dans l’Italie du XXe siècle, à cet orfèvre du Baghdâd du XVIe siècle ! Il le tourne de tous côtés, semblant apprécier l’extrême régularité des chaînons, la pureté de l’or, la qualité du polissage. Il finit par dire :
« Il est très beau. Je n’en ai jamais vu de pareil. Mais si tu le vends ici, on ne t’en donnera que la valeur de son poids. Il te faudrait trouver quelqu’un à même d’apprécier sa qualité et prêt à le payer plus cher. »
« Je ne connais personne dans cette ville. Où me conseilles-tu d’aller ? A qui pourrais-je m’adresser ? »
« Laisse-moi te servir un café. Je vais aller me renseigner. »
Il lui présente une sorte de pouf, apporte une petite tasse de céladon ronde, sans anse, y fait couler un peu d’un café très fort, lui rend son bijou et sort de son échoppe.
Lalla Gaïa déguste le breuvage puissant. Il lui semble que l’amertume du café la saisissant, cela l’ancre plus encore dans cette réalité neuve qui se fait sienne peu à peu. L’homme lui semble absolument correct et lui inspire confiance. Elle respire les effluves en même temps qu’elle laisse couler le nectar noir dans sa bouche. La boisson lui apporte un réconfort immense. Pour Lalla Gaïa, un café, un thé, c’est déjà le sentiment d’être chez soi là où on le boit…
Beaucoup de femmes peuplent ce souk de l’or. Certaines ont le visage dissimulé sous une fine mousseline blanche. Dans leurs yeux ornés de khôl se reflète l’éclat des parures. Leurs mains avides saisissent les bracelets, les colliers, les boucles d’oreille, les soupèsent, leurs pupilles semblent boire le ruissellement de lumière, et c’est toujours à regret qu’elles reposent ces trésors. Ayant ainsi le loisir de les observer tranquillement, Lalla Gaïa note les diverses façons dont elles se couvrent et ajuste son voile en fonction, de sorte à entrer dans les canons du moment. Il faudra qu’elle se procure du tissu et se fasse couper un vêtement à l’aspect local, bien qu’une très grande diversité de coupes et de matières puisse être observée dans le souk de cette grande ville d’Irak. Son tchador de style libanais, acheté dans l’Iran du XXe siècle et taillé dans un coupon de crêpe coréen semble toutefois singulier, surtout avec ses tampons dorés signifiant la provenance, la qualité, les prix obtenus par le fabricant. De plus, rien ne l’oblige à continuer de porter du noir… Sous les longues tuniques, on aperçoit les bas de longs pantalons bouffants dont les broderies répondent au décor des chaussures brodées. Les foulards sont amples, légers, le choix des couleurs est très large. Lalla Gaïa sait très vite à quoi elle va dépenser ses premières pièces…
L’homme revient.
« On me dit qu’une femme très riche, propriétaire de caravanes, aime beaucoup les bijoux et apprécie la nouveauté. Tu pourrais peut-être tenter ta chance et aller lui montrer ce bracelet… »
« Merci. C’est une bonne idée. Où puis-je la trouver ? »
« Elle habite dans une grande demeure située au bord du fleuve, au sud du pont, côté Kâdhimayn. On la nomme Sayyida Roqayya. C’est une femme pieuse qui aime faire le bien. Va la voir le matin, avant que le soleil ne se lève, soit avant qu’elle ne commence à régler ses affaires. Dis-lui que tu lui apportes quelque chose qu’elle n’a encore jamais vu. Insha’Allâh, ton bijou lui plaira… »
Notes
[1] Egypte.