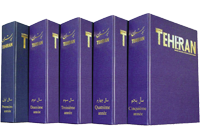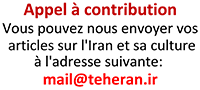
|
…Si seulement j’avais un coffre magique,
J’aurais emprisonné le temps
Si seulement j’avais assez de cris
J’aurais condamné les minutes pour leurs crimes
Car tout ce que je désire est d’être répété
Et n’est qu’un souhait tombé dans l’abîme
Oh, l’immense Balancier s’en va
Saisissant nos moments dorés sur son chemin…

- L’exterieur du Musée du Temps de l’Iran
Pour nous, êtres humains, le temps veut dire compter des secondes, des minutes, des heures, puis des jours, des semaines, des mois pour ensuite dire qu’un an de plus est passé et que voilà l’autre. Parfois on s’étonne : "Comme j’ai grandi… que le passage du temps est donc rapide !". Mais pourquoi un fait si clair, si évident, nous plonge-t-il dans une vague réflexion, parfois effrayante ? Il est vrai que la fuite du temps nous rapproche de jour en jour de la mort, et qu’elle vole la jeunesse et la beauté. Pourtant, cette vérité inévitable est-elle jamais si attristante ? On dit que "le temps est un voleur et qu’il vole notre bonheur", mais aussi notre malheur, non ? D’une part, il emporte avec soi la gaieté des jours éclatants et les doux sourires de l’intimité et de l’amour, d’autre part il nous éloigne des événements amers qui, parfois, nous pèsent ou remplissent notre cœur de désespoir et de tristesse. Le temps fait ce qu’il faut équilibrant l’ensemble des faits de la vie. Ainsi, il nous aide établir une sorte de parallèle entre tous les événements de notre propre vie, et même ceux des autres. Imaginer un monde sans temps, cet élément fugitif mais renaissant, n’est guère supportable ; une sphère dans laquelle nous aurions flotté dans l’intemporalité du vide, de l’insensible. C’est pourquoi, au cours des siècles, l’homme s’est attaché de plus en plus aux heures, aux minutes et même aux secondes dont il avait tant besoin.

- Premier étage du Musée, section des horloges
Il s’est donc mis à inventer des objets grâce auxquels il put diviser une année entière en mois, et par la suite, de mois en semaines et de semaines en jours. De cette façon, une grande variété de calendriers apparut. Tic-tac… tic-tac… tic-tac, c’est le son des horloges faisant le tour de chaque 24 heures claires et obscures qui débutent et se suivent les unes après les autres. L’horlogerie est depuis des siècles une grande industrie, et les compagnies renommées rivalisant dans ce domaine sont maintenant nombreuses. A côté de leur fonction principale qui est de montrer le temps, les horloges et même les montres ont bien réussi à inspirer le goût artistique de leurs fabricants. C’est pourquoi elles sont parfois considérées comme de précieux objets d’ornement. L’exhibition de l’ensemble de ces horloges rassemblées au même endroit, chacune appartenant à une période distincte, peut ainsi donner lieu à une magnifique représentation. En Iran, l’idée a été bien réalisée, grâce au Musée du Temps.
Le Musée du Temps est le premier musée d’horloges en Iran. Dès l’entrée, le temps semble s’arrêter. Rien ne bouge, ni une minute, ni une heure. Sur la face de ces grandes horloges, le temps a gelé. Les aiguilles se sont figées, l’une sur 5, l’autre sur 8 heures et demi, depuis les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

- Montre à gousset fabriquée en Suisse, mécanisme à ressort, XIXème siècle.
La création de la première horloge, dans l’Egypte antique, ayant un mécanisme très simple (horloge solaire) date d’environ 3500 ans. L’histoire nous dit que les Egyptiens et les Babyloniens furent les peuples les plus avancés dans le domaine de l’horlogerie. Ils s’intéressaient à la notion du temps et cherchaient un moyen pour définir la durée du jour et de la nuit. Presque mille ans après une première tentative, c’est-à-dire celle qui conduisit à la fabrication de la première horloge solaire, ces mêmes peuples construisirent l’horloge hydraulique. Puis, lentement, à partir du IIIe siècle, les sabliers envahirent les marchés. Quant à l’horloge-bougie, son invention date du Xe siècle, dans l’Angleterre du roi Alfred le Grand. Révoqué à la suite d’un complot, le roi anglais se promit de consacrer les deux tiers de sa vie à son peuple au cas où il regagnerait le pouvoir. Son vœu fut exaucé et pour tenir sa promesse, le roi se mit à graduer les bougies pour pouvoir mesurer deux tiers de sa vie. Ainsi, quatre bougies représentaient 24 heures. Cet événement fut le point de départ de l’apparition des horloges ardentes dont l’horloge à huile. Postérieurement, à la fin de XIe siècle, les horloges mécaniques virent le jour. Puis deux siècles plus tard, des horloges à poids les remplacèrent largement en Europe car les chrétiens avaient besoin d’horloges précises notamment pour leurs rites religieux. De ce fait, les horloges à poids furent installées dans les tours et les églises principales de la ville. L’usage du ressort marqua une grande évolution dans l’industrie horlogère, et à la même époque, le pendule fut utilisé pour augmenter la précision des horloges. Ce fut Galilée, physicien et astronome italien, qui théorisa l’addition du pendule à l’horloge, alors que l’inventeur du pendule était un physicien hollandais.

- Horloge de table, fabriquée en France, mécanisme à ressort et à remontoir, XIX et XXème siècles.
On voit que l’horlogerie, ce mélange d’art et de science ne cessa de se développer, et aboutit à la fabrication des bracelets-montres et des montres de poche. La première montre de gousset fut fabriquée par un serrurier allemand au XVIe siècle. En ce temps-là, l’or ou l’argent étaient utilisés pour la fabrication des montres dont l’acquisition était réservée aux gens aisés. Mais à la même époque, un Suisse commença à fabriquer des montres en acier, beaucoup moins chères, qui monopolisèrent quasiment le marché. Dès lors, la Suisse fut considérée comme le pionnier de l’horlogerie au niveau mondial. La première génération de montres fut à remontoir, mais plus tard apparurent des montres automatiques puis celles fonctionnant à l’aide de piles également connues sous le nom de "montres à quartz". De nos jours, les horloges les plus modernes sont les horloges atomiques fonctionnant avec la radiation du césium. Ce mécanisme fut théorisé par le physicien danois Niels Bohr en 1913, et en 1949, les Américains produisirent la première horloge atomique.
En Iran, notamment grâce au Musée du Temps, cette évolution historique peut être suivie pas à pas dans les dédales de l’exposition horlogère.

- Montre à gousset fabriquée en Suisse, mécanisme à ressort, XIXème siècle.
Le musée possède une collection d’environ 148 objets, 58 horloges mécaniques, pendules, pendulettes fabriquées en France et 90 montres de poignets et de poche suisses. De plus, au deuxième étage, de précieux calendriers provenant de différentes nations et cultures, ainsi que des appareils d’astronomie sont exposés. Dans cette section, la copie d’une inscription en terre cuite remontant à vingt-sept siècles vaut notamment le détour. L’inscription originale a été découverte dans le palais de Darius le Grand. C’est le seul document démontrant l’existence d’un calendrier national en Perse antique. Les noms des douze mois du calendrier achéménide ainsi que les événements historiques de l’époque sont gravés sur cette inscription. L’ensemble de ce qui est présenté dans le musée aborde des thèmes tels que le passage du temps considéré historiquement, le regard des nations sur le temps, l’évolution de l’industrie horlogère et les nouveautés en la matière. A l’extérieur du bâtiment, on peut découvrir les premiers modèles d’horloges du monde, à savoir les horloges solaires, hydrauliques et ardentes ainsi que des sabliers. Les horloges ardentes datent du troisième millénaire avant J.-C. Le musée contient également une partie exposant la collection des montres modernes présentée au premier étage. Considérations horlogères mises à part, la caractéristique unique de ce musée est l’édifice même, doté d’une architecture et d’une décoration artistique unique.
Cet édifice est un véritable exemple de l’art de la décoration en plâtre, et présente un mélange de style irano-européen. L’art des moulures en plâtre remonte à l’ère sassanide, une inscription découverte dans le palais "Bîshâpour" à Kâzeroun en est la preuve et c’est sous le règne qâdjâr qu’il atteignit son apogée. Le palais du Golestân à Téhéran en est un bon exemple. Cet art, d’abord réservé à la décoration des palais, se généralisa vers la fin du règne des Qâdjârs et de nombreuses demeures furent ornées avec du plâtre. Le bâtiment actuel du Musée du Temps, ainsi décoré, est vieux de huit décennies et date de la fin de la vogue des moulures en plâtre. Situé dans le quartier Za’ferânieh de Téhéran, il est bâti sur une superficie de 700 m² et possède un magnifique jardin de 5000 m². L’édifice a appartenu à deux rois qâdjârs, Mohammad Shâh et Nâsser-e-Din Shâh. Autrefois construit en briques crues, terre et charpente de bois, il a été rénové avec du matériel plus solide et est maintenant doté d’une charpente d’acier. De plus, le grand balcon qui le caractérise a été ajouté après la construction à l’ensemble. Puis, le propriétaire de l’époque, Hossein Khodâdâd, décida de décorer la maison. C’est ainsi que douze années durant, une quarantaine d’artisans travaillèrent sur le bâtiment, le décorant avec de fins motifs en plâtre, des ajouts en fer forgé en forme de soleil et des tuiles émaillées. L’un des attraits décoratifs de l’édifice est l’application des reliefs en plâtre sur un arrière-plan de miroir, dont on peut voir un autre exemple au palais du Golestân. Outre les architectes et les décorateurs comme le maître Kâshi, il faut également faire allusion aux maîtres peintres qui accordèrent très délicatement leurs couleurs avec les motifs décoratifs, créant ainsi des effets de niellure. Pour finir, il faut parler des portes et des fenêtres en bois qui enchantent la vue par leurs décorations joliment gravées dans les cadres.

- Devant l’entrée du musée, maquette iranienne de la première horloge solaire antique égyptienne. La flèche désigne le nord et son ombre sert à marquer les heures.
Le musée de temps est à la fois un musée consacré aux horloges, aux montres et aux calendriers de haute valeur, et une galerie d’art. Il incarne la culture iranienne profondément attachée à l’art. Tous nos remerciements au temps grâce auquel nous avons pu rassembler cette collection historique de l’industrie, de la science et de l’art.
| Adresse :
12, Avenue Za’ferânieh, carrefour Parzin-e-Baghdâdi, Avenue Valy-e-Asr, Téhéran, Iran, Du samedi au jeudi, de 16 h à 21h. |