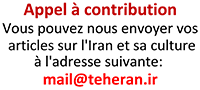
|
La Revue de Téhéran | Iran
Derniers articles
-
CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)
 La Grande mosquée d’Ispahan
La Grande mosquée d’Ispahan
 Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
 Abyaneh,
Abyaneh,
un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale
CULTURERepères
 Les populations roms en Iran
Les populations roms en Iran
Littératurre
 Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
-
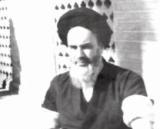
N° 55, juin 2010
La voie de l’Amour
Poèmes spirituels de l’Imam KhomeinyEn 1988 (1367 après l’Hégire selon le calendrier solaire iranien), les éditions de la Radio et Télévision de la République Islamique d’Iran publièrent, sous le titre de Bâdeh-ye ‘eshq (La Coupe d’Amour), les six pages manuscrites d’une lettre de conseils spirituels écrite quelque deux ans auparavant par l’Imam Khomeiny à Fâtima Tabâtabâ’i, l’épouse de son fils Ahmad, accompagnée de quelques poèmes qu’il lui avait confiés.
-
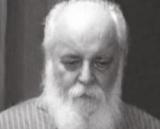
N° 55, juin 2010
La poésie moderne ou la poésie nimaienne* un aperçu esthétique et historiqueLes poètes de l’« époque de l’éveil », c’est-à-dire de la Révolution constitutionnelle de 1906, avaient déjà modifié en profondeur les thèmes poétiques, mais cette révolution se cantonnait dans le cadre du fond, tandis que les formes poétiques demeuraient les mêmes. Il fallut d’autres évènements historiques d’importance tels que la Première Guerre mondiale, le coup d’État de 1920, et enfin la chute de la dynastie quasi féodale des Qâdjârs et l’arrivée au pouvoir des Pahlavis (1925) pour que le processus de modernisation de la poésie s’affirme davantage.
-
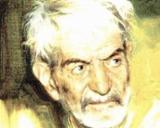
N° 55, juin 2010
Heydar Bâbâ, le chef-d’œuvre de ShahriyârHeydar Bâbâye Salâm (Salut à Heydar Baba) est le chef-d’œuvre de Mohammad Hossein Behdjat Tabrizi dont le nom de plume est Shahriyâr. Ce poète contemporain d’origine azéri a composé beaucoup de poèmes en persan et azéri, mais Heydar Bâbâya Salam est demeuré son ouvrage le plus connu et apprécié. Ce poème contient deux sections dont la première a été composée de 1951 à 1953.
-

N° 55, juin 2010
Iradj Mirzâ, poète de la mereOn dit que Fath-Ali Shâh qâdjâr était très épris de poésie. Il transmit cet attachement à ses descendants, dont Iradj Mirzâ. Le père de ce dernier, Gholâm-Hossein Mirzâ, surnommé Sadr-ol-Sho’arâ (maître des poètes) était l’arrière-petit-fils de Fath-Ali Shâh et comptait parmi les poètes célèbres de la cour. Iradj Mirzâ naquit en 1871 à Tabriz. Il passa son enfance à étudier la langue persane chez des maîtres tels que Bahâr Shirvâni et Aref Esfahâni.
-

N° 55, juin 2010
Hasht Ketâb - Où est la plume de l’ami ?Est-il possible de traduire la poésie ? De manière absolue, la réponse est négative, étant donné que la difficulté ne se situe pas uniquement dans la recherche du rythme et dans le respect de la forme du poème. Selon Robert Ellrodt, « la traduction doit s’adapter à la polysémie de certains textes, mais sans se refuser au choix d’une interprétation. La difficulté majeure est de recréer l’union du sens et de la sonorité qui caractérise la poésie. »
-

Une halte dans l’instantSohrâb Sepehri
N° 55, juin 2010
traduit du persan parSi vous venez me chercher :
J’habite
Plus loin que Nulle partPlus loin que Nulle part est un lieu
On y voit
des courants d’airs porteurs d’akènes de pissenlits
messagers de la nouvelle fleur
-

Le canari ditNimâ Youshidj (1896-1960)
N° 55, juin 2010
Traduit du persan parLe canari dit que la sphère
de la lune est similaire
à celle des cages à barreaux d’or
et à mangeoires de faïencele poisson rouge transcrivit
son plateau du Nouvel An
-

Jardin persanFereshteh Molavi
N° 55, juin 2010
Traduit du persan parFereshteh Molavi est née en 1953 à Téhéran. Elle a publié un roman intitulé Khâneh-ye abr o bâd (La maison des nuages et du vent) ainsi que plusieurs œuvres dont "Bâgh-e irâni" (Le jardin persan), "Nârendj o Torandj" (L’orange et le citron), "Pari aftâbi va dâstânhâ-ye digar" (La fée soleil et autres histoires). Lorsqu’elle vivait en Iran, elle a également traduit plusieurs nouvelles et œuvres littéraires.
-

N° 55, juin 2010
Rencontre entre peinture et poésieLes trois poèmes présentés ici témoignent d’une démarche où la peinture et la poésie se rencontrent et fusionnent. Chaque poème est en même temps un texte et une peinture : il se donne à lire comme poème et à voir comme peinture. Mais les choses ne sont pas si simples car les lettres et les mots en s’exposant échappent au sens et aux chants propres à la poésie pour s’apprécier également esthétiquement, au plan de leur plasticité.
-

Deux regards sur l’exposition WONDERLAND (2500 YEARS OF CELEBRATION)*
, N° 55, juin 2010
Un artiste iranien à Paris : Mamali ShafâhiLe travail artistique de Mamali Shafâhi présenté en 2010 lors de l’exposition Wonderland-2500 Years of Celebration fait écho, dans mon esprit, à la série de photos, intitulée Wanderlust, de l’artiste japonaise Kanako Sasaki. Si les sonorités voisines de Wonderland (« pays des merveilles ») et Wanderlust (néologisme que l’on pourrait traduire par « désir d’errance ») m’ont tout d’abord interpellée, c’est en percevant l’écart des imaginaires entretenus par les deux artistes avec leur pays respectif, l’Iran et le Japon, que j’ai ensuite été captivée.
0 | ... | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ... | 2740

