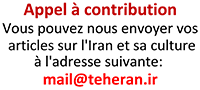
|
La Revue de Téhéran | Iran
Derniers articles
-
CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)
 La Grande mosquée d’Ispahan
La Grande mosquée d’Ispahan
 Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
 Abyaneh,
Abyaneh,
un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale
CULTURERepères
 Les populations roms en Iran
Les populations roms en Iran
Littératurre
 Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
-
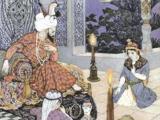
Promenade culinaire dans Les Mille et une NuitsTraduction française d’Antoine Galland*
N° 57, août 2010
Texte présenté par« Sire, dit Schéhérazade, en adressant la parole au sultan, sous le règne du calife Haroun Al-Rachid, il y avait à Bagdad, où il avait sa résidence, un porteur qui, malgré sa profession basse et pénible, ne laissait pas d’être homme d’esprit et de bonne humeur. Un matin qu’il était, à son ordinaire, avec un grand panier à jour près de lui, dans une place où il attendait que quelqu’un eût besoin de son ministère, une jeune dame de belle taille, couverte d’un grand voile de mousseline, l’aborda, et lui dit d’un air gracieux : « Écoutez, porteur, prenez votre panier, et suivez-moi. »
-

N° 57, août 2010
Souvenirs d’un boulangerLe mot sangak signifie « petite pierre » en persan. Le sangak est un pain plat, long et quelque peu triangulaire, cuit sur des cailloux chauffés. Il mesure 5 à 10 millimètres d’épaisseur, 70 à 75 centimètres de longueur et près de 30 centimètres dans sa partie la plus large. Ce pain au levain, fabriqué avec de la farine de blé complète, n’existe apparemment qu’en Iran. On ne connaît pas la date exacte de son invention. Selon une version, c’est Sheikh Bahâi – savant, nommé « le plus grand religieux d’Ispahan » par le roi Shâh Abbâs Ier (1587-1628) - qui aurait eu l’idée de faire cuir du pain sur des cailloux.
-
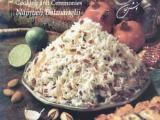
N° 57, août 2010
Une ambassadrice de l’art culinaire iranien : Najmieh BatmanglijMme Najmieh Batmanglij est née en 1947 à Téhéran. Son premier livre de cuisine a été publié à Paris en 1984 et est intitulé Ma cuisine d’Iran. Ce livre s’organise en deux grands chapitres : la cuisine nationale (riz, méthodes de faire cuire le riz, pain, fruits et légumes, boissons et dessert, accompagnements essentiels) et la cuisine régionale (Iran du nord, Khouzestân, Ispahan, Azerbaïdjan, Iran méridional, Iran central, Kurdistan).
Après s’être installée aux Etats-Unis, elle a cofondé avec son mari une maison d’édition à Washington D.C.
-

La cuisine iranienne au centre de la Route de la SoieNajmieh Batmanglij
N° 57, août 2010
Traduit parDans son livre intitulé « La cuisine de la route de la Soie : Un voyage végétarien » [Silk Road Cooking : A Vegetarian Journey] (2002), Mme Najmieh Batmanglij a regroupé plus de 150 recettes de la cuisine végétarienne des pays de la route de la Soie. La route de la Soie n’était pas seulement une voie du transit des marchandises, mais aussi celle des pensées, des croyances, des us et coutumes, des modes de vie, des ingrédients de cuisine, des recettes, et des goûts.
-

N° 57, août 2010
Chelow Kabâb et fâloudeh made in FranceL’importante opération d’urbanisme du Front de Seine à Paris, lancée à partir des années 1970 sur la rive gauche de la Seine en aval de la Tour Eiffel, a longtemps attiré une clientèle étrangère aisée venue s’y installer plus ou moins durablement, parmi laquelle on comptait de nombreux Iraniens. C’est donc logiquement que quelques épiciers et restaurateurs, venus eux-mêmes d’Iran, se sont installés dans ce secteur, à la grande satisfaction d’une clientèle restée fidèle à ses traditions culinaires et à celle d’une clientèle parisienne curieuse de saveurs nouvelles venues du Moyen-Orient.
-

L’alimentation et son évolution logique dans le mythe iranien du premier hommeBahâr Mokhtâriân
N° 57, août 2010
Traduit parCet article étudie le mythe iranien du premier couple, Mashi et Mashyâneh, explique le rôle de l’alimentation dans la formation de la culture et le processus de la valorisation de l’alimentation dans celle-ci. La comparaison des différents genres de nourritures montre que l’alimentation idéale dans la culture iranienne préislamique était l’alimentation végétarienne, et que manger de la viande était déprécié et même réprouvé. L’alimentation médiatrice dans ce schéma est celle basée sur des aliments tels que le lait ou les œufs, ni végétaux, ni animaux.
-

N° 57, août 2010
Le vin dans la poésie gnostique à travers l’exemple de Hâfez : de l’ivresse terrestre à l’extase spirituelleBien que révélée progressivement, l’interdiction du vin est clairement exprimée dans le Coran et a été rattachée à plusieurs causes : individuelle, en ce qu’il altère la raison alors que la religion se veut un éveil conscient de l’homme à lui-même, ou encore sociale de par les désordres et dangers qu’il peut générer au sein de la société. Dans le Coran, les boissons enivrantes sont évoquées dans deux contextes : terrestre, où elles sont l’objet d’une progressive interdiction, et dans l’Au-delà, comme l’une des récompenses des croyants au Paradis.
-

N° 57, août 2010
L’Iran dévoilé par ses artistes, au Centre National Georges Pompidou à ParisA l’occasion de la sortie d’un numéro spécial du magazine Art Press intitulé L’Iran dévoilé par ses artistes, le centre Georges Pompidou et Musée National d’Art Moderne à Paris ont organisé, le 7 mai dernier (17 Ordibehesht), une soirée en présence de Catherine Millet, directrice de la rédaction de cette revue, d’artistes, d’acteurs du monde de l’art, et d’intellectuels iraniens qui ont collaboré à la rédaction de ce numéro consacré exclusivement à l’art contemporain iranien.
-

N° 57, août 2010
L’art iranien contemporain tel qu’en lui-même, une présence croissante sur la scène françaiseertes des artistes iraniens ont été vus, ont résidé, ont étudié ou se sont installés en France (et ailleurs) depuis des décennies. Je ne citerai par exemple que Hossein Zenderoudi dont les peintures issues de la calligraphie eurent une certaine notoriété dans les années 70 à Paris ; mais il s’agit avec cet artiste et ses contemporains d’une autre génération que celle dont il est question aujourd’hui.
-

N° 57, août 2010
Les thèmes et les images concernant l’Iran dans L’Usage du monde de Nicolas Bouvier*Voyageur, écrivain, poète, essayiste, iconographe, professeur, guide touristique en Chine, Nicolas Bouvier naît le 6 mars 1929 à Grand-Lancy, près de Genève. Petit dernier d’une famille de trois enfants, il grandit dans « un milieu huguenot, à la fois rigoriste et éclairé, très ouvert intellectuellement, mais où tout l’aspect émotif de l’existence était sévèrement géré ». Dans son enfance (1933-1937) il dévore Jules Vernes, James Oliver Curwood, Robert Louis Stevenson, Jack London et Fenimore Cooper.
0 | ... | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ... | 2740

