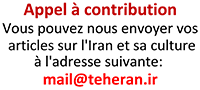
|
La Revue de Téhéran | Iran
Derniers articles
-
CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)
 La Grande mosquée d’Ispahan
La Grande mosquée d’Ispahan
 Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
 Abyaneh,
Abyaneh,
un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale
CULTURERepères
 Les populations roms en Iran
Les populations roms en Iran
Littératurre
 Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
-

A propos d’Omar Khayyâm et de Khaghâni
N° 59, octobre 2010
Le quatrain, élu parmi les formes brèvesFaut-il le rappeler ? Le poète anglais Edward Fitzgerald est à l’origine de l’introduction en Occident de la fameuse strophe de quatre vers - le quatrain - grâce à sa traduction en 1859 du non moins fameux recueil des Robâiyât d’Omar Khayyâm. Avant cette date, cette forme poétique courte était inconnue du public de l’ancien monde. La seule forme brève repérée jusqu’alors était le haïku japonais créé à l’initiative de Bashô au XVIIe siècle, et qui fut popularisé au cours du XXe siècle par l’entremise du poète (...)
-
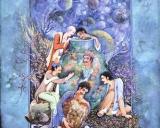
La mort dans les Robâiyât de KhayyâmMahdi Banaï Jahromi
N° 59, octobre 2010
Traduit parUne réflexion philosophique sur la mort :
"La mort est à peine pensable : dans ce concept d’un total nihilisme, on ne trouve rien où se prendre, aucune prise à laquelle l’entendement puisse s’accrocher. La "pensée" du rien est un rien de la pensée, le néant de l’objet annihilant le sujet. (…) Dès lors, problème : en quoi peut bien consister la "méditation sur la mort" que l’on trouve chez les sages de l’Antiquité ? Le sage ne penserait-il alors à rien du tout, puisqu’il n’y a rien (...)
-

N° 59, octobre 2010
Le monument funéraire de KhayyâmLe monument funéraire d’Omar Khayyâm est l’œuvre d’un architecte iranien, Houshang Seyhoun. Sa construction débuta en 1959 et fut achevée en 1962. Par ce monument, Houshang Seyhoun a rendu hommage à la poésie de Khayyâm ainsi qu’à ses connaissances en mathématiques et en astronomie. Il a su combiner avec harmonie des éléments de l’architecture iranienne traditionnelle et de l’architecture moderne.
Les monuments funéraires précédents
Khayyâm fut enterré à sa mort (en 1131) dans le cimetière Hireh de (...)
-
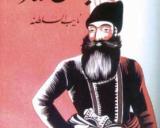
N° 59, octobre 2010
Aperçu de l’histoire du graphisme en Iran
1- Des origines à l’époque moderneL’art du graphisme remonte à un passé très lointain. On pourrait même dire que ses racines datent de la préhistoire, moment où sont apparus les premiers dessins et les premières images, sur des os ou des murs. Ces images représentent une première trace laissée par l’homme de façon volontaire. Elles correspondent à une volonté d’expression, de transmission d’un message, d’un savoir. Elles sont considérées comme l’essence du graphique.
A l’époque préhistorique, l’inexistence de traces écrites nous permet (...)
-

ART BRUT JAPONAIS
N° 59, octobre 2010
La nouvelle vague japonaise
Paris
La Halle Saint Pierre, Musée d’Art NaïfCe musée de taille modeste se situe sur la Butte Montmartre, au pied de l’église du Sacré Cœur. Le bâtiment est une ancienne halle (un marché couvert) de type Baltard c’est-à-dire une architecture métallique érigée à la fin du XIXe siècle et devenue en 1986 un musée d’art brut et d’art naïf. Le fondateur de ce musée est un collectionneur passionné, Max Fourny, qui a, au fil des années, rassemblé plus de 600 œuvres représentatives de ce qui est indéniablement le meilleur de l’art brut et de l’art naïf. Le musée (...)
-
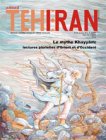
N° 59, octobre 2010
Behjat Sadr
Pionnière de la peinture conceptuelle en IranBehjat Sadr (1924 – août 2009) est une figure importante de la peinture moderne de l’Iran. Ses tableaux sont d’emblée reconnaissables par les lignes tracées à l’aide d’un couteau à plâtre dans une ou deux couches de couleur. Les critiques la considèrent comme l’une des pionnières de la peinture conceptuelle en Iran.
Behjat Sadr dit dans un entretien : « Quand j’étais lycéenne, je m’intéressais à l’astronomie et aux mathématiques et je ne pensais absolument pas à la peinture. [...] Mais j’ai commencé à (...)
-
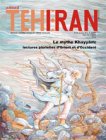
N° 59, octobre 2010
Les dictionnaires de langue persaneA l’époque sassanide, où le persan était la langue officielle du pays, les Iraniens avaient déjà des dictionnaires persans, à l’instar des Chinois et des Grecs qui sont considérés comme les précurseurs de la lexicographie. Les archéologues ont ainsi découvert deux dictionnaires datant de cette époque : OIM et Monâkhtây ou dictionnaire Pahlavi. Lors de la diffusion croissante du persan dari en Iran, les locuteurs du persan pahlavi éprouvèrent le besoin d’apprendre le persan dari, ce qui entraîna une (...)
-

N° 59, octobre 2010
Ebn Salâh Hamedâni, mathématicien et astronome iranien du XIIe siècleNadjmeddin Ebn Salâh Hamedâni, mathématicien et médecin iranien du XIIe siècle de l’Hégire, originaire de Hamadân, partit pour Bagdad afin d’approfondir ses connaissances scientifiques après avoir terminé ses études préparatoires dans sa ville natale. A Bagdad, Ebn Salâh devint l’élève du grand mathématicien Abol-Hokm Maghrebi durant quelques années, travaillant en même temps en tant que médecin du gouverneur de Mardin, l’émir Teymourtâsh Artaghi, sur l’invitation de ce dernier. Abol-Hokm Maghrebi, son maître, (...)
-
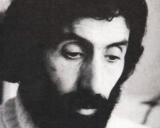
Le voyage dans la poésie de Sohrâb*Touradj Rahnema
N° 59, octobre 2010
Introduit et traduit du persan parSohrâb Sepehri, cette étoile de la poésie et de la peinture persanes contemporaines, naquit à Kâshan en 1928. Grand voyageur, il parcourut l’Italie, le Japon, l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan, la France, la Grèce et les Amériques. Il s’était notamment donné pour mission de rapprocher les mysticismes orientaux et occidentaux. Ses poèmes, ayant pour thèmes les valeurs humaines, la solitude et la nature, ne traitent jamais de questions d’ordre politique. Étant un grand disciple de Nimâ Youshidj, il (...)
-
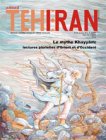
N° 59, octobre 2010
PoèmesLouve
Des chevriers sont là
Qui ont porté leurs bêtes nouveau-nées.
Des sources naissent à fleur de pierre où le sabot résonne
Et la palmeraie brille sur l’écaille des sables.
C’est l’heure incandescente et rose des prières.
Dans la claire-voie des cours
Un vol de tourterelles fond sur la boutonnière
Des fontaines
Et l’eau perle aux aiguières verseuses d’ablutions.
C’est l’heure-empreinte, l’heure volée
L’heure-envergure envolée
La tente est bleue dans l’âtre pétrifié du jour
La chaleur en-allée (...)
0 | ... | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ... | 2740

