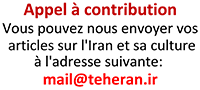
|
La Revue de Téhéran | Iran
Derniers articles
-
CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)
 La Grande mosquée d’Ispahan
La Grande mosquée d’Ispahan
 Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
 Abyaneh,
Abyaneh,
un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale
CULTURERepères
 Les populations roms en Iran
Les populations roms en Iran
Littératurre
 Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
-
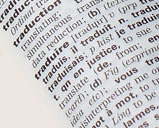
N° 98, janvier 2014
Traduire,
une pratique-théorieLa théorie de la traduction
Lorsque l’on réfléchit sur la théorie de la traduction littéraire, il est essentiellement question des différentes aires culturelles et de leur impact sur le travail du traducteur. Non pas près de lui simplifier la tâche, elles l’obligent au contraire à diversifier ses domaines de connaissances ; diversification qui exigera la maîtrise et la compréhension des différentes cultures propres aux auteurs à traduire. Le traducteur littéraire se verra en quelque sorte endosser, en (...)
-

N° 98, janvier 2014
Sur la fameuse leçon morale de Candide de Voltaire
"Il faut cultiver notre jardin"François-Marie Arouet dit Voltaire fut sans doute l’un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle. Il a notamment exprimé ses pensées philosophiques au travers de contes dont l’efficacité a permis une importante vulgarisation de ses idées. D’un certain point de vue, les contes de Voltaire - Candide en particulier - sont des fictions proches de l’expérience autobiographique et le reflet de sa propre vie. D’épicurien joyeux et optimiste au début, sa pensée évolue au fur et à mesure des expériences (...)
-
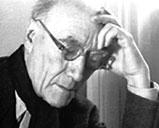
N° 98, janvier 2014
Gide et l’Orient : rêve ou réalité
Constantinople et la Perse« Né à Paris, d’un père uzétien et d’une mère normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine ? J’ai donc pris le parti de voyager. »
André Gide, "A propos des Déracinés de Maurice Barrès"
L’Orient de Gide n’est pas l’Orient tel qu’on le retrouve aujourd’hui sur la carte, c’est un Orient sans frontière, un Orient personnel, un Orient sensuel, un Orient fantasmatique de par son mystère que par la joie qu’il procure au voyageur. Pour Gide, le voyage en Orient est avant tout un refus, un abandon d’une (...)
-

N° 98, janvier 2014
TehranArtWalk
La nouvelle biennale des jeunes artistes iraniens.
Palais Saadâbâd
8 et 9 octobre 2013A Téhéran, le monde de l’art, celui des arts plastiques et visuels contemporains, reste limité à quelques dizaines de galeries privées et à quelques musées d’un très grand calme. Ainsi, le Musée d’art contemporain de Téhéran, bâti à la fin des années soixante-dix, se contente d’exposer un nombre restreint des œuvres de sa collection, déjà montrées et remontrées ; de ce fait, le public est plus que clairsemé et l’ambiance bien morose. Il en va de même au musée d’art du Palais Niâvarân où, malgré une architecture (...)
-

N° 98, janvier 2014
GEORGES BRAQUE
Grand Palais, Paris, 18 septembre 2013 – 6 janvier 2014
La brève mais extraordinaire aventure cubisteC’est une grande exposition, de celles que le Grand Palais sait organiser avec maîtrise, et qui draine un public nombreux, trop nombreux jusqu’à gêner considérablement la visite. Trop grande exposition ? Peut-être : parti pris de montrer le plus possible d’œuvres, jusqu’à celles d’un intérêt relativement modeste. On pourrait donc imaginer une exposition centrée sur le meilleur, sur ce qui est essentiel ; il est vrai qu’il en allait de même avec l’exposition Dynamo, en ce Grand Palais, à laquelle j’ai (...)
-

, N° 98, janvier 2014
Regard sur la cuisine azérie et les sofreh spécifiques de TabrizLes femmes de Tabriz connaissent différents moyens pour réaliser leurs souhaits. L’étalage des nappes d’offrandes (sofreh) dans les maisons est l’un de ces moyens. La coutume des sofreh, pratiquée partout en Iran, l’est différemment selon les régions. Nous nous proposons dans cet article de voir les sofreh de Tabriz.
Les renseignements présentés dans cette recherche ont été recueillis à la suite d’entretiens réalisés avec des femmes originaires de Tabriz, et dont les noms et les âges sont précisés (...)
-

N° 98, janvier 2014
Nouvelles sacrées (I)
Opération « H-3 »En 1981, des sources iraniennes informent que les forces aériennes irakiennes ont transporté la majorité de leurs équipements dans une base éloignée à l’ouest du pays, pour les protéger contre d’éventuelles attaques de l’Iran. Il s’agit de 48 avions bombardiers de différents modèles dont des Soukhoï-25, Mig-23 et Tupolev Tu-22, 4 hélicoptères, un grand nombre de canons antiaériens, etc.
La base aérienne Al-Walid, à l’ouest de l’Iraq et dans le secteur « H-3 », proche de la frontière jordanienne est, selon (...)
-

, N° 97, décembre 2013
Naissance et évolution de la photographie en PerseL’avènement de la photographie en Perse revêt une grande importance aussi bien pour les professionnels du domaine que pour les chercheurs historiographes, notamment les spécialistes de la Perse qâdjâre. L’apparition de cette pratique en Iran coïncide en effet avec le règne de Nâssereddin Shâh, roi à partir de 1848 et jusqu’en 1896. C’est grâce à cette passion du roi iranien pour les arts visuels, en particulier la photographie, que les professionnels de tous bords possèdent aujourd’hui de nombreuses (...)
-

Les trésors des photographies anciennesMohammad Rezâ Tahmâsbpour
N° 97, décembre 2013
Traduit par :Les photographies anciennes nous apprennent beaucoup sur l’histoire des évolutions de l’art photographique en Iran, mais elles sont aussi de précieux instruments dans les recherches en sciences humaines et sociales. Depuis l’entrée de la technique de la prise d’images par l’action de la lumière sur une surface sensible il y plus de 160 ans, des collections très riches et variées de photographies historiques ont été rassemblées en Iran. Malgré leur grande valeur, ces collections n’ont guère fait l’objet (...)
-

N° 97, décembre 2013
La photographie iranienne contemporaine, approche et prise de vue depuis la FranceLa photographie iranienne est fort présente en France, notamment au plan institutionnel, depuis les fameuses expositions de 2009 (dont le commissaire fut Anâhitâ Ghabâiân) qui se sont tenues au Musée du Quai Branly et au Musée de la Monnaie de Paris. Au Musée du quai Branly ce fut : « 65 ans de photographie iranienne » et au Musée de la Monnaie de Paris, ce fut : « Iran, 1979-2009, entre l’espoir et le chaos : trente ans de photographie documentaire iranienne ».
Au musée du Quai Branly, l’exposition (...)
0 | ... | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | ... | 2740

