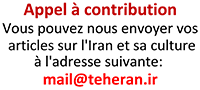
|
La Revue de Téhéran | Iran
Derniers articles
-
CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)
 La Grande mosquée d’Ispahan
La Grande mosquée d’Ispahan
 Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
 Abyaneh,
Abyaneh,
un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale
CULTURERepères
 Les populations roms en Iran
Les populations roms en Iran
Littératurre
 Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
-

N° 101, avril 2014
Henri Cartier-Bresson
Centre Georges Pompidou, Paris, 12 février-9 juin 2014Parler d’un photographe et de la photo dans une revue iranienne, c’est parler aussi d’un art qui occupe la place d’un art majeur dans l’histoire contemporaine de l’Iran. Un art qui, outre ce qui le caractérise, et la photo iranienne a bien ses propres caractéristiques, vit en dialogue permanent avec la photo du monde. Car la photo étant image est l’un de ces arts qui voyage tellement aisément sur la toile qu’elle ne saurait échapper aux échanges avec celle du monde. Un regard de peintre
Henri Cartier (...)
-

Le Mariage forcé
Soirées théâtrales à Téhéran dans la langue de MolièreReportage de
N° 101, avril 2014Mise en scène :
Dârioush Moaddabiân
Assistant de mise en scène :
Hamid-Rezâ Shairi
Distribution des rôles :
Sganarelle, futur époux de Dorimène (Dâvoud Nejâti)
Géronimo, ami de Sganarelle (Mohammad Karimiân)
Dorimène, jeune coquette, promise à Sganarelle (Minâ Doroudiân)
Pancrace, docteur aristotélicien (Hamid-Rezâ Shairi)
Marphurius, docteur pyrrhonien (Hamid-Rezâ Shairi)
Alcantor, père de Dorimène (Dârioush Moaddabiân)
Alcidas, frère de Dorimène (Sâmân Mohammadi)
Lycaste, amant de Dorimène (...)
-

N° 101, avril 2014
L’Iran mythique au contact de l’OccidentDans l’histoire culturelle de l’Orient et de l’Occident, le mythe apparait comme un vecteur révélateur qui associe la richesse historique au patriotisme héroïque dans le cadre d’une nouvelle conception : la révélation du mythe est liée à l’authenticité culturelle. Autrement dit, la présence du mythe dans un registre interculturel désigne l’importance des rapports réciproques entre deux nations étant susceptibles de le valoriser comme une référence réactive qui apporte une nouvelle histoire pour nourrir (...)
-

, N° 101, avril 2014
Bobin, une folie à la folie« Les mots n’ont pas si grande importance, qu’avons-nous à nous dire dans la vie, sinon bonjour, bonsoir, je t’aime et je suis là encore, pour un peu de temps vivante sur la même terre que toi ? »
Christian Bobin est né le 24 avril 1951 au Creusot, une petite ville en Bourgogne où il vit toujours. Élevé dans une petite maison près de l’église Saint-Charles, il s’intéresse au monde des livres dès son enfance. Il a un frère et une sœur, tous deux ses aînés. Son père était dessinateur industriel dans les (...)
-

N° 101, avril 2014
Nouvelles sacrées (IV)
La conquête de Fâv (11 février 1986)En 1986, les victoires militaires de la République islamique d’Iran, dont la libération de Khorramshahr en 1982, menacent de plus en plus la réputation de l’Iraq dans les milieux nationalistes. Saddam Hussein, qui dispose des appuis politiques et financiers de ses alliés, doit faire son possible pour retourner le jeu. A la suite des combats directs sur les fronts sud, l’armée irakienne décide de planifier une guerre aérienne et navale, mais c’est l’Iran qui prend l’initiative consistant à traverser (...)
-

N° 100, mars 2014
Les mouvements iraniens de libération nationale contre l’envahisseur mongolLa dure et cruelle invasion mongole et la domination qui s’en suivit provoquèrent à long terme de nombreuses révoltes. Les devises religieuses tirées du chiisme, du zoroastrisme et du mouvement khurramite ainsi que l’encouragement de seigneurs rebelles tels que le Sheikh Califa Mâzandarâni, ont encouragé sans relâche la rébellion contre l’envahisseur mongol. L’une de ces révoltes permit aux Sarbedâr de libérer la quasi-totalité de l’ouest du Khorâssân du joug mongol en 1337-1338 et d’y établir leur Etat, (...)
-

N° 100, mars 2014
La dynastie ilkhanide en Iran :
une renaissance après les invasions mongoles ?Après les invasions sanglantes des Mongols et en particulier les campagnes menées par Gengis Khân, qui furent à l’origine de l’une des plus traumatisantes périodes de l’histoire iranienne, une nouvelle ère commença avec l’avènement de la dynastie ilkhanide (1256-1335). Cette dynastie était dirigée par les Ilkhâns, gouverneurs régionaux du grand Khân moghol, qui régnaient sur le plateau iranien et ont pu restaurer l’indépendance politique de l’Iran y établissant un Etat unifié. Cette nouvelle génération de (...)
-
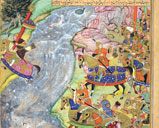
Théories de la victimisation : Influence permanente de la catastrophe de l’invasion mongole sur l’histoire politique, sociale et scientifique de l’Iran
(2ème partie)Abbâs Edâlat*
N° 100, mars 2014
Abrégé et traduit parLes conquêtes de Tamerlan et la victimisation du fait du yassa en Iran
Après avoir sommairement décrit la psychologie du traumatisme et présenté la théorie de la victimisation dans la première partie, nous allons maintenant voir comment le traumatisme social s’étendit même après l’invasion mongole et l’ère ilkhanide, avec la réitération des actes sanguinaires des Mongols par Tamerlan.
En 1380, les Iraniens vivaient déjà depuis plus de 160 ans dans des conditions traumatisantes constantes, générées (...)
-
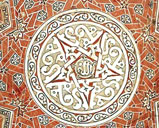
, N° 100, mars 2014
Aspects de l’art et de l’artisanat iranien sous le règne ilkhânideLes Ilkhânides sont une dynastie fondée en 1256 en Iran par Hulagu Khân, petit-fils de Gengis Khân. Lorsque les Mongols attaquent l’Iran, ce pays, déjà enrichi depuis cinq siècles par l’apport de la culture islamique, fait connaissance avec l’art et la culture asiatiques, en particulier chinoise, notamment les styles artistiques des dynasties Song et Yuan. Grâce aux miniatures et aux pages illustrées qui nous sont parvenues de cette période, nous pouvons constater l’influence de la culture est (...)
-
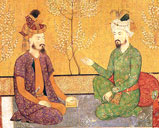
N° 100, mars 2014
L’influence des Iraniens sur les Mongols en IndeL’existence de relations entre la Perse et l’Inde est attestée dès l’Antiquité, ces deux entités ayant en outre de profondes racines historiques communes. Au début du XVIe siècle, lors de la prise de pouvoir de la dynastie safavide, les descendants de Tamerlan arrivèrent au pouvoir en Inde avec l’aide de la dynastie iranienne des Timourides. Au cours de cette période, ces deux dynasties ont entretenu des relations plus ou moins cordiales en exerçant néanmoins une influence réciproque remarquable l’une (...)
0 | ... | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | ... | 2740

