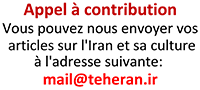
|
La Revue de Téhéran | Iran
Derniers articles
-
CAHIER DU MOIS La province d’Ispahan, un foyer de la culture et de l’histoire de l’Iran (II)
 La Grande mosquée d’Ispahan
La Grande mosquée d’Ispahan
 Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
Golpâyegân et son héritage architectural seldjoukide
 Abyaneh,
Abyaneh,
un bijou rouge au cœur du désert L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
L’Écomusée du Dr Rahgoshay à Badroud :
Un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion de l’identité nationale
CULTURERepères
 Les populations roms en Iran
Les populations roms en Iran
Littératurre
 Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
Esthétique de la poésie lyrique de Saadi
-

N° 140, juillet 2017
La femme et la littérature persane
La figure de la femme et les femmes écrivaines en IranLes premiers pas des femmes dans la littérature
La littérature contemporaine iranienne se forme à partir de l’ère qâdjâre et continue son évolution jusque dans les années 1950. Cependant, le faible nombre d’écrivaines iraniennes durant cette période n’a guère permis à un véritable courant littéraire féminin d’émerger. Les contraintes sociales et familiales ne favorisaient alors pas l’épanouissement de la fibre littéraire féminine. Celles qui avaient l’ambition d’écrire évitaient de porter la main à la plume de (...)
-

N° 140, juillet 2017
A l’ombre du palmier de Marie
Notes sur la figure de Marie dans la
littérature persanePuis, lorsqu’elle (la mère de Marie) en eut accouché, elle dit : « Seigneur, voilà que j’ai accouché d’une fille » ; or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché ! Le garçon n’est pas comme la fille. « Je l’ai nommée Marie, et je place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le Diable, le banni. » (Sourate Al-‘Imrân, 36).
C’est en s’appuyant sur ce verset coranique que les commentateurs du Coran cherchent à interpréter le nom de Marie, mère de Jésus, qui signifie « adoratrice » et « servante (...)
-

N° 140, juillet 2017
La Mujtahid d’IspahanDurant ces dernières décennies, nous observons un intérêt croissant chez les femmes iraniennes, plutôt des jeunes filles d’entre 20 et 30 ans, pour étudier la théologie chiite dans diverses écoles islamiques. Pour répondre à cette demande, depuis les années 1980, le séminaire religieux ou howzah de Qom a établi, dans les grandes villes du pays, des centres d’études religieuses ouverts aux femmes. Fondée en 1984, l’école internationale Jame’at-ol-Zahrâ de Qom est la plus connue. Aujourd’hui, il existe plus (...)
-

N° 140, juillet 2017
La participation des femmes
à la vie politique« Tous les membres de la Nation, femmes et hommes, sont sous la protection de la Loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’Islam. »
Article 20 de la Constitution de la République islamique d’Iran
De son édification en 521 av. J.-C. par Darius Ier à sa destruction partielle en 331 av. J.-C. par Alexandre, Persépolis fut la capitale politique des rois achéménides. Les archéologues nous apprennent que les nombreux (...)
-

N° 140, juillet 2017
Le travail des femmes en Iran :
la lutte pour l’égalitéDepuis 1975, le pouvoir de la femme dans la famille iranienne augmente continuellement. On peut constater au sein des familles iraniennes une marche vers la démocratisation et la réduction du rôle de l’homme dans la prise de décisions. Selon un sondage d’opinion effectué en 1975, pour 72% des sondés, ce sont les hommes de la famille qui prennent univoquement les décisions. En 2004, cette proportion a diminué à 33%.
La scolarisation féminine en Iran
Avec la généralisation de l’éducation gratuite et (...)
-

N° 140, juillet 2017
Les femmes,
la Révolution et la Défense sacréeLeurs visages étaient étranges. Habillées de foulards bleu foncé ou crème et de vêtements longs, le khôl de leurs yeux était de poussière et de larmes, le rouge de leurs joues, la chaleur, et celui de leurs lèvres, la soif. Leur parfum sentait la poudre… Elles portaient des armes pour parure, ou un sac de munitions, ou un appareil photo, un magnétophone, une trousse de secours… Et aujourd’hui, leur plume est leur plus bel ornement … C’est l’histoire des femmes de la guerre ; ces femmes épiques des huit (...)
-
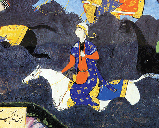
N° 140, juillet 2017
La figure de la femme dans
la littérature persane
traditionnelle et contemporaineSelon un regard traditionnel, l’être masculin occupe souvent une place primordiale dans la littérature ; et quand bien même l’être féminin n’y serait pas absent, sa présence sert souvent à refléter les besoins et désirs masculins. Dans un système culturel dominé par les hommes, l’image des femmes ne peut être que le reflet de la face cachée de l’être masculin. La femme, tantôt comme symbole du bien, tantôt comme celui du mal, s’est vu conférer des rôles différents et contradictoires dans la littérature persane (...)
-

N° 140, juillet 2017
Les femmes afghanes au cours de l’histoire : les droits des femmes dans une société patriarcale 1774-1929Les femmes sont quasiment invisibles dans les événements politiques et historiques de l’Afghanistan. Elles étaient sans doute présentes dans la vie sociale, économique et politique, mais les documents historiques n’en ont guère enregistré la mémoire.
L’histoire de l’Afghanistan dans sa dimension nationale est récente, car auparavant, cette région faisait partie de la grande Perse. C’est lorsque la dynastie iranienne des Afshârides, établie au nord-est de l’Iran, prend fin que naît l’Afghanistan, en 1747. (...)
-
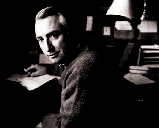
N° 140, juillet 2017
Ali Bâbâ et les quarante sémiotophiles
de TéhéranSéquence IV :
Pour la deuxième fois de ma vie, je le vois là, devant la mosquée, pas trop loin des tombeaux des cinq martyrs anonymes qui se trouvent juste sur un point d’intermédiaire entre le mausolée du cher Imâmzâdeh Aziz et la tombe d’un prince qâdjâr de la fin du XIXème siècle. Ces mémoriaux religieux-historiques se dressent sur une colline à quelque cent mètres de la Faculté des Lettres étrangères et des sciences du langage où Ali Bâbâ enseigne la sémiotique depuis bon nombre d’années au département (...)
-

N° 140, juillet 2017
Apulée au miroir de la Mystique ensorcelée iranienne« Grand ouvert mon cœur est prêt / à suivre la première ombre qui passe »
Holappa
« Sois immatériel en présence de l’immatériel »
Saint Nil, De Oratione
Dans la tradition chinoise, l’arbre taoïste du Kien-Mou, le « Bois dressé », en lequel se marient l’ombre et la lumière, est le point d’équilibre parfait : « On dit qu’à midi rien de ce qui, auprès de lui, se tient parfaitement droit, ne peut donner d’ombre ». Sans ombre. On pense aux vers célèbres de Pindare : « Qu’est chacun de nous, que n’est-il pas ? (...)
0 | ... | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ... | 2740

